« Barbares en avant ! » – Endnotes

Ainsi l’Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque (puis gréco-romaine) sous le même nom de barbare ; la civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or derrière ces épithètes se dissimule un même jugement : il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l’inarticulation du chant des oiseaux, opposées à la valeur signifiante du langage humain ; et sauvage, qui veut dire « de la forêt », évoque aussi un genre de vie animale, par opposition à la culture humaine.
– Claude Lévi Strauss, Race et histoire (1961)
Cette même pression de la population sur les forces productives poussa autrefois les barbares d’Asie à l’invasion dans le vieux monde. […] Pour rester barbares, il fallait rester peu nombreux. Si leur nombre augmentait, l’un restreignait la zone de production de l’autre. Pour cette raison, la population superflue fut obligée de se mettre aux grandes invasions aventureuses qui mena à la constitution des peuples de l’Europe ancienne et moderne.
– Marx, MEW 8, article « Émigration forcée », notre traduction.
Dératisation, arsenic, maisons de travail (work-houses), paupérisation généralisée. Les moulins à bras et autres procédés de travail archaïques resurgissent en pleine civilisation elle-même et faisant corps avec elle. C’est la barbarie lépreuse, la barbarie en tant que lèpre de la civilisation.
– Marx, Manuscrit « Salaire », MEW 6, p. 553. Traduction par Roger Dangeville.
Avec l’extension de l’économie bourgeoise marchande, le sombre horizon du mythe est illuminé par le soleil de la raison calculatrice dont la lumière glacée fait lever la semence de la barbarie.
– Adorno/Horkheimer, Dialectique de la Raison (1944)
⁂
Traduit par stoff et Agitations
Au début du mois de mai 2020, des émeutes de la faim ont éclaté à Santiago du Chili. Les confinements avaient privé des hommes et des femmes de leurs revenus, ce qui faillit les faire sombrer dans la famine. Un vaste mouvement de cantines communautaires auto-organisées s’est rapidement répandu dans tout le pays. Plus tard dans le mois, des émeutes se sont propagées au Mexique en réaction au meurtre par la police de Giovanni López – un ouvrier du bâtiment qui avait été arrêté pour non-port de masque – tandis que des milliers de travailleur·ses itinérant·es désespéré·es brisaient le couvre-feu en Inde. Certain·es travailleur·ses des entrepôts d’Amazon aux États-Unis et en Allemagne se sont mis·es en grève pour protester contre les mauvais protocoles sanitaires face au COVID-19[1]. Pourtant, à la fin du mois de mai, ces agitations ouvrières chez le plus grand distributeur du monde furent rapidement noyées par un mouvement de masse d’une ampleur sans précédent qui a secoué les États-Unis en réponse au meurtre policier répugnant de George Floyd, diffusé en direct. Largement initié par les habitant·es noir·es de Minneapolis, le soulèvement a rapidement été rejoint par des Américains de tous lieux, races et classes. Dans les premières émeutes et manifestations, on pouvait même apercevoir quelques soutiens de miliciens dans un front transversal (Querfront[2]) digne de l’époque de QAnon[3].
L’arrivée du COVID-19 avait d’abord semblé marquer une rupture dans la lutte des classes, ou du moins fournir des ressources supplémentaires à l’appareil répressif. Tel était en tout cas le pronostic de trois dissidents italiens vieillissants qui ont fait circuler des textes scandaleux dans les premières semaines de la pandémie[4]. Il est peut-être vrai que les confinements représentent, comme l’a récemment affirmé Julien Coupat, « un nouveau mode de gouvernement et de production d’un certain type d’homme[5] ». Les mobilisations massives qui secouaient le Chili depuis octobre 2019 ont été étouffées à la fois par le confinement et par l’angoisse généralisée de la nouvelle peste dans un pays où la santé est une marchandise onéreuse. En France, la longue grève générale contre la réforme des retraites a pris fin brutalement lorsque les réformes ont été adoptées par la même série de décrets que ceux qui ont annoncé les premières mesures d’urgence contre le coronavirus, en contournant le Parlement. Pendant un certain temps, les manifestant·es de Bagdad, Beyrouth et Hong Kong ont été chassé·es de la rue et les dissidents italiens semblaient avoir raison. Mais il n’a pas fallu longtemps pour que les masses du monde entier désobéissent aux couvre-feux et aux confinements qui avaient assigné à résidence la moitié de l’humanité et plongé l’économie mondiale dans un énorme marasme.
À peu près au même moment où les manifestations massives contre le meurtre de Floyd ont éclaté aux États-Unis, des milliers de personnes ont défilé des favelas de Sao Paulo jusqu’au palais du gouverneur de l’État pour réclamer un soutien financier, tandis qu’en Colombie et au Salvador, des foules sont descendues dans la rue en tapant sur des casseroles pour protester contre la détérioration du niveau de vie et pour demander la fin des confinements. En juillet, des centaines de personnes ont pris d’assaut le parlement serbe en réaction à la réinstauration du couvre-feu par le nouveau gouvernement, tandis que l’assassinat du chanteur populaire Haacaaluu Hundeessaa en Éthiopie a déclenché de violentes manifestations qui ont fait plus de 150 morts. Le mois suivant, des manifestations similaires prirent place au Kenya voisin lorsque les bidonvilles de Nairobi se sont soulevés contre la police qui avait tué plus de vingt personnes dans le cadre de l’application du couvre-feu, tandis que le Belarus a tremblé lors de manifestations, d’émeutes et de grèves après des élections truquées qui, comme toujours, ont donné le pouvoir à Alexandre Loukachenko. En septembre, la Colombie a connu une vague d’émeutes suite au meurtre par la police de l’avocat Javier Ordóñez et les quartiers populaires de Madrid et de Naples se sont soulevés contre la police et les confinements. Au moment où nous écrivons ces lignes, le Nigeria vient tout juste de traverser une vague massive de protestations contre une police meurtrière et corrompue et l’Inde se trouve en plein milieu de la plus grande grève générale de son histoire.

Figure 1 : Taux de croissance économiques, pays de l’OCDE, 1960 – 2020
La période actuelle représente peut-être une sorte de métanoïa (une conversion ou un tournant) des populations contre l’ensemble des appareils et des mœurs qui ne sont plus en mesure de modeler notre espèce en un animal ayant le travail salarié et le capital pour seul habitat. Après des décennies de taux de croissance en baisse et de reprises de plus en plus dépourvues d’emplois, nous sommes maintenant au cœur de la pire récession mondiale depuis les années 1930 (voir figure 1). Le Bureau américain des statistiques du travail a annoncé « les pires chiffres mensuels du chômage depuis 72 ans que l’agence dispose de données », tandis que la Banque d’Angleterre a averti que « le Royaume-Uni allait connaître sa plus forte baisse de la production depuis 1706 »[6]. Des camarades de Faridabad, en Inde, ont récemment affirmé que « le capital est en retraite désordonnée. Le capital est extrêmement faible. Il vacille »[7]. Cela peut sembler trop optimiste, mais il est maintenant clair que le « type d’homme » qu’une telle économie produit n’est pas un isolat socialement distant et auto-régulé, mais une foule mécontente d’hommes et de femmes prêt·es à se révolter. Iels sont descendu·es dans la rue à une échelle sans précédent et à un niveau planétaire, formant une confusion d’identités disparates réunies par la rage contre la détérioration des conditions de vie, l’aliénation et la police.
1. Une accumulation globale de non-mouvements
Il est encore trop tôt pour prédire les conséquences de la pandémie, mais ce qui est certain, c’est que l’ère des protestations qui a débuté avec le krach économique de 2008 n’est pas terminée. La plupart des soulèvements qui ont donné vie aux rêves d’espoir et de changement de cette année-là, pour reprendre les mots de Barack Obama, ont été écrasés par la répression étatique, ont tourné à la guerre civile ou se sont fossilisés en partis politiques cherchant à administrer les économies stagnantes de notre monde. Pourtant, si l’espoir de changement était naïf, c’est seulement parce que les véritables changements se sont révélés encore plus cauchemardesques avec la montée de l’EI, le coup d’État d’Abdel Fattah al-Sissi et la prolifération d’un nouveau populisme qui a catapulté au pouvoir des figures comme Donald Trump, Viktor Orban et Jair Bolsonaro, mais aussi Emmanuel Macron et Boris Johnson.
Certains ont tenté de comprendre cette évolution, qui va d’Occupy à Trump, au prisme de la dialectique classique de la révolution et de la contre-révolution[8]. Or, il n’est pas du tout sûr que nous assistions à une « contre-révolution », car les Trump de ce monde ne peuvent qu’aggraver les conflits et approfondir les antagonismes, à tel point que le parti de l’ordre se révèle être le parti de l’anarchie[9]. Ces néo-populistes ne peuvent produire aucune hégémonie réelle, mais ne font que diviser les populations[10]. La victoire de Joe Biden montre que la peur du fascisme était exagérée. Mais les Biden de la planète ne peuvent qu’accentuer les schismes qui délégitiment le processus démocratique. S’il y a un développement illibéral, il est plutôt lié aux mesures de plus en plus draconiennes de l’État contre les mouvements contestataires que l’on voit partout dans le monde et qui réclament la souveraineté sur leur vie ainsi que la paix, l’ordre et la sécurité qu’aucun Trump, Biden ou même Sanders ne peut leur donner[11]. L’axe de droite de la figure 2 (en vert) montre une augmentation des luttes antigouvernementales d’environ 11 % par an dans le monde entre 2008 et 2019. L’axe de gauche (en rouge) montre le déclin constant de la légitimité politique depuis 2008, mesuré par la proportion de personnes se déclarant satisfaites de la démocratie[12]. D’autres chiffres disséminés dans cet article affichent les mêmes statistiques classées par région. Clairement reconnaissable dans cette figure, la nouvelle vague de soulèvements qui a émergé en mai 2020 indique que nous nous dirigeons vers une décennie encore plus perturbatrice. L’insurrection ne vient pas : elle est déjà arrivée, se déployant au niveau planétaire avec une intensité qui croît d’année en année[13].

Cela ne signifie pas que nous nous dirigeons assurément vers un point oméga où la révolution devient inévitable. Ces mouvements pourraient simplement indiquer notre entrée dans un monde ingouvernable. Mais nous pouvons aujourd’hui reprendre les mots de Jacques Camatte en 1972 pour insister sur le fait que « [d]epuis mai nous avons le mouvement de production des révolutionnaires »[14]. Partout dans le monde, hommes et femmes, sans abandonner le monde du capital, expriment du moins un réel désaccord avec le statu quo. L’accumulation des protestations depuis 2008 implique une augmentation du nombre de personnes qui ont une expérience de la mobilisation de masse ainsi que de la dissidence pratique et qui sont susceptibles de commencer à « comprendre les exigences existentielles de la révolution »[15]. Ainsi, même si notre période n’est pas révolutionnaire à court terme, elle est fondamentalement perturbatrice et produit un potentiel de rupture avec le mode de production capitaliste. L’accumulation des luttes, et donc d’hommes et de femmes qui ont fait l’expérience par elleux-mêmes de la nécessité de la révolte et peut-être de la révolution, est un préalable à toute discussion sérieuse sur le dépassement du capitalisme.
Il est vrai que la révolution n’est pas une école et que nous ne pouvons pas plus faire confiance à la mémoire collective qu’à nos (mauvais) souvenirs individuels. Mais l’accumulation de la dissidence sociale au cours de la dernière décennie est susceptible de se poursuivre et de façonner de plus en plus le terrain sur lequel les luttes sont menées. Ce n’est pas seulement que les luttes anti-gouvernementales ont déjà restructuré le paysage politique, comme dans les cas de partis tels que le Mouvement 5 étoiles en Italie ou En Marche d’Emmanuel Macron, qui ont organisé des assemblées tout en copiant la rhétorique « ni gauche ni droite » de 2011. Il ne s’agit pas non plus simplement de dire que les mouvements des places, les émeutes de jeunes et d’autres luttes ont jeté les bases de Syriza et Podemos, tout en nourrissant les rêves de Jeremy Corbyn et de Bernie Sanders, parallèlement à la croissance de la droite nationaliste qui semble être la vérité du tournant populiste. Non, nous voulons insister sur le fait que l’accumulation de la dissidence sociale depuis 2008 signale une intensification continue des conflits de classe car les échecs souvent brutaux ou les victoires par ailleurs faibles des mouvements depuis 2011 n’ont simplement pas exorcisé le spectre du changement[16].
Au contraire, l’anarchie de notre époque implique que les énormes manifestations, les émeutes massives et – il faut le souligner – les vagues de grèves[17] constituent la nouvelle normalité. Au Chili par exemple, on peut identifier un fil rouge allant de la revolución pingüina en 2006, lorsque des centaines de milliers de lycéen·nes mirent à l’arrêt le système scolaire, réclamant des cartes de transport gratuites et une réforme de l’éducation, aux soulèvements d’une portée plus grande et violente autour de 2011. Puis, avec encore plus d’intensité, nous avons assisté à un nouveau bond en 2019 lorsque les foules, indignées par la déclaration de guerre adressée à la population par le président Sebastián Piñera, ont inondé les rues, ce qui a finalement conduit à une révision de la constitution[18]. Des trajectoires similaires peuvent être identifiées dans de nombreux pays, comme aux États-Unis, où Occupy Wall Street a été suivi par Black Lives Matter, ce qui a à son tour ouvert la voie cette année au plus grand mouvement social de l’histoire de ce pays[19]. Les énormes soulèvements et les conflits sociaux intenses deviennent une facette tellement normale de notre époque que même la gauche radicale les rejette comme ne répondant pas à ses hautes exigences : ils sont trop libéraux, trop violents, trop passifs, trop informels, trop nationalistes, trop intégrés au statu quo ou trop investis dans les politiques de l’identité.
Dans cet article, nous soutenons que ce à quoi nous assistons en réalité depuis 2008 est une augmentation continue de ce que le sociologue irano-américain Asef Bayat a décrit comme des « non-mouvements », à savoir « l’action collective d’acteurs dispersés et non organisés »[20]. Ces non-mouvements ne sont en aucun cas révolutionnaires en soi. Ils sont plus proches de ce que Camatte a récemment appelé des « révoltes passives » : des expressions subjectives du désordre objectif de notre époque[21]. Ils reflètent surtout la délégitimation croissante de la politique dans un contexte de stagnation et d’austérité prolongées. C’est la combinaison d’une augmentation constante des non-mouvements impliquant désormais un nombre de personnes sans précédent avec le déclin de la légitimité démocratique qui nous permet de décrire la tendance de notre époque comme la production de révolutionnaires sans révolution.
À titre d’exemples de « non-mouvements », Bayat cite les luttes des pauvres non organisés en Égypte, le combat des jeunes en Turquie pour réclamer et réaliser leurs modes de vie désirés, ainsi que la lutte des femmes pour l’égalité de genre dans les sphères à la fois domestique et publique au Chili, en Inde et aux États-Unis. Dans ces luttes, les « pratiques revendicatives » se font sentir « par des actions directes, plutôt que par la pression exercée à l’égard des autorités pour obtenir des concessions – ce que font habituellement les mouvements sociaux conventionnels (comme les mouvements syndicaux ou environnementaux) »[22].
Ces pratiques se drapent souvent des habits de l’identité. De même que les mouvements ouvriers appartenaient à un ordre capitaliste émergent à l’échelle mondiale qui fut structuré par une polarisation du champ politique selon des lignes de classe, de même, aujourd’hui, la fragmentation de classe a façonné l’horizon des non-mouvements. Ainsi, il est aujourd’hui rationnel pour les prolétaires, et de plus en plus pour les membres des classes moyennes, de se tourner vers d’autres catégories afin de définir leur place dans un ordre mondial chancelant. La classe demeure la source principale de nos séparations – la sociologie marxiste de la vieille école est encore à bien des égards pertinente – mais l’appartenance de classe est aujourd’hui calibrée par une multitude de variables telles que l’âge, le sexe, la géographie, la race ou la religion qui agissent autant comme canaux que comme limites réelles des luttes sociales et qui font des politiques de l’identité une véritable expression de la lutte des classes[23].
Comme nous le précisons plus bas, nous ne souhaitons pas rejeter, dénoncer ou, d’ailleurs, exalter la politique identitaire, ni la confondre avec le libéralisme ou le réformisme[24]. Cependant, il faut reconnaître que les non-mouvements ont quelque chose de tout à fait libéral dans la mesure où ils sont contraints d’affronter les tendances illibérales de notre époque. Par exemple, les manifestant·es français·es se battent actuellement contre de nouveaux contrôles draconiens de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, notamment contre une loi qui interdit de photographier la police[25]. On pourrait dire que les non-mouvements ont leur base dans « la tribu des taupes » que Sergio Bologna a dépeinte dans son analyse de l’autonomia italienne des années soixante-dix, mais leur forme peut aussi être vue comme l’indice d’une sous-culturalisation et d’une infantilisation de la société dénoncées autrefois par des critiques comme Christopher Lasch et Jean Baudrillard[26]. En même temps, la confusion des identités affaiblit les théories basées, en l’occurrence, sur une perspective « intersectionnelle » qui considère la classe comme une identité parmi d’autres, car c’est la structure ramifiée de la classe elle-même qui a fait de l’identité la catégorie politique centrale d’un capitalisme en stagnation[27].
En outre, la critique externe des politiques de l’identité rate son objet, car les non-mouvements eux-mêmes présentent une critique immanente des limites de ces politiques dans leur pratique quotidienne. Ils démontrent comment des hommes et des femmes commencent à concevoir la réalité dans des catégories qui dépassent les impératifs de l’économie tout en se heurtant aux conséquences de ce que l’on appelle communément le néolibéralisme. À nos yeux, les politiques de l’identité sont le mode nécessaire de politisation d’un sujet néolibéral pour qui les prédicats de l’identité semblent être simultanément essentiels et inessentiels, porteurs et inhibants. Ces politiques ne peuvent pas être facilement transposées à l’intérieur d’une division stratégique entre le « réel » et le « social », entre la « classe ouvrière » et la « classe moyenne » ou entre ce qui est « révolutionnaire » et « réformiste », car leur opérationnalisation dans la lutte conduit à une confusion des identités, y compris celles créées par la lutte elle-même.
Les soulèvements qui ont suivi le meurtre de George Floyd et le changement d’attitude raciale aux États-Unis désignée à juste titre comme un « grand awokening »[28] sont l’expression de ce processus et révèlent la nature anthropologique des non-mouvements[29]. Ce à quoi nous assistons est, dans une large mesure, une remise en cause des mœurs, des représentations et des modes de reproduction qui ne correspondent plus à un prolétariat désindustrialisé. Pourtant, même celleux qui ont saisi la spécificité des non-mouvements n’ont généralement pas reconnu ce changement. Pour Bayat, les non-mouvements impliquent « une révolution sans révolutionnaires », dans la mesure où ils donnent lieu à des soulèvements explosifs qui ne sont pas « ancrés dans des visions stratégiques ou des programmes concrets »[30]. Pour les critiques des politiques de l’identité, comme Michael Lind, les non-mouvements expriment un approfondissement du capitalisme plutôt que sa domestication ou son dépassement[31]. Pourtant, tous les deux méconnaissent la dynamique interne des non-mouvements. D’une part, nous avons soutenu, contre Bayat, que nous assistons à la production de révolutionnaires sans révolution, puisque des millions de personnes descendent dans les rues et sont transformées par leur déferlement collectif de rage et de dégoût, sans (encore) disposer de vision cohérente pour transcender le capitalisme. D’autre part, contre Lind, nous insistons sur le fait que les non-mouvements indiquent le caractère disruptif de notre époque ; que la stagnation capitaliste implique une crise de la représentation politique en tant que telle et donc aussi la fin des mouvements politiques au sens classique.
Le mouvement social classique, tel que défini par Carl Schmitt, est la médiation entre le peuple inorganisé (ou non organisé) et l’État[32]. Un tel mouvement cherche à organiser ou à mobiliser « le peuple » en tant que catégorie administrative et politique, un peuple qui doit surmonter les identités qui différencient une nation donnée, souvent par une répression violente des intérêts de groupes spécifiques, voire de leur existence même. En revanche, les non-mouvements expriment la dimension antagonique des politiques de l’identité au sens où ils ne peuvent pas constituer un peuple et où ils formulent rarement des revendications politiques ou positives claires. Ou encore, ils produisent un flux sans fin de revendications partielles et parfois contradictoires, semblables en cela à une hydre dont les nombreux appels sont presque impossibles à satisfaire, mais dont la durée de vie peut être courte et violente.
Bien sûr, au sein des nombreux non-mouvements que nous observons dans le monde entier et qui intègrent de larges sections du prolétariat ainsi que des éléments de la classe moyenne en cours de déclassement, nombreux sont ceux qui espèrent se constituer comme un nouveau sujet. Parfois, ils se rallient à des partis, des syndicats et d’autres organisations qui appartenaient autrefois au monde des mouvements et des idéologies mais qui, aujourd’hui, agissent surtout comme un étrange ensemble de sous-cultures. Le nationalisme et le populisme sont certes de retour. Mais, comme l’a noté Gilles Dauvé à propos des Gilets Jaunes, les non-mouvements ont tendance à ne pouvoir se mobiliser que comme une populace, bouleversant le statu quo[33]. Ils révisent les constitutions, renversent les gouvernements et forcent les présidents et les premiers ministres à démissionner (comme on l’a vu récemment au Chili, au Pérou et au Guatemala). Pourtant, puisqu’ils représentent la crise d’un capitalisme en stagnation et que leur objectif est de rendre cette stagnation ingouvernable, les non-mouvements pointent la nécessité d’un universalisme allant au-delà des ruines des mouvements ouvriers[34].
Dans un monde où l’identité est la médiation du rapport de classe, la rage prolétarienne prend la couleur du jaune (comme avec les Gilets Jaunes) ou du noir (comme avec le soulèvement de George Floyd) plutôt que du rouge. Le passage d’un monde de travailleur·ses à une planète de prolétaires – décrite par Gáspár Miklós Tamás[35] – a déplacé la lutte des classes au-delà des formes et discours traditionnels de la politique. Mais notre objectif n’est pas seulement d’insister à nouveau sur le fait que le mouvement ouvrier est globalement affaibli depuis les années 1970, que la composition de classe elle-même se révèle avant tout de manière négative, comme décomposition, et que de nouveaux symboles idéologiques façonnent donc les protestations et reconfigurent les mouvements sociaux. Ce que nous voulons souligner, c’est que la logique du non-mouvement exprime la dimension antagonique et le fondement social des « politiques de l’identité » comme telles, qu’elles soient de droite ou de gauche. Plutôt que de reprendre la litanie des impasses identitaires, il faut montrer comment un statu quo de plus en plus disruptif est nécessairement traversé par des problèmes d’identité, et que toute réflexion sur l’émancipation doit commencer par là.
Nous assistons aujourd’hui à une confusion identitaire généralisée. Nous pouvons le constater non seulement aux États-Unis, où des libéraux diplômés détruisent les statues et ont rejoint les prolétaires noirs et une poignée de miliciens blancs dans un front populaire contre la police, mais aussi en France, où les travailleurs dans les rues chantaient autrefois l’Internationale, mais poussent maintenant le cri de guerre « Ahou ! Ahou ! Ahou ! » (tiré du film 300 de Zack Snyder) tout en brandissant des drapeaux français et en profanant le monument le plus patriotique de France – l’Arc de Triomphe. Au Chili, le slogan « evade » [évadez-vous, NdT], lancé initialement par des lycéen·nes – la véritable avant-garde des soulèvements – contre les hausses des tarifs des transports en commun en octobre 2019, s’est rapidement généralisé en un soulèvement contre l’austérité et la répression policière. Ce dernier a pris pour symbole le drapeau indigène mapuche, plutôt que les drapeaux rouges ou noirs de la gauche[36]. Avec ces chants et symboles confus, les non-mouvements se déclarent du côté des « barbares » contre l’État (ou l’empire) et commencent à remettre en question un mode de production qui ne peut plus produire de welfare ou de prospérité[37]. Ils expriment le besoin d’une nouvelle reproduction de l’existence quotidienne, un besoin qui pousse les hommes et les femmes à se révolter partout dans le monde à une échelle sans précédent.
Il est vrai que ce besoin ne s’exprime souvent que par le manque, voire la faim au sens littéral. Mais comme on le voit avec le retour des émeutes de la faim depuis 2011, il n’y a rien de plus ingouvernable que des hommes et des femmes affamé·es. Et les neuf années de 2011 à 2020 ont été des années de désespoir et de paupérisation accrus. Les luttes de la Puerta del Sol, de Tahrir et de Syntagma en 2011 se sont rapidement éclipsées. Cependant, l’élan qui les animait n’a pas disparu, il a simplement été remplacé par la fureur et le désespoir encore plus forts des Gilets Jaunes ou des soulèvements au Chili, en Équateur, au Mexique, et maintenant au Pérou et au Guatemala. Par ailleurs, les États et les économies capitalistes se sont révélés impuissants lorsqu’ils ont été appelés à satisfaire les besoins croissants, et toujours plus explosifs, des non-mouvements.

2. Confusion et ingouvernabilité
Une caractéristique unifiante des non-mouvements est le fait qu’ils luttent sur le terrain d’un capitalisme stagnant (voir figure 1 ci-dessus). De la même façon que la stagnation d’un capitalisme et d’une industrialisation de son propre cru a conduit à la chute de l’Union Soviétique, l’ère de stagnation et de désindustrialisation en cours a conduit à un affaiblissement de la social-démocratie européenne, d’abord par un virage vers la droite, ensuite à travers sa pasokification[38]. Ce processus s’est déroulé en parallèle de la montée de partis illibéraux et, depuis 2008, de sévères politiques d’austérité. En réaction à cela, nous avons vu dans les non-mouvements l’aspect perturbateur à la fois des valeurs libérales et de la défense de besoins de base pour un prolétariat appauvri et de plus en plus divisé en fragments nettement distincts. Mais cette fragmentation n’implique pas nécessairement une division. Au contraire, elle unit souvent les individus dans de réelles mais faibles alliances telles que celle des « 99% », ou encore la mosaïque de groupes qui se sont réunis dans l’estadillo social [soulèvement social, NdT] du Chili. Ici, le mouvement s’est tourné vers la chanson de Victor Jara « El derecho de vivir en paz » – « Le droit de vivre en paix » – non par identification avec le héros de la chanson (Hồ Chí Minh), mais parce que la paix et même l’ordre étaient devenus une revendication radicale dans un monde de plus en plus catastrophique.
Le non-mouvement ne désigne pas simplement l’explosion d’émeutes et d’occupations de places dans lesquelles classes moyennes privées de leurs droits et lumpenprolétariat, habitant·es des banlieues et de l’arrière-pays, islamistes et féministes, hommes de milices et noirs pauvres, peuvent a minima joindre leurs armes contre un ennemi commun et ainsi commencer à défaire leur séparation. Il désigne aussi un répertoire d’habitudes et d’expériences, une politique du quotidien qui rend possible de telles ruptures spectaculaires et de tels débordements violents. Le fait que la majorité des personnes impliquées dans les révoltes pour George Floyd soient blanches et que la mort de Floyd ait pu devenir le catalyseur d’un soulèvement plus large contre Trump révèle des changements sociologiques et démographiques qui ont rendu possible la confusion des non-mouvements et qui vont au-delà des soulèvements eux-mêmes[39].
Même les organisations formelles qui, au moins pendant une certaine période, sont parvenues à représenter une réalité sociale particulière, doivent s’adapter à la logique des non-mouvements. Nous voyons cela avec les syndicats français, d’abord hostiles aux Gilets Jaunes, qui ont su tirer parti de ce non-mouvement en septembre 2019 en lançant la grève contre la réforme des retraites du gouvernement Macron[40]. En ce sens, les non-mouvements sont devenus la forme hégémonique de lutte, mais seulement dans la mesure où ils sont le reflet d’une crise plus large de la représentation. Les non-mouvements peuvent ainsi être décrits comme des processus destituants plutôt que constituants[41]. Mais contre ceux qui fétichisent la destitution comme une voie positive ou révolutionnaire, nous tenons à insister sur le fait qu’aujourd’hui tout pouvoir est devenu destituant au sens où non seulement le cours du capital, mais aussi les désirs et les besoins des populations, font du gouvernement de l’ordre politique une tâche de plus en plus difficile.
Cette ingouvernabilité peut aussi être vue dans la formation des non-mouvements comme une réponse à une gouvernance draconienne ou irrationnelle, en particulier comme une réponse à la violence policière. L’un des quelques points communs entre les ouvrier·es, les étudiant·es, les chômeur·ses, etc. dans n’importe quel pays ces dernières décennies, c’est le fait d’être victime de politiques vénales qui allouent les ressources déclinantes de l’État aux élites intérieures. Bien qu’une telle corruption puisse en tout point être une source de colère populaire, cette colère est exacerbée maintenant que les politiques publiques en sont réduites à se battre pour le partage d’un gâteau qui ne grandit pas ou qui se fait de plus en plus petit et que les appels courants à se serrer la ceinture rendent toute injustice dans ce partage d’autant plus intolérable. Comme nous le soutenions dans « The Holding Pattern », une rage diffuse contre les injustices flagrantes d’un régime de crise administré par une classe politique corrompue et incompétente a largement défini la vague croissante de lutte de classes et de mobilisations populaires partout dans le monde depuis 2008. C’est pourquoi, comme nous le verrons, les non-mouvements d’aujourd’hui se sont souvent focalisés sur la police en tant que figure brutale de la corruption et de l’injustice ; c’est aussi en partie la raison pour laquelle l’antiracisme est devenu une force mobilisatrice aussi centrale aux États-Unis[42].
Toutefois, ce à quoi tout mouvement de masse se heurte, c’est la capacité limitée à avancer au-delà d’une unité négative (une unité contre le racisme, la police, les élites), pour établir une force sociale ou politique qui soit positive et créative. Les problèmes constants des politiques de l’identité sont symptomatiques de cette limite : l’incapacité pour un mouvement de lutte de s’incarner et de se soutenir lui-même étant donné l’atomisation et la fragmentation de ses composantes. À un moment ou à un autre, chaque mouvement se heurte à et se brise sur ces fragments. Les non-mouvements tendent simultanément à l’attaque et au retrait d’un État qu’ils perçoivent comme étant en retrait d’eux. En ce sens, l’appel étasunien à « defund the police » [définancer la police, NdT] reflète une tendance plus générale – qui est à bien des égards une avancée – à ne plus lutter pour prendre le contrôle de l’Etat, mais à simplement affronter l’appareil d’Etat : l’austérité contre l’austérité.
Alors que les mouvements traditionnels formaient autour d’eux une structure idéologique et des communautés réelles relativement stables, tels que les syndicats, les partis de masse et les États socialistes, ceux qui se sont répandus à travers le monde depuis 2008 expriment les désirs collectivisés de populations de plus en plus atomisées. Or, bien que la fin de l’ère des mouvements soit en un sens la fin de l’idéologie, cela n’implique pas pour autant, comme nous l’avons vu, la fin de l’identité. Au contraire, les identités se multiplient dans une économie de plus en plus sujette au racket et à la sous-culturalisation où, comme le défend Tyler Cowen, c’en est fini avec la moyenne[43]. Il n’y a plus de centre stable mais au contraire une structure de classe hautement segmentée qui reconfigure le terrain des mouvements classiques comme le fascisme ou la social-démocratie. Si les politiques centristes de Clinton et Blair dans les années 1990 et la montée des politiques de l’identité dès les années 1970 avaient déjà signalé ce changement, la séquence qui débute en 2008 révèle au contraire une augmentation de la confusion des identités.
Les non-mouvements sont, comme nous l’avons souligné, l’expression subjective d’un désordre plus général qui prend racine dans la stagnation capitaliste. C’est la quantité même de manifestations et d’émeutes – leur normalisation croissante – qui distingue, par exemple, notre époque de la période altermondialiste. C’est pourquoi nous disons que notre époque est marquée par la production de révolutionnaires à une échelle globale. Femmes et hommes issu·es de tout le spectre de l’idéologie politique et de la stratification identitaire se confrontent à l’ordre dominant avec tout leur dégoût, leur peur et leur rage, et revendiquent toujours plus leur droit « d’échapper » au coût insupportable de la vie capitaliste. Ce sont des révolutionnaires sans révolution, mais dans leur affrontement avec la reproduction capitaliste aussi bien que dans leur faim de communauté, les non-mouvements expriment un conflit potentiel avec la logique du capital en tant que telle.
Dans un tel contexte, le politique – dans sa forme classique d’inimitié et de division – revient en force. Les politiques de l’identité d’aujourd’hui annoncent un retour au politique plutôt que la naissance d’une ère post-politique (comme beaucoup de critiques de gauche des politiques de l’identité l’ont affirmé). Mais le politique ne peut plus produire une stabilité significative. Il tourne la population contre elle-même et conduit les nations, sinon à des guerres civiles, du moins à des conflits plus sévères et des divisions plus profondes. Bien que l’aporie de l’identité exprime une perte de ce que l’on pourrait appeler la communauté, nous sommes loin d’observer un désir de retour à l’horrible monde de la social-démocratie et du fascisme. Au contraire, nous tendons à voir un désir de communauté fondé sur les revendications libérales exprimées par les non-mouvements. Aussi étrange que cela puisse paraître, le libéralisme et la conscience sociale [wokeness, NdT] sont devenues des forces perturbatrices à une époque où de larges sections de la gauche sont devenues de plus en plus conservatrices, embrassant le populisme nationaliste qui nourrit la droite.
Pour ces raisons, nous tenons à rassurer les lecteur·ices inquiet·es qui se poseraient la question suivante. Comment s’assurer que les désordres de notre époque ne vont pas simplement nous pousser plus profondément dans un ordre autoritaire qui ne fera qu’élargir le gouffre entre libéralisme et démocratie dont nous sommes aujourd’hui les témoins ? Le printemps arabe n’a-t-il pas conduit à la dictature et à la guerre ? Le mouvement Occupy n’a-t-il pas présagé Trump ? Les luttes contre la hausse du prix des transports au Brésil n’ont-elles pas posé les bases des protestations contre la corruption qui ont mené Bolsonaro au pouvoir ? Les logiques identitaires au fondement de luttes partout dans le monde ne nous poussent-elles pas toujours plus profondément dans le fascisme ? Les forces illibérales et fascistes gagnent du pouvoir, mais il serait absurde d’attribuer cette montée en puissance aux non-mouvements, puisqu’ils sont eux-mêmes les expressions du désordre de notre époque que les populistes de gauche et de droite cherchent à exploiter. Qui plus est, le contrecoup culturel [cultural backlash, NdT] qui nourrit l’aile droite du populisme était déjà présent depuis des décennies, et remonte donc à bien avant la crise de 2008 – le premier moteur des non-mouvements[44].
En outre, la fermeture des frontières, le virage nationaliste et le durcissement des politiques migratoires dans des pays dirigés par des gouvernements de gauche comme la Suède et le Danemark révèlent, couplés à la victoire du populisme de droite dans des pays comme la Pologne et la Hongrie, une panoplie de développements illibéraux en des endroits qui n’ont pas été déchirés par des non-mouvements. Laissé à lui-même dans ce monde de productivité stagnante et de désindustrialisation, l’État capitaliste contemporain ancre trop volontiers la citoyenneté dans la langue, la culture et le travail. C’est pourquoi des masses grandissantes de femmes et d’hommes partout dans le monde sont mobilisées par des valeurs libérales et démocratiques et progressivement amenées à détester une police à qui l’on délaisse le sale boulot du maintien d’un ordre ingouvernable[45].

3. Un nouveau désordre mondial
Bayat compare l’émergence des non-mouvements à ce que Timothy Garton Ash, en référence aux mouvements est-européens des années 1980 et 1990, a qualifié de « refolutions » : des soulèvements violents pour des réformes libérales[46]. Ces mouvements furent en effet d’importants précurseurs, mais ce pour des raisons que ni Ash ni Bayat ne reconnaissent. Ce que Ash n’a pu voir, c’est que ces mouvements répondaient à un effondrement de l’empire soviétique qui annonçait une crise du monde industriel moderne[47]. Depuis, l’Ouest n’a fait que rattraper les anciens pays communistes par sa propre stagnation et désindustrialisation (voir la figure 1). Dans notre ère, la prolifération de soulèvements qui disparaissent souvent aussi vite qu’ils sont apparus exprime l’état disruptif d’un ordre économique mondial en stagnation séculaire et l’effondrement des rapports géopolitiques de la période de l’après-1945.
Un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le marxiste italien et leader sectaire et têtu Amadeo Bordiga écrivit le « Traciato d’impostazione », un essai tellement plein d’exagérations rhétoriques outrageantes et de jargonnage que, lorsqu’elles apparaissent, ses vraies intuitions brillent comme des gemmes dans la boue[48]. Bordiga cherchait à clarifier la définition d’un mouvement révolutionnaire à un moment où le « démo-capitalisme » régnait en maître et où la théorie communiste elle-même avait perdu son rôle original de science radicale et expérimentale prédisant le changement social. Pour ce sectateur révolutionnaire, la trinité de l’antifascisme, de la démocratie et in fine du marxisme était devenue le principal obstacle à toute perspective communiste digne de ce nom. À présent, « des mouvements ouvertement conservateurs des institutions bourgeoises osent encore se dire partis du prolétariat », regrettait-il[49]. La victoire des Alliés en 1945 n’avait pas seulement obscurci les perspectives de guerre révolutionnaire en Europe ; elle avait aussi transformé l’imaginaire communiste originel en un imaginaire démocratique qui, ultimement, aliène le prolétariat du mouvement ouvrier. Ainsi, bien avant que Thomas Piketty n’ait averti des conséquences de la « gauche brahmane »[50], Bordiga déclarait que le marxisme était simplement devenu une idéologie de managers de la classe moyenne ou, pire, une simple défense du libéralisme et de la démocratie[51].
Bordiga aurait peut-être été d’accord avec Mario Tronti qui insistait sur le fait que « le mouvement ouvrier n’a pas été vaincu par le capitalisme, il a été vaincu par la démocratie ». Cependant, il avançait que le mouvement communiste lui-même avait posé les fondations de cette défaite démocratique. Sa célèbre critique de l’antifascisme et ses digressions contre-factuelles sur la question de savoir pourquoi une victoire de l’Axe aurait pu entraîner une guerre civile et donc une révolution peuvent nous sembler étranges aujourd’hui[52]. Malgré tout, le diagnostic de l’après-guerre par Bordiga peut nous aider à comprendre la croissance des non-mouvements qui, souvent, luttent pour des valeurs apparemment libérales et qui exercent une pression sur l’État par le bas, tandis qu’on voit parallèlement une montée de la droite populiste reflétant une crise des classes managériales. Notre temps est traversé par des désordres venant autant d’en haut que d’en bas, et cette crise semble miner les bases de la longue paix (la Pax Americana) qui avait interrompu le développement révolutionnaire de l’époque précédente.
L’ascension de Trump, de Bolsonaro, de Duterte, de Modi, d’Orban, de Poutine, et même de Macron révèle que le statu quo est disruptif, que nous assistons à l’émergence de ce que David Ranney a appelé « un nouveau désordre mondial »[53]. Comme on a pu le voir récemment en Pologne et aux États-Unis, les élections sont de plus en plus souvent gagnées ou perdues avec de très faibles marges par les « libéraux » ou les « conservateurs », l’âge et le niveau d’éducation étant en général plus décisifs que l’appartenance de classe dans la formation des loyautés de parti[54]. Les Trumps de ce monde montent les populations, et même les classes dirigeantes, contre elles-mêmes et révèlent que le combat pour la démocratie libérale peut aisément être radicalisé, de la même manière que les révolutionnaires peuvent aisément être cooptés en tant que chemises noires prêtes à combattre à coup de pierres, de boucliers et de parapluies pour le statu quo démocratique. Le soulèvement après la mort de George Floyd est ainsi brièvement devenu un conduit pour la résistance à l’autocratie des nouveaux leaders populistes à travers le monde. Or, sous l’opposition entre « libéral » et « conservateur », il est possible d’identifier ce que Bordiga pourrait qualifier de tendances « anti-formistes », escaladant les conflits et remodelant la forme sociale de l’ordre présent.
En analysant conflits sociaux et institutions sociales, Bordiga rejette des expressions lourdement connotées telles que « conservateur », « progressiste », ou même « révolutionnaire »[55]. La tâche du marxisme, que Bordiga qualifie de « science de l’espèce », est de comprendre chaque mouvement social ou institution dans leurs dimensions « conformiste », « réformiste », ou « anti-formiste »[56]. Un mouvement conformiste est une force qui cherche à maintenir « intégralement les formes et les institutions en vigueur, et interdisent toute transformation, et se réclament de principes immuables »[57]. Les mouvements réformistes sont « ceux qui, tout en ne désirant pas le bouleversement brusque et violent des institutions traditionnelles, se rendent compte de la pression trop forte que les forces productives exercent sur elles et préconisent des modifications graduelles et partielles de l’ordre existant »[58]. Les mouvements anti-formistes, au contraire, impliquent « l’attaque aux vieilles formes, et qui même avant de savoir théoriser les caractères du nouveau régime, tendent à briser l’ancien, provoquant la naissance irrésistible de formes nouvelles »[59].
Si l’on devait adopter la typologie de Bordiga, nous avancerions que c’est cette dernière catégorie que l’on voit croître chaque année, alors que de plus en plus de personnes expriment leur frustration avec le statu quo. La prolifération des non-mouvements reflète l’instabilité d’un monde post-industriel et peut ainsi être qualifiée d’« anti-formiste ». Ces explosions peuvent malgré tout facilement se transformer en mouvements réformistes voire conformistes si, paradoxalement, ils s’avéraient incapables d’éviter les tendances à la guerre civile et à la violence nihiliste contenues dans une telle instabilité. Le rêve de Bordiga d’une guerre révolutionnaire est devenue (ou a peut-être toujours été) une rêverie naïve incapable de produire une base pour une société sans classes. Les guerres civiles en Libye et en Syrie révèlent avec quelle facilité les guerres transforment les organisations révolutionnaires de masse en rackets militaires à la recherche d’argent, d’armes et de recrues[60].
Même si l’affirmation de la guerre par Bordiga était naïve, sa critique de la démocratie mérite toujours une attention sérieuse. Le développement de 2008 à 2020 montre que les non-mouvements trouvent leur limite dans les deux faces de Janus de la répression et de la représentation (ou, dans leur forme la plus aboutie, dans la guerre et la démocratie). Les deux peuvent être combinées afin d’affaiblir les non-mouvements, par exemple en les liant à l’État ou en les enracinant dans des partis formels ou des syndicats. De telles défaites naissent des besoins des non-mouvements eux-mêmes, de leur incapacité à dépasser leurs limites immanentes. Mais si l’accumulation des luttes anti-gouvernementales continue de croître, comme elle le fait annuellement depuis 2008, il deviendra nécessaire pour ces non-mouvements de développer leur critique instinctive de la répression et de la représentation en une critique impitoyable de la guerre et de la démocratie.
Une stratégie cherchant à libérer la logique anti-formiste des non-mouvements aurait à provoquer une discussion des problèmes des médiations politiques et donc une défense de ce qui est souvent qualifié d’anti-politique[61]. Si les soulèvements veulent éviter les deux pièges de la guerre et de la démocratie, une perspective stratégique est nécessaire. Celle-ci remettrait en cause les divisions identitaires et idéologiques au sein du prolétariat, y compris entre travailleur·ses et classes moyennes. On peut avancer que les conséquences économiques des confinements qui commencent déjà à forcer les personnes à se rassembler en un front uni contre une économie stagnante et déclinante contribueront encore plus à la confusion des identités déjà prévalente et visible dans de multiples endroits du monde. De la même manière que les Gilets Jaunes rassemblèrent hommes et femmes des hinterlands, certainement bien souvent conservateurs ou de droite, avec des étudiant·es gauchistes, des membres insatisfaits des classes moyennes et des prolétaires des banlieues, le ralentissement et la fermeture plus récente de l’économie formeront la base d’une encore plus grande confusion[62]. Parfois, l’incertitude générée par ce mélange peut paraître effrayante, et c’est peut-être la raison pour laquelle les jeunes de Naples manifestant contre les conséquences des confinements ressentaient le besoin de déclarer que « nous sommes des travailleurs, pas des fascistes ». Comme Perry Anderson nous en avertit en 2017, une des raisons de la victoire du système est peut-être que la peur, et non pas la colère, mobilise la gauche[63]. Mais les non-mouvements ont bravement affronté la répression policière, les confinements et la peur du coronavirus simplement en rassemblant par milliers des personnes dans les rues. Ce questionnement de la normalité capitaliste, marquée par l’hystérésis[64] et son catastrophisme attenant, sera encore plus important alors que l’économie continue de stagner et que les non-mouvements sont poussés dans une direction plus révolutionnaire[65].
Une réflexion stratégique nécessiterait donc également d’envisager les moyens par lesquels les non-mouvements pourraient éventuellement saisir le contrôle de la stagnation/désindustrialisation capitaliste pour libérer les fondements d’un nouveau monde contenu en eux. Il s’agit là de quelque chose qui ne les intéresse pas encore et dont ils ne sont pas non plus capables puisque cela menace leur spontanéité et, en un sens, leur passivité constitutive. Mais afin de survivre, ces non-mouvements doivent inspirer la création de formes-de-vie capables de vivre pour quelque chose de plus que l’argent et le travail salarié. Cela impliquerait un nouvel usage des moyens de production comme outils contre le capital – des outils qui non seulement nous libèrent du travail, mais qui nous permettent aussi de partager le travail nécessaire pour assurer que la vie puisse devenir quelque chose de plus que la simple survie[66]. Comme les « Angry Workers of the World » l’ont récemment souligné, le but immédiat devrait être que tout le monde « travaille moins à salaire plein, en accord avec le niveau que la productivité sociale a atteint »[67].
Cependant, les populations prêtes à vivre une telle existence communale, là où l’économie est gouvernée par une désindustrialisation à la fois rendue possible et empêchée par le capitalisme, ne pourront être produites que par la forme – la formule est délibérément provocatrice – d’un brassage interclassiste si caractéristique de notre période. Prolétaires, étudiant·es et classes moyennes sont jeté·es ensemble dans la rue. Des ouvrier·es avec un pouvoir stratégique essentiel, des technicien·nes avec le savoir-faire pour remodeler la face industrielle du monde, de tels groupes seront cruciaux pour la transcendance du capitalisme ; or, l’affirmation de leur pouvoir sera source de nouvelles fragmentations de classe à moins qu’ils ne puissent aller au-delà de leurs intérêts sectoriels et converger avec des segments des masses précaires ou sans-travail de ce monde. Ainsi, bien qu’il est nécessaire d’avoir des « racines » dans la vie prolétarienne, créant de cette manière des liens internationaux entre ouvrier·es en lutte, il est tout aussi important de lier les lieux de travail avec les non-mouvements dont la croissance déborde les intérêts sectoriels et mêmes les frontières de classe[68]. Un échec à ce niveau implique de reproduire les divisions qui stratifient les classes en différents segments dotés d’intérêts distincts et bien souvent antagoniques. Quelque chose de cette oscillation – qui tout à la fois rassemble les gens dans de fragiles alliances, et crée en même temps des divisions significatives au sein du prolétariat mondial – est sans doute typique de notre période de Béhémoths décrépits et de Léviathans échoués.
Aujourd’hui, un virus n’est pas loin d’avoir mis la machine civilisationnelle à l’arrêt. Il a révélé l’incapacité de l’État capitaliste à protéger la vie sans arrêter une économie qui n’est pas loin d’être devenue inséparable de l’existence humaine en tant que telle. Étant donné que nous ne cherchons pas à et que nous ne pouvons pas recréer la machine de croissance qui était au fondement de la social-démocratie, la seule voie en avant est, comme les bordiguistes l’affirmaient en 1953, de se battre pour un « désinvestissement du capital » qui soit radical. Pour Bordiga, ceci signifiait que les « moyens de production se voient assignés une proportion plus réduite relativement aux biens de consommation » et que l’on prépare un « plan de sous-production, c’est-à-dire la concentration de la production sur ce qui est nécessaire »[69]. Une telle combinaison de désinvestissement et de sous-production s’est certainement avérée réalisable pendant les confinements (de même que la stagnation séculaire de l’économie). Néanmoins, affirmer un contrôle sur le déclin capitaliste requiert d’adresser les questions sociales qui produisent les convergences étranges entre différentes strates sociales au sein des non-mouvements.
Les manifestations de lycéen·nes au Chili contre une augmentation du prix des transports de 30 pesos sont devenues un mouvement de masse contre les trente années de la constitution néolibérale qui a été modifiée en octobre 2020 : « No son 30 pesos son 30 años ». Une manifestation contre une augmentation du prix de l’essence en France est vite devenue une large mobilisation contre l’inégalité et les mesures d’austérité imposées par un gouvernement autocratique. Quand les luttes s’intensifient et que beaucoup de demandes initiales sont satisfaites – bien souvent par le simple fait que la répression pousse de plus en plus de monde dans les rues par dégoût pour les violences policières – les non-mouvements révèlent un point d’unité dans le fait qu’ils sont tous produits, ou au moins conditionnés, par la stagnation économique. Dans ce contexte, la confusion identitaire des non-mouvements peut les aider à devenir plus conscients de ce qu’ils sont : des expressions subjectives du déclin économique. Nous avons défendu que la conscience de classe, dans la période présente, ne peut être que la conscience du capital[70]. Aujourd’hui, ceci n’implique à son tour rien de plus que de révéler, avec une acuité croissante, que le capitalisme est sans avenir. Et quand les Gilets Jaunes affirment « fin du monde, fin du mois [même combat, NdT] », ils n’expriment pas seulement ce qu’ils voient comme la dimension apocalyptique de notre temps, mais affirment la fin de ce monde et de cette vie comme le prérequis nécessaire à la création d’un nouveau monde et d’une nouvelle vie.

4. Nous sommes tou·tes des bâtard·es
Nous avons vu que la foule cherchant à détruire l’Arc de Triomphe en agitant le drapeau tricolore et en chantant la Marseillaise, tout comme les statues renversées, de façon parfois aveugle, aux États-Unis, indiquent une tendance plus large que l’on ne peut désigner que comme relevant de « l’anti-politique »[71]. Or, comme dans beaucoup de non-mouvements contemporains – des Printemps arabes aux Gilets Jaunes en passant par Black Lives Matter – la rage à l’égard de la police vient souvent remplacer une haine plus générale de la politique. Ceci ne s’explique pas simplement par le fait que la police serait une manifestation immédiate de la répression de l’État, un adversaire tactique dans la rue. Si les statues sont des symboles morts de l’État, la police est son symbole vivant, et c’est d’autant plus vrai dans une ère d’austérité et de pandémie meurtrière. L’État s’étant montré incapable de protéger la population contre une crise à plusieurs visages, il devient évident que son premier rôle sera celui de contenir les retombées de ces crises-là en disciplinant la population. L’État est ainsi réduit à sa fonction policière.
Le fameux slogan français « tout le monde déteste la police » pourrait indiquer une délégitimation plus globale de l’État moderne, dont le prédécesseur de l’Antiquité, la polis, fournit à la fois le nom et la forme à la « police ». Les violences policières, la mise en quarantaine, la distanciation sociale et les mesures de confinement (ou, d’ailleurs, l’empressement des politiciens à rouvrir l’économie) déclenchent une nouvelle vague de dissidences sociales reflétant une crise aiguë de la représentation politique. Bien évidemment, tout le monde ne déteste pas littéralement la police. En Europe occidentale, on trouve souvent des taux remarquables de confiance accordée à la police, même si ceux-ci varient selon la classe sociale, l’âge, la nationalité et la race[72]. Alors que la police est globalement méprisée dans les régimes autocratiques, des mesures récentes d’austérité lui ont accordé une forme particulièrement dégénérée et violente dans certaines démocraties néolibérales où elle est devenue le premier représentant de l’État dans nombre de communautés pauvres et ouvrières[73]. Ainsi, la plupart des sondages contemporains indiquent une chute de la confiance accordée à la police et nous pouvons observer des signes que la police devient de plus en plus la cible de haines venant non seulement des prolétaires et des minorités raciales, mais aussi de certains segments de la petite bourgeoisie et même d’individus plus aisés.
L’une des raisons est certainement l’augmentation du nombre de violences policières et la conscience accrue de celles-ci. La police est universellement brutale, son travail prédispose à la sélection des personnalités autoritaires qu’elle encourage, et le rôle de la police dans la protection de la richesse et de la propriété en a toujours fait, selon les termes d’Orwell, l’ennemi naturel de la classe ouvrière[74]. Cependant, la brutalité policière peut être amplifiée par la responsabilité accrue de la police dans l’imposition de l’austérité d’abord, et des confinements par la suite. En l’absence d’engagement en faveur de l’augmentation du nombre des policiers, les agents individuels dont le temps et les ressources sont limités peuvent se montrer plus enclins à user de punitions sommaires et exemplaires. Dans tous les cas, la fonction d’endiguer et de discipliner la population qui se révolte contre ces mesures rend inévitable une accentuation de la brutalité policière et cette augmentation-là, à son tour, mènera inévitablement à une hostilité plus grande de la part des victimes de violences policières, mais aussi de la part de leurs spectateur·ices (réel·les ou virtuel·les).
De plus, l’expérience d’être détesté·e peut elle-même produire une identité sous-culturelle au sein de la police pas si différente de celle que partagent ses adversaires : il s’agit du sentiment d’appartenir à une minorité assiégée (« les vies bleues comptent »[75]). Celui-ci pourrait amplifier la tendance à l’accentuation de la brutalité des policiers. Leur conscience du fait qu’ils ne sont respectés ni par les prolétaires qu’ils sont censés discipliner, ni par les riches qu’ils protègent, peut conduire au cynisme. Ainsi, même s’il est vrai que « tous les flics sont des bâtards » [All Cops Are Bastards, NdT], il est tout aussi vrai qu’en réagissant à leur sentiment d’abandon (par les politiciens et les élites) et leur illégitimité (aux yeux de celles et ceux qu’ils sont censés discipliner), les flics commencent à se voir eux-mêmes comme des bâtards, des enfants illégitimes d’une société malade, et tirent un plaisir malsain de la provocation qu’ils lancent à l’égard des normes « civilisées », en brutalisant impunément[76]. Tel Edmond dans Le Roi Lear, ils « se rangent du parti des bâtards »[77].
La possibilité qu’une fraction grandissante de la population s’associe avec cette brutalité éhontée pose un vrai risque de fascisme qui déclencherait une réaction antifasciste et anti-police compréhensible. Néanmoins, comme Camatte le soulignait déjà en 68, « Il est dangereux de déléguer toute l’inhumanité à une fraction du corpus social et toute l’humanité à une autre »[78]. Pour Camatte, le risque ne réside pas uniquement dans le fait de s’opposer au principe fondamental de l’humanisme (et donc du communisme), mais aussi dans le fait que « cela empêche toute possibilité de miner le corps de police »[79]. Diriger nos attaques vers la police relève, selon Camatte, « d’un rituel dans lequel cette dernière joue le rôle de l’éternel vainqueur »[80]. Plutôt que de considérer que se heurter à la police est la tactique insurrectionnelle par excellence, nous devons réfléchir de manière stratégique sur les manières de la mettre en échec en la contournant, voire même d’exploiter les contradictions potentielles au sein du camp ennemi[81].
Une critique contemporaine de la violence, adaptée à une époque où la guerre ne peut amener autre chose qu’une défaite, ne nécessite pas la retraite ; elle peut en revanche indiquer le besoin d’une intelligence révolutionnaire, comme celle des masses de femmes qui entourent la police en Biélorussie, ou bien le « mur des mamans » [Wall of Moms, NdT] protégeant la ligne du front à Portland. Cependant, ce serait une erreur de surestimer l’importance des tactiques et des plans élaborés en discutant des actions spontanées de millions de femmes et d’hommes. Le meilleur moyen de désarmer la police et les forces de sécurité passe par l’escalade (souvent violente) des manifestations. Ce ne sont pas les émeutes qui mettent en danger le déploiement continu des luttes (des commissariats brûlés peuvent mobiliser des millions de personnes, comme on l’a vu suite au meurtre de George Floyd), mais la militarisation du conflit. Toutes les formes de violence professionnalisée empêchent les non-mouvements de croître, et ce précisément parce que ces derniers agissent sous la forme d’une masse de révolutionnaires non-professionnels cherchant à dépasser les scissions au sein du camp des travailleur·ses qui sapent le potentiel émancipateur des manifestations.
En fin de compte, les non-mouvements délégitiment non seulement la police mais aussi tout ce monde dans lequel la politique se trouve réduite à la fonction policière. Ils sont capables d’affronter la police de la manière la plus efficace dès lors qu’ils destituent le système dans son entièreté. Comme on l’a vu de nombreuses fois récemment, cela peut vouloir dire que l’armée se mobilise, soulevant le risque d’une guerre civile. Ce spectre-là ne peut être dissipé qu’à travers la désertion. Tout comme les soldats doivent déserter (ce qui, traditionnellement, constitue une condition sine qua non du succès révolutionnaire), les défections parmi la police et le personnel de sécurité, comme dans le cas de la Révolution des bulldozers en Serbie en 2000, seront de plus en plus nécessaires afin de transcender l’inimitié qui renverrait les non-mouvements aux catégories, aux identités et aux rôles qu’ils ont commencé à dépasser dans leur confusion[82].
Peut-être qu’en haïssant la police, nous détestons ce que nous sommes devenu·es, et ce non au sens où nous détesterions « les policiers dans nos têtes » [the policemen in our heads, NdT], mais au sens où nous sommes devenu·es dépendant·es de cette même infrastructure austère qui, en dernière instance, est soutenue par la police. Or, l’exclusion de cette infrastructure, que Ruth Gilmore décrit comme un « abandon organisé », conduit à une mort prématurée – et pas seulement aux mains de la police[83]. Nous sommes, d’une certaine manière, tou·tes devenu·es des « bâtards ». Mais si c’est bien le cas, il est clair que définancer la police ou l’abolir ne résoudrait pas ce problème plus profond.
Le mouvement de « définancement » s’imagine que si l’argent alloué à la police et les prisons était dédié à d’autres programmes, il pourrait résoudre les problèmes sociaux sous-jacents que la police est censée gérer ou contenir. Or, c’est ignorer le fait que la police et les prisons sont déjà le programme social le moins cher, l’expression même de l’austérité ; et aideront donc peu à la redistribution des richesses[84]. « Abolir » la police, en pratique, veut souvent dire qu’on la remplace par n’importe quelle autre institution (par exemple, les médiateurs professionnels, les travailleurs sociaux ou la sécurité privée) qui exhibera probablement des pathologies similaires ou en lien avec celles de la police[85]. Pourtant, même les visions les plus radicales de l’abolition tendent à buter contre les problèmes sociaux réels que les États capitalistes assignent à la police. En mettant les victimes en position de contrôle sur la punition et la responsabilité, on pourrait reproduire le biais punitif du régime carcéral actuel[86]. Cependant, même si l’appel à une réduction des dommages et à des réparations est entièrement justifié, il doit être clair que la réalisation de celles-ci dépasserait de loin ce qu’une société capitaliste pourrait permettre (sans même parler de leur coût). En effet, cela impliquerait de reconnaître qu’une remise en état n’est pas la même chose qu’une réparation (annuler ses dettes, c’est sortir des relations sociales en rachetant ses parts) et que le capitalisme fait de nous tou·tes des bâtards (même si personne n’est que ça)[87].
Il n’est peut-être pas si étonnant que le slogan appelant à « définancer la police » ait pris de l’ampleur dans un pays qui possède non seulement des forces de l’ordre particulièrement meurtrières, mais aussi une tradition de se faire justice soi-même[88]. Le terme « d’abandon organisé » devrait nous rendre attentif·ves au fait que lorsque la politique est réduite à la police, l’absence de la police peut être tout aussi politique que sa présence. On peut trouver plusieurs exemples de ce genre de politique, de la présence d’une absence, non seulement dans l’imaginaire américain du Wild West, mais aussi dans nombre de situations de guerre (à la fois civile et non-civile) ainsi que dans certains quartiers appauvris abandonnés par l’État, tels que les favelas brésiliennes largement administrées par des bandes armées. On peut aussi trouver des exemples moins connus des États américains du Sud à l’époque des lois ségrégationnistes de Jim Crow où la police refusait souvent d’entrer dans des quartiers noirs sauf si des Blancs déclaraient avoir été les victimes de crimes commis par un·e Noir·e[89]. Plus récemment, nous en avons eu un aperçu dans des « zones libres de la police » déclarées dans certaines villes américaines, telles que le CHAZ de Seattle[90], lequel, s’il était considéré comme une nation indépendante (comme certain·es des participant·es ont pu le suggérer), aurait le taux d’homicide le plus élevé du monde[91]. Les quartiers sud de Chicago, dont le taux de meurtre a brièvement atteint les niveaux du Brésil cet été, nous donne une vision plus claire de ce à quoi pourrait ressembler le fait d’abolir la police sans abolir le capitalisme. La « police » privée de l’Université de Chicago dans le Hyde Park, un îlot de richesse dans la pauvreté des quartiers sud, est mieux financée que tous les commissariats locaux de la ville réunis. Après tout, la sécurité privée est une solution nettement plus rentable pour les riches. À quoi bon dépenser ses impôts pour financer la police au service de l’ensemble d’une ville quand tout ce dont on a réellement besoin est de protéger ses propres enclaves ?
Sous la pression des manifestant·es, en juin 2020, le conseil municipal de Minneapolis votait non seulement pour couper les fonds de leur département de police, mais de le dissoudre complètement. Même s’il a l’air de révoquer cet engagement, s’il avait suivi le modèle « abolitionniste » de Camden dans le New Jersey, cela pourrait tout simplement vouloir dire renommer le département[92]. Les milices ayant passé l’été à quadriller les rues en quête des fameux « pilleurs suprémacistes blancs » se vantaient parfois d’avoir des visions plus radicales de l’abolition[93]. Divers récits de leurs expériences témoignent de la complexité de la question de la violence telle qu’elle se présente différemment aux militant·es, petit·es épicier·es, ainsi qu’aux résident·es des quartiers fortement touchés par la délinquance. Comme le montre l’histoire des révolutions du XXe siècle, dans le brouillard d’une guerre civile, il est rarement possible de distinguer la violence politique de la violence antisociale[94]. Mais les tentatives nécessairement chaotiques des révolutionnaires de défendre les territoires libérés de l’État et du capital ne doivent pas être confondues avec des vigiles de quartier ou avec l’aile armée d’une « organisation de communauté » [community organization, NdT] protégeant la propriété privée dans une collaboration tacite ou explicite avec la police locale[95].
En partant de ces exemples-là, il est clair que les luttes elles-mêmes peuvent facilement devenir des expressions passives de l’anarchie et du désordre que les Trump de ce monde cherchent à faire monter[96]. Agamben le dit à Athènes en 2013 : « la véritable anarchie est l’anarchie du pouvoir »[97]. Nous pouvons peut-être en voir la confirmation dans un chant populaire des insurrections chiliennes : No estamos en Guerra [Nous ne sommes pas en guerre, NdT]. Ce chant était dirigé contre le président Sebastián Piñera qui déclarait dans un discours tenu en octobre 2019 que « Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant qui souhaite utiliser la violence sans limites »[98]. Dans cet exemple – un parmi d’autres – les non-mouvements du monde semblent paradoxalement représenter le parti de l’ordre alors que la police n’est rien d’autre qu’une force armée du parti de l’anarchie qui ne cesse d’exacerber les conflits déchirant notre monde.
Il serait bien évidemment insensé de prôner un principe abstrait de non-violence. L’insurrection chilienne a malheureusement coûté la vie à trente personnes depuis octobre 2019 et autour de 500 personnes ont été blessées aux yeux. Il est tout de même clair que les masses dans les rues n’aspirent ni au chaos, ni à la violence. En renommant la Plaza Baquedana à Santiago, le pivot des non-mouvements, en Plaza Dignidad, les manifestant·es chilien·nes revendiquent une dignité. On peut peut-être discerner un fil rouge (qui s’effiloche) pour lier le morne « no estamos en guerra » de 2019 au « make love not war » [Faites l’amour pas la guerre, NdT] de 1968 voire même au « la paix, le pain et la terre » de 1917. En effet, l’histoire du communisme n’est pas uniquement l’histoire de la lutte des classes, mais aussi l’histoire d’une inimitié à l’égard de l’inimitié, une révolte contre l’antagonisme au sein des classes subalternes qui opère un partage entre ami·es et ennemi·es. C’est ainsi un désir de paix.
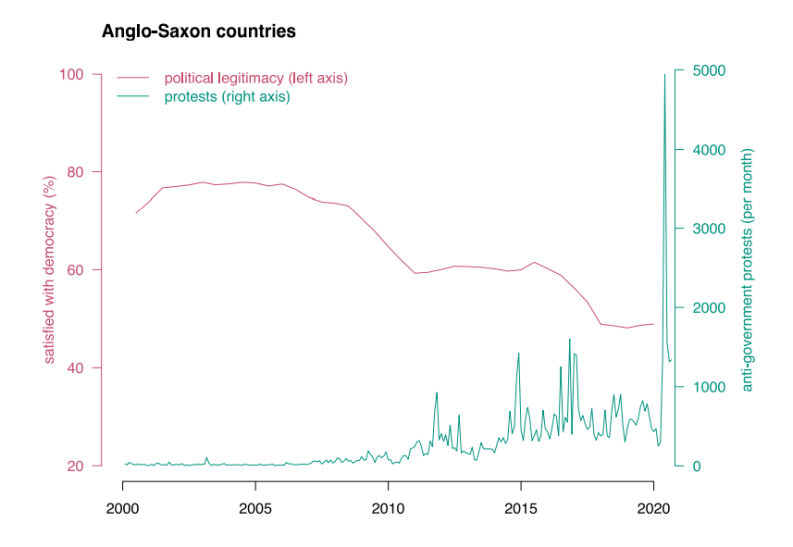
5. Une science de l’espèce
Dans The Holding Pattern (Endnotes 3), nous avons décrit la préoccupation centrale des Printemps arabes et d’Occupy comme un problème de composition de divers fragments du prolétariat (ainsi que des classes moyennes en révolte) en une force cohérente sur les places. Rétrospectivement, il s’agissait des premiers signaux d’une vague naissante de non-mouvements. Mais ce problème de composition est plus communément compris comme le problème des politiques de l’identité qui semblent prédominer depuis le début du déclin du mouvement ouvrier[99].
Ce n’est pas beaucoup exagérer que d’affirmer que les « anti-politiques de l’identité » [anti-identity politics, NdT] sont le pire produit des politiques de l’identité. Nombre de critiques des politiques de l’identité à gauche assument qu’il n’existe qu’une seule question de l’identité autour de laquelle les vestiges du mouvement ouvrier pourrait encore se rallier, notamment le « nationalisme citoyen » qui n’était jamais trop éloigné du cœur de celui-ci[100]. Or, nous avons vu que seule la droite peut prospérer avec certitude sur ce terrain. Les politiques de l’identité ne sont pas seulement un spectre qui hante la gauche social-démocrate. Elles sont en fait devenues un terme quasi-universellement réprobateur. Car même les plus « woke » ont tendance à employer ce même terme (ou un synonyme) pour critiquer ceux qui sèment des divisions inutiles, ou bien affirment représenter des sous-groupes toujours plus minuscules des opprimé·es. C’est pourquoi nous prenons les politiques de l’identité pour une indication de quelque chose de plus large qu’un simple ensemble de limites que les non-mouvements contemporains doivent affronter. Dans la perspective plus large dans laquelle nous employons ce terme, les politiques de l’identité transforment le terrain sur lequel se déploient les luttes, et donc sur lequel ces limites doivent être affrontées.
Les mouvements sociaux classiques, qu’ils soient de gauche ou de droite, ne peuvent que naviguer sur ce terrain d’un capitalisme délabré que les non-mouvements de ce monde sont en train de remodeler, lentement pour l’instant et peut-être bientôt plus rapidement. Dans Apocalypse et révolution, Giorgio Cesarano décrit les instants annonciateurs des politiques de l’identité comme l’un « des mouvements de libération contre-révolutionnaires » qui, par leur aspect partiel, produiraient néanmoins « la conscience durement gagnée de l’enjeu réel : la libération de l’espèce de toute idéologie, le dépassement nécessaire de toute séparation, la conquête armée du point de vue de la totalité »[101]. Dans les termes de Bordiga, on pourrait dire qu’avec leurs dimensions conformistes et réformistes (sur lesquelles se fixent les litanies « anti-woke »), ces mouvements contiennent aussi des éléments distinctement anti-formistes, dans le sens où ils reconfigurent le terrain même sur lequel la contestation se joue.
Le principe organisationnel central des non-mouvements a jusque-là été leur rage et leur dégoût à l’égard des injustices ou de la corruption plus généralement, et de la police, la classe politique ou les élites en particulier. Or, vient un moment dans l’évolution de cette lutte où cette unité négative (l’unité à travers l’ennemi commun) est vécue comme insuffisante. Nous sommes réuni·es par une perception partagée de ce qui est injuste, mais limité·es par cette même relation à l’injustice, qui ne peut être transcendée qu’en articulant une vision commune de ce qui est juste ou bon. De plus, nous nous réunissons sous la bannière des enragé·es et des indigné·es, mais derrière elle, les véritables conflits d’intérêts et d’allégeance sont dissimulés – et ce sont des conflits dont on fait forcément l’expérience à un moment donné, souvent de manière violente. Ceci est vrai même lorsque la lutte apparaît non seulement comme une lutte contre un ennemi spécifique, mais aussi la lutte d’une fraction spécifique de la classe (par exemple, des Noir·es, des indigènes, des jeunes, des migrant·es) qui peut se présenter comme la plus exploitée ou la plus enragée, la partie qui se substitue à l’ensemble.
Aujourd’hui, la totalité en tant que telle n’est pas représentable, de sorte que l’une des formes des politiques de l’identité peut avoir tendance à délimiter les potentialités et les limites de n’importe quelle lutte des classes s’étendant au-delà d’un espace de travail spécifique ou d’une section particulière de la classe. En effet, ce genre de luttes ne peut se développer qu’en affrontant et en confondant les séparations identitaires et dans lesquelles la classe ouvrière s’est empêtrée. La classe est fracturée en une myriade de situations dont chacune peut être représentée partiellement mais dont aucune ne peut être projetée nettement sur une affinité politique ou un groupe d’intérêt. Aussi, les solutions au problème de coordination, solutions qui pourraient faire converger ces identités partielles pour représenter adéquatement la classe dans son ensemble, ne sont que trop rares.
Aux États-Unis par exemple, la classe semble être médiée par la « race » ; les couches les plus pauvres et les plus privées de leurs droits sont disproportionnellement d’origine africaine ou indigène, et les marqueurs visibles de ces origines sont fréquemment assimilées à cette couche. Bien sûr, le problème qui surgit de ce type d’apparence est non seulement dans les classes moyennes noires et indigènes dont l’existence met nécessairement à mal ces préceptes culturels, mais aussi dans le fait que les blanc·hes pauvres sont souvent, dans cette optique, faussement identifié·es comme des privilégié·es. Dans l’imaginaire de l’Amérique libérale, les classes ouvrières blanches sont désormais vues comme incorrigiblement racistes, comme un « panier de déplorables[102] » identifié à la base électorale honnie de Trump, tandis que les conservateurs persistent à associer ce groupe à des figures masculines de pères de famille depuis longtemps disparues – y compris les flics – dont la respectabilité est mise en concurrence avec les pathologies supposées d’un « sous-prolétariat » noir. Dans les deux cas, la classe se divise ainsi selon une ligne à la fois morale et raciale entre pauvres méritants et pauvres non méritants, mais quelle race est associée à quel côté dans cette dichotomie manichéenne dépend largement de l’obédience libérale ou conservatrice de l’observateur·ice.
Pourtant, bien que les politiques raciales des États-Unis soient un exemple extrême de la médiation de la classe par l’identité, ce n’est en aucun cas une exception américaine. Les luttes autour de l’identité sont partout venues dominer la sphère politique. Ce n’est pas que les gens sont devenus plus racistes, sexistes ou homophobes ; au contraire, ces attitudes sont en déclin alors même qu’elles sont mises en avant dans les réalignements politiques contemporains[103]. La tendance générale est à ce que des générations plus jeunes, plus libérales et progressistes, se confrontent aux fractions de la population plus conservatrices et souvent plus âgées, dont l’influence politique est bien plus importante (à cause de leur richesse et leur tendance à voter). Dans ce contexte-là, le nationalisme et le populisme deviennent plus éloquents, mais cela n’implique pas en soi un changement de direction, car toute la politique institutionnelle (à la fois de gauche et de droite) est fondamentalement une politique de l’État, du citoyen, du peuple et de la nation. Ce qui a changé, c’est que les non-mouvements de ce monde sont venus troubler ces politiques conformistes par leur élan anti-formiste.
Aujourd’hui, toute la politique tend aux politiques de l’identité non parce que les divisions identitaires se sont clarifiées ou endurcies, mais bien plus parce que celles-ci sont de plus en plus contestées et confuses. D’un côté, c’est une fonction simple d’un capitalisme contemporain en pleine stagnation où les transformations du processus de production s’ajoutent aux tendances économiques qui s’empirent pour ébranler la confiance en une stabilité dans l’emploi, la santé, la résidence et la vie familiale. De l’autre, les identités sont davantage menacées au point que leur survie même est questionnée, lorsque la nécessité de se battre contre ces conditions qui s’aggravent constamment dépasse les limites réelles d’une coopération entre des fragments de classe, et les non-mouvements débordent sur les rues, les places et les rond-points. Ces espaces sont forcément confus, car leur production nécessite une confusion active des identités disparates. Ce processus est risqué, car il implique une danse des politiques de l’identité de haute intensité, toujours en proie au danger de devenir seulement performatives, amères et même violentes.
La dernière itération en date du mouvement Black Lives Matter peut ainsi être vue comme une instance d’un motif général qui caractérise l’accumulation mondiale des non-mouvements. Les manifestations, les émeutes et les attaques des monuments qui ont balayé les États-Unis depuis le 26 mai représentent une confusion énorme des éléments qui avaient été séparés et même opposés jusque-là. Au sein de cette amalgamation, des divisions internes prolifèrent, à la fois selon les lignes de partage des identités préexistantes, mais aussi selon les divisions nouvelles créées par la lutte. Dans la révolte pour George Floyd, nous pouvons pointer une division entre le « jour » et la « nuit », correspondant, respectivement, aux manifestations pacifiques des classes moyennes et les activités à caractère plus prolétarien du pillage et de l’émeute[104]. Nous pourrions aussi aborder la division entre les « violents » et les « non-violents », ou encore la division entre les grandes et les petites villes, ces dernières ayant été nombreuses à connaître leurs premières manifestations à ce moment-là. Mais l’élément le plus frappant de ces manifestations était peut-être leur composition raciale.
Il n’y a aucun doute sur le fait que les prolétaires noirs ont ouvert la voie, que ce soit lors de la révolte initiale à Minneapolis ou plus tard, durant les pillages ciblés de Chicago et Philadelphie. Cependant, dans l’écrasante majorité des manifestations, et même dans de nombreuses émeutes, les participant·es s’identifiant comme « blanc·hes » semblaient composer la majorité des personnes dans les rues[105]. On peut le constater en regardant les sondages d’opinion qui demandaient aux gens s’ils avaient manifesté, les enquêtes de terrain menées par des sociologues, la plupart des rapports d’arrestation publiés par la police, et même l’analyse du bornage des téléphones portables sur certains lieux d’émeute[106]. Ce fait est souvent ignoré par la gauche comme par la droite, probablement parce qu’il dérange leur propre ressenti identitaire. Pourtant, c’est précisément la mobilisation massive de « l’Amérique blanche » qui a distingué ce soulèvement d’autres mouvements comparables, comme Black Lives Matter en 2015, ainsi que la vague d’émeutes qui a traversé les villes américaines dans les années 1960[107].
On peut comprendre ce phénomène comme une trahison massive de la blanchité [whiteness, NdT], qui correspond à une réduction progressive mais constante des comportements racistes, en particulier chez les jeunes Américain·es. Mais si « l’antiracisme » était le mot de ralliement du mouvement, il est important de préciser qu’il recouvrait des significations différentes selon les individus. Dans les effets de ricochet du mouvement sur la culture, on peut constater une augmentation notable d’un antiracisme moral organisé autour de revendications individuelles de représentativité raciale et de valeurs antiracistes. On observe ce phénomène non seulement dans les canaux habituels des réseaux sociaux et de l’enseignement supérieur, mais aussi dans la politique parlementaire et, dans une certaine mesure, dans la rue, où il a parfois été facilité par des souches résiduelles de nationalisme qui sont plus que désireuses de contrôler les frontières raciales. On peut facilement trouver des exemples : les politiciens démocrates s’agenouillant vêtus de tissu Kente [un tissu traditionnel ghanéen, NdT], les chrétiens blancs lavant symboliquement les pieds des pasteurs noirs, et le nombre toujours croissant de « formateurs en diversité » [diversity trainers, NdT] et de « leaders noirs » qui semblent toujours dire aux Blancs de classe moyenne ce qu’ils veulent entendre : se mettre à l’écart, rester discrets, rester non-violents, se livrer à des exercices individuels de culpabilité et de rédemption[108].
Cependant, il est important de reconnaître que ce n’était plus là la forme dominante d’antiracisme après le 26 mai. Nous avons plutôt vu quelque chose de beaucoup plus proche des politiques d’identité que nous décrivons dans cet article : une politique de ceux qui savent que les divisions raciales doivent être activement remises en question s’ils veulent demeurer une force contre la police (et la politique qui les sous-tend). Les expressions d’unité interraciale étaient largement visibles sur les banderoles et entendues dans les chants, mais elles se matérialisaient par une action concertée autour d’un objectif commun – qu’il s’agisse d’assiéger un commissariat, d’abattre une statue ou de défendre la foule contre les attaques de la police. Lorsque, dans de telles situations, les militant·es tentaient d’instaurer une ségrégation raciale à l’intérieur de la manifestation (ou de vérifier la bonne foi raciale des gens afin de réguler le niveau de diversité souhaité), ils furent souvent considérés, à juste titre, comme des contributeur-ices au travail des flics et des fascistes en divisant et en affaiblissant le mouvement.
En effet, on peut considérer le soulèvement comme la révolte de cette dernière forme pragmatique d’antiracisme contre la première, de type moral. Après tout, les émeutiers ont commencé par cibler les administrations municipales dirigées par des maires libéraux dont beaucoup avaient construit leur carrière sur un antiracisme moral. Ces maires, parmi lesquels un nombre remarquable de femmes noires, protégeaient désormais les flics assassins, supervisaient la répression des manifestant·es et, dans le cas de Chicago, levaient les ponts-levis pour exclure un prolétariat majoritairement noir du centre-ville riche. Leur discours sur la diversité et l’inclusion n’a pas dissuadé les prolétaires noirs de brûler et de piller les villes qu’ils administraient, mais ils n’ont pas non plus réussi à convaincre l’Amérique blanche de rester chez elle et de « faire le travail ». Au lieu de cela, des centaines de milliers (peut-être des millions) de blanc·hes se sont soulevés contre ces maires libéraux, noirs ou racisés et, dans la plupart des cas, ils ont pu combattre aux côtés de leurs voisin·es noir·es sans les prendre de haut[109].
Toutefois, si la rébellion pour George Floyd représentait ainsi une « trahison à la blanchité », elle n’était pas exactement du même type que celle défendue autrefois par la revue Race Traitor[110]. Il ne s’agissait pas d’une trahison stratégique ayant pour objectif le pouvoir de la classe ouvrière, mais plutôt d’une trahison spontanée de sujets néolibéraux, alimentés par la rage et la frustration, qui refusent d’être ce qu’ils sont, et goûtent brièvement, dans la confusion de la lutte, à ce qu’ils pourraient être. C’est le sens positif de ce que nous appelons « confusion ». On a aussi pu l’observer lorsque les islamistes sont entrés sur la place Tahrir, lorsque les partisan·es du Rassemblement National ont rejoint les blocages des ronds-points, ou lorsque les Chilien·nes de classe moyenne sont descendu·es dans les rues pour combattre la police aux côtés des anarchistes et des ultras. Une telle confusion à travers les lignes politiques, culturelles et raciales est à la fois plus courante et moins complexe que ce dont l’imagination libérale antiraciste peut rêver (surtout pour les prolétaires qui ont moins à perdre ou lorsque l’ordre méritocratique est ébranlé).
Si une telle fusion est possible, voire facilement atteinte dans le feu de la lutte, elle est rarement durable[111]. Si la confusion des non-mouvements est souvent fondée sur la trahison de ce que nous sommes, ils nous permettent rarement de laisser notre ancienne vie derrière nous. Nous nous révoltons contre une condition de solitude (une solitude qui n’est qu’exacerbée par la distanciation sociale et les confinements), mais les révoltes satisfont rarement la faim de communauté qui les a fait naître[112]. Certain·es militant·es se rencontrent, et beaucoup de gens deviennent militants pour la première fois ; or, il n’y a pas de communauté de tactiques mais seulement une affinité temporaire entre les identités politiques et tactiques : Gilets Jaunes, milices, antifas, frontliners et « leaders communautaires » – un monde de tribus, de gangs, de rackets[113]. Les non-mouvements ont généralement eu du mal à créer des assemblées de quartier ou à établir des liens durables avec le monde du travail. Au lieu de cela, ils interrompent brusquement la vie quotidienne, marquant le temps comme les « actes » numérotés des Gilets Jaunes, ou les manifestations de masse chaque vendredi au Chili, quand les gens se rassemblent en nombre pour exprimer leur rage, puis se dispersent immédiatement pour retourner soit à leurs vies individuelles, soit à leurs tribus identitaires diverses.
Ce manque de cohérence n’est pas non plus un avantage tactique ou stratégique. C’est l’ampleur et la portée des mobilisations plutôt que la diversité de leurs tactiques qui ont submergé la police, et c’est la brutalité initiale de la police qui est souvent responsable de cette ampleur et de cette portée. Tou·tes les participant·es peuvent voir qu’au-delà d’un certain point, la confusion de la mobilisation, c’est-à-dire son manque d’organisation, est un obstacle à l’extension de la lutte. Pourtant, en confondant l’identité de leurs participant·es, les non-mouvements constituent un creuset dans lequel nous pouvons voir la formation d’un nouveau type d’humain, moins paniqué ou domestiqué qu’Agamben et d’autres l’ont craint. Nous avons soutenu que les non-mouvements exploitent et radicalisent les changements dans la reproduction de la vie quotidienne, et donc de la vie humaine. Ce sont ces changements qui ont rendu possible les explosions urbaines auxquelles nous avons assistées au cours de la dernière décennie. Nous faisons donc le pari que ce changement anthropologique se poursuivra après que les luttes dans les rues auront été écrasées par la répression, ou qu’elles se seront éteintes par manque d’organisation ou d’endurance, puisque les non-mouvements sont des expressions de la logique anti-formiste de notre époque.
La confusion des identités est la condition de possibilité de la révolte aujourd’hui, mais aussi une limite qui doit être dépassée. À court et moyen terme, nous nous attendons à ce qu’elle soit de plus en plus problématisée, tant dans un sens pratique que théorique. Cette limite peut indiquer le besoin d’un nouveau type d’organisation, comme l’a récemment dit un ami (en se référant à un groupe de hip-hop underground) : une Organized Konfusion[114]. On pourrait même l’appeler un « parti communiste », bien que, comme certain·es camarades l’ont récemment expliqué, il serait très différent des anciens partis[115]. Il devrait spécifiquement faire appel à un prolétariat qui n’est plus interpellé par les restes du mouvement ouvrier et qui est contraint de se joindre à des segments des populations excédentaires et des couches moyennes déclassées dans des révoltes contre une immisération générale. Ainsi, un tel parti invisible devrait également faire appel à ces groupes rebelles, qu’il s’agisse de lumpen ou de classes moyennes en voie de déclassement, qui sont descendus dans la rue en nombre sans précédent, dans des vagues de révoltes qui expriment la volatilité de notre période. Il peut même être nécessaire de faire appel à ces segments de la classe qui sont actuellement mobilisés contre les non-mouvements afin de briser l’inimitié qui renforce la police et pousse les luttes vers une logique militaire. Pourtant, étant donné que les non-mouvements sont, comme nous l’avons soutenu à plusieurs reprises dans ce texte, les signes subjectifs de la stagnation du capitalisme, leur tâche la plus importante est peut-être de prendre conscience de cette condition latente et de s’orienter vers la potentielle fin d’un système qui est déjà dans un état de déclin chronique. Les non-mouvements signalent que le prolétariat n’a plus de tâche romantique[116]. Il ne peut pas mobiliser un peuple ni lutter pour l’hégémonie. Au contraire, il ne peut surmonter notre ordre chancelant – qui, en un sens, défait déjà les fondements de la société de classe – qu’en continuant à résister à toutes les tentatives de régénérescence du monde politique.
Les premières pierres d’achoppement de notre ère anarchique se trouvent dans les confusions identitaires dont témoignent les non-mouvements dans leur soif de communauté humaine. Cette soif n’a jusqu’à présent ni été satisfaite par des victoires ni été étouffée par la répression. C’est pourquoi nous pensons que notre période continuera à être marquée par l’accumulation de révolutionnaires sans révolution. Les affamé·e·s s’habillent en jaune et ont recours au langage fragmenté de l’identité plutôt que celui de la classe parce que tout le cadre de la gauche s’est effondré. Si l’antiracisme pragmatique a supplanté l’antiracisme moral lors du soulèvement pour George Floyd, c’est parce que le pragmatisme de la révolution ne puise plus sa poésie dans le monde mort des idéologies. La révolution du XXIe siècle doit laisser les morts enterrer leurs morts afin d’arriver à son propre contenu. Ainsi, la tâche d’une science contemporaine de l’espèce est de lire à nouveau les arcanes de notre temps, afin de comprendre comment les non-mouvements eux-mêmes révèlent la tendance anti-formiste de notre époque, et comment, dans leur confusion, nous pouvons identifier l’éclipse des formes sociales que nous appelons capital, État et classe. Puisque le communisme est le non-mouvement réel qui abolit ces formes sociales, aux masses qui affrontent notre ordre chancelant, nous disons avanti barbari ! - barbares en avant !
⁂
Notes
[1] Aux États-Unis, ces révoltes ne furent pas vraiment le résultat de l’action spontanée de la base ; en effet, elles étaient généralement organisées par des groupes de pression associés soit à l’effort de démantèlement des grands monopoles technologiques, soit aux « Amazoniens unis » (Amazonians United) affiliés à Labor Notes.
[2] NdT : Le terme allemand Querfront renvoie historiquement à la convergence, sous la République de Weimar, de certains partisans d’une révolte restauratrice et de certains éléments de la gauche radicale. Il s’emploie aujourd’hui pour désigner, par extension, les alliances qui, de manière plus ou moins durable, outrepassent le clivage entre la droite et la gauche.
[3] Le mouvement a pris une tournure antifasciste plus familière après qu’un agent de sécurité pro-Trump a tué deux personnes à Kenosha, dans le Wisconsin. Le premier débat présidentiel entre Trump et Biden, lui-même une mise en scène de notre époque chaotique, a soulevé une question digne d’un abécédaire de Crimethinc : le phénomène antifa est-il « une idée ou une organisation ». Pendant ce temps, des journalistes libéraux de la NPR et du New York Times enquêtaient sur l’anarchisme insurrectionnel.
[4] Voir les textes de Cesare Battisti, ancien membre de Prolétaires armés pour le communisme (PAC), qui a écrit depuis la prison que « ce dont nous sommes témoins n’est plus une guerre d’idéologies, mais un assaut décisif du capital contre la condition humaine en tant que communion de corps et d’esprit » ; le philosophe Giorgio Agamben, qui a été attaqué par une grande partie de la gauche pour avoir osé critiquer les confinements ; et le situationniste Gianfranco Sanguinetti qui a affirmé que « [n]ous assistons à la décomposition et à la fin d’un monde et d’une civilisation, celle de la démocratie bourgeoise avec ses parlements, ses droits, ses pouvoirs et ses contre-pouvoirs ».
[5] Julien Coupat et al., « Covid : choses vues », Reporterre, 4 septembre 2020.
[6] World Bank, « Covid-19 to Plunge Global Economy into Worst Recession since World War II », 8 juin 2020, Carmen Reinhart et Vincent Reinhart, « The Pandemic Depression The Global Economy Will Never Be the Same », Foreign Affairs, octobre 2020.
[7] Kamunist Kranti,« A Glimpse of Social Churnings: Attempts at Conversational Interactions during Global Covid Lockdowns », septembre 2020.
[8] Voir par exemple Mikkel Bolt Rasmussen, Trump’s Counter-Revolution (Washington, États-Unis : Zero Books, 2018). Pour un texte classique sur le concept de contre-révolution, voir Amadeo Bordiga, « Lezioni delle controrivoluzioni », Bollettino interno del PCInt (1951), récemment traduit en anglais dans The Science and Passion of Communism : Selected Writings of Amadeo Bordiga (1912-1965) (Brill, 2020), pp. 268-282.
[9] Bien sûr, comme l’a récemment fait valoir Nate Holdren, il n’y a pas grand-chose de vraiment exceptionnel chez Trump lui-même. Au-delà du spectacle, Trump ne fait que personnifier sa position de classe. Il s’est fait les dents pendant la crise fiscale de New York en détournant les fonds publics au milieu du chaos. Depuis, il est en mouvement constant et frénétique, capitalisant sur les bouleversements, indifférent à la source de sa richesse, pillant ce qu’il peut avant la prochaine grande secousse (ou faillite). Pourtant, la prise de contrôle du pouvoir exécutif par le secteur FIRE [le secteur économique basé sur la finance, l’immobilier et l’assurance, NdT] était en soi politiquement significative, pour les raisons que nous exposons dans le texte. En fin de compte, ce que Trump signale, c’est que les hommes forts de notre époque ne peuvent que produire des schismes et faire craindre une guerre civile. Voir par exemple la récente analyse de Mike Davis sur la victoire de Biden qui se termine par la conclusion dramatique suivante : « Les structures profondes du passé ont été déterrées pendant la présidence de Trump et on les a laissées enclencher une fuite en avant. Une guerre civile ? Certaines analogies sont inévitables et ne doivent pas être facilement écartées. » Mike Davis, « Trench Warfare : Notes on the 2020 Election », New Left Review, n°126, 2020.
[10] Le journaliste vénézuélien Moisés Naím a récemment affirmé que les élections perdent leur pouvoir stabilisateur : « De profondes divisions politiques affectent désormais la plupart des démocraties du monde. Elles deviennent si extrêmes que de nombreux citoyens définissent leur identité politique par opposition à “l’autre camp”…. Souvent, la colère et l’animosité envers ceux qui ont des opinions politiques divergentes sont telles que les opposants ne sont même pas acceptés comme des acteurs politiques légitimes. » Moisés Naím, « Le vainqueur de l’élection américaine ? La polarisation », El País, 24 novembre 2020.
[11] Un exemple d’un tel développement illibéral est la loi dite Ley Mordaza, la loi bâillon, en Espagne, qui a été mise en œuvre contre les mouvements sociaux en 2015 et qui a été fortement utilisée pendant la pandémie. Un autre exemple est la loi française sur « la sécurité globale » qui, entre autres, interdit la diffusion d’images de la police sur les réseaux sociaux. [NdT: En plus de la généralisation de la vidéosurveillance par drone autorisée par le préfet pour une période et un périmètre donnés au nom de la lutte anti-terroriste, de nouvelles prérogatives pour les agents de sécurité privée pour les palpations et contrôles d’identité ainsi que l’extension des pouvoirs de la police municipale, cette loi a été notamment dénoncée pour l’article 24, devenu article 52 dans la version modifiée par le Sénat et adoptée par l’Assemblée le 15 avril. Dans sa version initiale, elle modifiait la loi de 1881 sur la liberté de la presse pour réprimer la diffusion « malveillante » d’images des forces de l’ordre. Dans la nouvelle version, toute référence à cette loi a été abandonnée et un nouveau délit de « provocation à l’identification » a été créé. Alors que les dispositions sur la diffusion d’images des policiers sont glissées dans l’article 18 de la loi « séparatisme », la dangerosité politique de ce nouveau délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende consiste en son universalité : désormais, non seulement la diffusion d’images mais la « diffusion d’autres éléments d’identification qui ne seraient pas des images » comme le nom, l’adresse etc. devient passible de poursuites judiciaires. Cette loi va donc réprimer encore davantage les pratiques de « cop watching », comme par exemple lors des BlueLeaks dans le contexte du mouvement Black Lives Matter. Au nom d’une sauvegarde de la liberté de la presse, l’amendement de cette loi renforce paradoxalement sa teneur illibérale. C’est maintenant au Conseil constitutionnel de porter le jugement final.] Évidemment, nous ne pouvons pas identifier le libéralisme à la démocratie, car des figures aussi différentes que le centriste Yascha Mounk et le stalinien Domenico Losurdo nous rappellent la dimension aristocratique et antidémocratique de la tradition libérale. Pourtant, le libéralisme est l’idéologie principale des droits de la bourgeoisie et c’est la crise de ces droits qui, dans une large mesure, façonne notre période actuelle et peut-être même signale la montée d’un despotisme occidental. Ainsi, lorsque nous affirmons que les luttes ont une dimension libérale, nous insistons principalement sur le fait (1) que les gens luttent contre l’éclipse de leurs droits ; (2) qu’ils sont produits comme des sujets néolibéraux, usant souvent d’une rhétorique libérale et émettant des revendications libérales ; (3) qu’ils expriment le déclin de l’ordre méritocratique et libéral ainsi que sa perte de légitimité dans le monde entier.
[12] Les données de cette figure et de toutes les figures suivantes proviennent de la base de données des événements de GDELT (axe de droite) et du rapport Global Satisfaction with Democracy 2020 (axe de gauche). GDELT utilise des algorithmes de traitement de la langue naturelle et d’exploration de données pour identifier les événements contestataires dans les médias conventionnels et sociaux. Nous avons extrait de leur base de données tous les événements enregistrés comme étant menés par des civils contre le gouvernement, la police, le système judiciaire, les entreprises ou les élites. Pour leurs estimations de la légitimité démocratique, Roberto Foa et ses collègues ont recueilli plus de 4 millions de réponses à 3 500 sondages visant à déterminer si les gens étaient satisfaits ou non de la démocratie dans leur pays. Foa nous a généreusement donné accès à ces données trimestrielles, pondérées selon la population.
[13] Il convient de souligner que ces protestations et soulèvements ont également tendance à impliquer un nombre beaucoup plus important de personnes qu’auparavant et à durer plus longtemps. L’année 2010 a marqué le début d’une vague de grèves mondiales et, en 2020, l’Inde a assisté à la plus grande grève de son histoire, de même que la France connut en 2019 la plus longue grève depuis 1968. Le soulèvement en hommage à George Floyd a été le plus large mouvement de l’histoire moderne des États-Unis, et nous avons assisté aux plus grandes manifestations, émeutes et occupations d’universités depuis des décennies au Royaume-Uni, au Chili et au Canada.
[14] Jacques Camatte, « De la révolution », Invariance, série II, n°2, 1972.
[15] Ibid.
[16] En fait, certaines victoires remportées n’ont pas été faibles mais plutôt décisives. Les protestations en Tunisie ont conduit début 2018 au retrait des mesures budgétaires ; quelques mois plus tard, le Premier ministre jordanien Hani Mulki a dû démissionner face aux contestations dans son pays tout comme le Premier ministre irakien Adil Abdul-Maahdi ; en 2019, des manifestations au Liban ont contraint les premiers ministres Saad Hairi et Hassan Diab à démissionner ; en 2020, la constitution a été révisée au Chili, des manifestations au Pérou ont conduit à la démission du président par intérim Manuel Merino tandis que le budget a été abrogé au Guatemala après l’incendie d’une partie du bâtiment du Congrès.
[17] A l’échelle mondiale, nous sommes autant dans une ère de grèves que d’émeutes, comme l’a souligné à juste titre le collectif Wildcat : « Les années 2006 à 2013 se caractérisent par une vague de protestations massives dans les rues, de grèves et de soulèvements d’une ampleur sans précédent. Selon la Friedrich-Ebert-Stiftung New York 16, cette vague n’est comparable qu’aux bouleversements révolutionnaires de 1848, de 1917 ou de 1968 – le think-tank a analysé 843 mouvements contestataires au total dans 87 pays entre 2006 et 2013, ce qui couvre 90 % de la population mondiale. Il s’agit de protestations de toutes sortes : contre l’injustice sociale, contre la guerre, pour une démocratie réelle, contre la corruption, ou encore d’émeutes contre la hausse des prix alimentaires, de grèves contre le patronat, de grèves générales contre l’austérité ».
[18] Le référendum d’octobre 2020 constitue une véritable victoire pour le mouvement et n’implique pas nécessairement une désescalade du conflit par la récupération démocratique. Au contraire, il semble impliquer un changement plus large, peut-être époqual, qui clôt la période dont les débuts remontent à la dictature néolibérale d’Augusto Pinochet.
[19] On estime que 15 à 26 millions de personnes ont pris part aux manifestations au cours des seuls mois de mai et de juin. Voir Larry Buchanan et al., « Black Lives Matter May Be the Largest Movement in US History » dans The New York Times, 3 juillet 2020.
[20] Voir Asef Bayat, Life as Politics : How Ordinary People Change the Middle East (Cairo : American University, 2013) et « The Urban Subalterns and the Non-Movements of the Arab Uprisings », site Jadaliyya, 2013.
[21] Voir la « Lettre à propos de Greta Thunberg » de Jacques Camatte, 20 mai 2019, site d’Invariance. Pour Camatte, la révolte « passive » n’est pas un terme péjoratif, ni une référence à la « révolution passive » gramscienne, mais plutôt une forme d’activité sismique ou de réaction spasmodique de l’espèce.
[22] « The Urban Subalterns and the Non-Movements of the Arab Uprising », site Jadaliyya, 2013.
[23] Comme nous le soutenons dans la partie 5 ci-dessous, l’identité devient de plus en plus le médiateur de la lutte des classes, lorsque le moteur de croissance du capitalisme industriel ralentit et que le mouvement ouvrier est réduit à un groupe de pression sectoriel.
[24] Si nous rejetons la connotation négative de l’expression « politiques de l’identité », ce n’est pas pour lui substituer une connotation positive. Suivant le sens spécifique que nous donnons à ce terme, nous soulignons leur caractère « anti-formiste ». Pour nous, le concept est analytique plutôt que normatif ; il dénote la difficile négociation de l’identité qui est à la fois la prémisse et la conséquence des mobilisations populaires de masse qui se répandent dans le monde aujourd’hui.
[25] Des lois de sécurité similaires ont récemment été imposées à Hong Kong. Espérons que le cortège de tête aura plus de succès que les frontliners. NdT : comme nous l’avons souligné ci-dessus, la version amendée de la loi « sécurité globale » est pire que la version initiale. Après 2016, c’est plutôt à un énième échec du cortège de tête qu’on assiste.
[26] Voir Christoper Lasch, La culture du narcissisme, Flammarion, 2018 (1980) ; Jean Baudrillard, Amérique, LGF, 1988 ; Sergio Bologna, La tribù delle talpe, 1977. Ce dernier texte mérite tout particulièrement d’être relu aujourd’hui car Bologna dépeint une profonde transformation de l’État qui structure les conflits de notre époque : « Le “système des partis” ne vise plus à représenter les conflits, ni à les médiatiser ou à les organiser : il les délègue aux “intérêts économiques” et se pose comme la forme spécifique de l’État, séparé et hostile aux mouvements de la société. Le système politique devient plus rigide, plus frontalement opposé à la société civile. Le système des partis ne “reçoit” plus les poussées de la base ; il les contrôle et les réprime ».
[27] Le travail, la pauvreté et le revenu surdéterminent les non-mouvements mais la prolétarisation en tant que principal mécanisme de séparation pose les identités en même temps qu’elle les ébranle ou, mieux, pose ces identités en en particularisant les intérêts au sein d’un marché du travail de plus en plus fragmenté.
[28] NdT : il s’agit là d’un jeu de mot intraduisible qui résulte d’une combinaison des expressions « awakening » (éveil) et « woke
» (politiquement déconstruit). [29] Matthew Yglesias, « The Great Awokening », Vox, avril 2019. Gilles Dauvé fait partie de celleux qui, au cours des dernières décennies, n’ont cessé de rappeler la dimension anthropologique du capitalisme comme du communisme: « Le communisme est une révolution anthropologique dans le sens où il traite de ce que Marcel Mauss analysait dans Le Don (1923) : une capacité renouvelée à donner, recevoir et d’agir en réciprocité. La communisation est la production d’une relation différente aux autres et à soi-même, où la solidarité ne naît pas d’un devoir moral extérieur à nous, mais plutôt d’actes pratiques et d’interrelations ». Gilles Dauvé, « Communisation », Troploin, 2011, texte en gras dans l’original. NdT : La première phrase est absente de la version française qui se termine par ailleurs comme suit : « C’est ne plus traiter son voisin en étranger, mais aussi cesser de considérer l’arbre au coin de la rue comme un décor entretenu par des employés municipaux. C’est produire une relation différente avec les autres et avec soi, où la fraternité ne découle pas d’un principe, mais d’une pratique qui inclut une lutte, y compris violente, y compris armée ».
[30] Asaf Bayat, Revolution without Revolutionaries : Making Sense of the Arab Spring, Stanford University Press, 2017, xi.
[31] Michael Lind, « The Double Horseshoe Theory of Class Politics », The Bellows, 16 juillet 2020.
[32] Carl Schmitt, Staat, Bewegung, Volk, Hanseatische Verlagsanstalt, 1933.
[33] Voir Gilles Dauvé, « Yellow, Red, Tricolour, or : Class & People », juin 2019. Voir aussi Temps Critiques, L’évènement Gilets Jaunes, mai 2019.
[34] Voir le point huit de nos Thèses de LA : « Voilà ce que nous voulons dire quand nous affirmons que la conscience de classe, aujourd’hui, ne peut être que la conscience du capital. Dans la lutte pour leur vie, les prolétaires doivent détruire ce qui les sépare. Dans le capitalisme, ce qui les sépare est aussi ce qui les unit : le marché constitue à la fois leur atomisation et leur interdépendance. C’est la conscience du capital comme notre unité dans la séparation qui nous permet de poser à partir des conditions existantes – même si ce n’est que comme négatif photographique – la capacité de l’humanité au communisme ».
[35] Voir Gáspár Miklós Tamás, « Telling the truth about class », Socialist Register, 2006.
[36] La fragmentation de la gauche chilienne en une myriade de partis, de sectes et de groupes montre que le gauchisme lui-même est devenu une identité parmi d’autres, une identité qui n’est pas en soi d’une grande importance pour le succès et l’évolution des non-mouvements.
[37] Ici et dans le titre, nous faisons allusion à l’essai classique d’Amadeo Bordiga intitulé « Avanti, Barbari ! », Battaglia Comunista n° 22, 1951 (traduit en français ici, NdT). Pour une étude plus approfondie de la notion de barbarie, voir Robert Hullot Kentor, « What Barbarism Is », Brooklyn Rail, février 2010. Dans son récent ouvrage intitulé « The Decadent Society », Ross Douthat affirme que les barbares sont trop « désorganisés, mal dirigés, conspirateurs et anti-intellectuels » pour menacer notre « société décadente ». De manière révélatrice, le pop-conservateur américain ne se contente pas de mépriser les masses qui rejettent la famille, le travail et même le sexe ; il révèle que la seule chose que les conservateurs d’aujourd’hui peuvent espérer conserver est le progrès capitaliste. Mais les non-mouvements annoncent la fin de ce progrès et indiquent que la décadence est peut-être la seule façon de sortir de notre impasse. C’est ce que T. W. Adorno a failli voir dans son brillant essai sur Le Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler : « Dans le monde de la vie violente et opprimée, la décadence qui refuse d’obéir à cette vie, à sa culture, à sa brutalité et à son caractère sublime, est le refuge du meilleur. Ceux que, selon le commandement de Spengler, l’histoire écarte et anéantit, impuissants, incarnent négativement, à l’intérieur de la négativité de cette culture, ce qui malgré sa faiblesse promet d’en briser le diktat et de mettre fin à l’horreur de la préhistoire. Leur protestation est le seul espoir de voir le destin et le pouvoir privés du dernier mot. Au déclin de l’Occident ne s’oppose pas la résurrection de la culture, mais l’utopie que renferme dans une question muette l’image de celle qui décline. » T. W. Adorno, « Spengler après le déclin », Prismes. Critique de la culture et société, trad. G. Rochlitz et R. Rochlitz, Paris, Payot & Rivages, 2010 (1955), pp. 82-83.
[38] NdT : Issu de l’opinion publique anglophone et s’inspirant de l’effondrement du grand parti grec Pasok qui n’obtenait plus que 4,7% des votes en 2015, ce terme désigne le processus de déclin électoral des partis social-démocrates liés à l’ancien mouvement ouvrier. Plus généralement, il renvoie au mouvement de désintégration du champ politique classique. Ce phénomène est transnational : le parti néerlandais Partij von de Arbeit totalisait 5,7% des votes en 2017 et en Pologne, le plus grand pays de l’Europe de l’est, on ne compte déjà plus de parti social-démocrate. Le PS est dans une crise électorale depuis 2016, de même que son homologue de l’autre côté du Rhin, le SPD.
[39] Pour les éléments concernant la composition du soulèvement de George Floyd, voir la section 5 ci-dessous.
[40] Cette dernière est devenue la plus longue grève générale de l’histoire française, vaincue uniquement par le renforcement des mesures de confinement. Voir Rona Lorimer, « French Strike in the State of Exception », Endnotes, septembre 2020.
[41] C’est le cas même lorsqu’ils aboutissent à une (potentielle) nouvelle constitution comme au Chili, puisque ce changement signifie moins le passage à une nouvelle normalité que le durcissement d’une situation ingouvernable. Les 80 % qui ont voté pour la nouvelle constitution ont également voté pour qu’elle soit rédigée par d’autres que les politiciens au pouvoir, et même si les partis vont probablement coopter ce processus, le vote lui-même était sans doute un vote contre le système politique.
[42] Le racisme est l’injustice américaine par excellence, celle qui semble résumer toutes les autres et qui représente la quintessence de l’arbitraire et donc du mal. L’antiracisme offre ainsi le principe unificateur dont les Américain·es misérables manquent par ailleurs. Il leur permet de suspendre temporairement leurs différences par l’unification contre un mal largement honni. Mais nous soutenons ci-dessous qu’à un niveau plus profond, le dégoût pour les flics racistes reflète la frustration et la colère anti-politiques que beaucoup ressentent déjà envers ce régime de crise. Bien sûr, « l’antiracisme » peut recouvrir des significations très variées selon les personnes. Pour Joseph Rosenbaum et Anthony Huber, qui ont été tués par un agent de sécurité privé adolescent à Kenosha dans le Wisconsin, cela voulait clairement dire se joindre à leurs voisins noirs pour combattre une force de police qui les avait également victimisés. Comme le commente l’ami de Huber : « Je ne dirais pas qu’il était politique, mais je pense qu’il détestait vraiment les racistes ». De l’autre côté, pour Mark Mason, directeur financier de Citigroup, « l’antiracisme » signifie la double opportunité d’être récompensé et reconnu par ses associés blancs, en affirmant publiquement que lui et George Floyd partageaient une expérience commune de l’oppression. Voir les parties 4 et 5 ci-dessous.
[43] Pour Cowen, la surcapacité industrielle a divisé les États-Unis en un système bimodal : « une nation fantastiquement performante, travaillant dans les secteurs technologiquement dynamiques et tous les autres », Tyler Cowen, Average is over : Powering America beyond the Age of the Great Stagnation, Plume, 2014.
[44] Pour une réflexion intéressante sur la croissance du populisme de droite comme réaction à la révolution des valeurs que 1968 est susceptible de symboliser, voir Pippa Norris & Ronald Inglehart, Cultural Backlash : Trump, Brexit, and Authoritarian Populism, Cambridge University Press, 2018.
[45] Les Trump et les Bolsonaro du monde produisent la base d’un bouleversement social plus général qui a le potentiel de dépasser sa forme démocratique et libérale actuelle. Il semble peu probable que les Bidens de la planète puissent arrêter ce processus. Peut-être peuvent-ils plus facilement démobiliser les classes moyennes et bloquer la convergence interclassiste dans les rues qui est nécessaire au changement définitif. Pourtant, comme Obama n’a pas pu entraver Occupy ou Black Lives Matter, et que Macron a clairement alimenté les Gilets Jaunes, notre pari est que la défaite électorale de Trump ne pourra ni stabiliser le statu quo, ni nous libérer du danger de la démocratie illibérale. La crise de la représentation est plus profonde que Trump et les divisions politiques qu’il entraîne continueront à gangrener notre monde sous la présidence de Biden. Cela pourrait faire gagner du temps au système, mais cela ne rendra pas le capitalisme moins ingouvernable.
[46] Timothy Garton Ash, « Revolution: The Springtime of Two Nations », The New York Times, 15 Juin 1989.
[47] Robert Kurz, Der Kollaps der Modernisierung: Vom Zusammenbruch des Kasernen-Sozialismus zur Krise der Weltökonomie, Eichborn, 1991.
[48] Amadeo Bordiga, « Eléments d’orientation marxiste », Prometeo n°1, Juillet 1946.
[49] Ibid.
[50] Thomas Piketty, « Gauche Brahmane contre droite marchande », Le Grand Continent, avril 2018. NdT : Par ce terme renvoyant aux castes supérieures indiennes, Piketty signifie que la gauche est devenue le parti des classes intellectuelles.
[51] Voir également Paul Mattick, Marxisme, dernier refuge de la bourgeoisie ? Editions Entremonde, 2011.
[52] L’argument de Bordiga était que le fascisme manquant de légitimité, il aurait radicalisé la lutte des classes. Il affirma en 1947 dans un texte important que « la succession n’est pas : fascisme, démocratie, socialisme, mais plutôt : démocratie, fascisme, dictature du prolétariat. » Voir Tendenze e Socialismo, Prometeo, janvier-février 1947. Les rêveries contre-factuelles de Bordiga ne devraient pas être ignorées, mais elles ont tendance à devenir une forme de fiction perverse et peuvent être comparées à Swastika Night (1937) de Katherine Burdekin ou au Maître du Haut Château (1962) de Philip K. Dick. NdT : Pour une critique de ces positions, voir le texte de Commune que nous avons traduit.
[53] David Ranney, New World Disorder (2014).
[54] L’âge et l’éducation peuvent bien entendu être pensés à travers la classe. « L’âge » dans le sens de la génération des boomers qui ont bénéficié de la social-démocratie (en achetant des propriétés qui sont maintenant une source de richesse), « l’éducation » dans le sens où la « démocratisation » de l’éducation supérieure n’a pas été un processus uniforme, et que beaucoup sont encore exclus de l’université.
[55] Amadeo Bordiga, Eléments d’orientation marxiste, Prometeo n°1, 1946.
[56] Ibid.
[57] Ibid.
[58] Ibid.
[59] Ibid.
[60] Comme un camarade l’a récemment affirmé à propos du soulèvement pour George Floyd, « l’activité révolutionnaire doit être évaluée à sa capacité à être défendue durablement par le plus de personnes possibles. Quand la violence révolutionnaire tend à isoler les participant·es plutôt qu’à les défendre, elle fait plus de mal que de bien », At the Wendy’s: Armed Struggle at the End of the World, Ill Will, 9 novembre 2020.
[61] À propos de la victoire de Biden et de la polarisation politique qu’elle entraînera, Moisés Naím a écrit avec éloquence que « La polarisation ne dérive pas seulement du ressentiment causé par les difficultés économiques ou de l’acharnement apporté par les réseaux sociaux. L’anti-politique – le rejet total de la politique et des politiciens traditionnels – en est une autre raison importante. Les partis politiques doivent à présent faire face à une multitude de nouveaux concurrents (“mouvements”, “vagues”, “factions”, ONG) dont le programme est fondé sur la répudiation du passé et sur des tactiques favorisant l’intransigeance. », Moisés Naím, « The Winner of the US election ? Polarisation », El País, 24 novembre 2020.
[62] Une éruption révolutionnaire pourrait signifier un shutdown encore plus radical de l’économie.
[63] Perry Anderson, « Bouillonnement antisystème en Europe et aux Etats-Unis », mars 2017.
[64] NdT : « Persistance d’un phénomène quand cesse la cause qui l’a produit », définition CNRTL.
[65] Voir René Riesel et Jaime Semprun, Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable : « En tant que fausse conscience qui naît spontanément du sol de la société de masse – c’est à dire du “milieu anxiogène” qu’elle a partout créé -, la catastrophisme exprime bien sûr avant tout les peurs et les tristes espoirs de tous ceux qui attendent une sécurisation par le renforcement des contraintes. Pourtant on y perçoit aussi, parfois assez nettement, une attente d’une toute autre nature : l’aspiration à une rupture de la routine, à une catastrophe qui serait véritablement un dénouement, qui rouvrirait l’horizon en faisant s’effondrer, comme par enchantement, les murs de la prison sociale. Cette catastrophilie latente peut trouver à se satisfaire dans la consommation de nombreux produits de l’industrie du divertissement élaborés à cette fin ; pour le tout venant des spectateurs, ce plaisir-angoisse suffira ».
[66] Jacques Camatte avançait déjà en 1977 que l’utopie d’un monde au-delà du travail tendait à devenir une forme de rêve capitaliste dans un monde post-industriel. Il écrit ironiquement que « La revendication de l’abolition du travail est aussi un élément de l’utopie capital : réaliser une humanité anodonte et phocomœle, sinon par disparition effective des dents et des membres antérieurs, mais à la suite de leur non utilisation ; l’homme devenant dépendant du capital, son usager parasite. », Jacques Camatte, La révolte des étudiants italiens, Invariance, série III, n°5 & 6, 1980.
[67] Angry Workers of the World, « The necessity of a revolutionary working class program in times of coup and civil war scenarios », octobre 2020.
[68] Cette dernière proposition demande une enquête collective sur la manière dont les non-mouvements expriment un véritable besoin de dépasser les bases de la vie présente du prolétariat (et dans une large mesure de la classe moyenne), ce qui nous maintient divisé·es et pris·es dans des conflits identitaires.
[69] Amadeo Bordiga, « The immediate program of the revolution », Sul filo del tempo, Mai 1953.
[70] Voir la note 34.
[71] Aujourd’hui, le grand public exprime souvent son enthousiasme pour la destruction de biens et la profanation de certains monuments. Voir Mathew Impelli, « 54 Percent of Americans Think Burning Down Minneapolis Police Precinct Was Justified After George Floyd’s Death », Newsweek, 3 juin 2020.
[72] Silvia Staubli, Trusting the Police : Comparisons across Eastern and Western Europe (Transcript, 2017).
[73] « [La violence de la police] est informe, comme son apparition nulle part saisissable, omniprésente et fantomatique dans la vie des États civilisés. Et la police peut bien être partout égale à elle-même, y compris dans des cas individuels, on ne peut finalement pas méconnaître que son esprit est moins dévastateur quand elle représente, dans une monarchie absolue, la violence du souverain, où s’unissent les pleins pouvoirs législatifs et exécutifs, que dans des démocraties où sa présence, qui n’est rehaussée par aucune relation de ce genre, atteste de la plus grande dégénérescence concevable de la violence. », Walter Benjamin, Critique de la violence, Payot, p. 73.
[74] « Je n’ai pas un amour particulier pour l’« ouvrier » idéalisé tel que se le représente l’esprit bourgeois du communiste, mais quand je vois un véritable ouvrier en chair et en os en conflit avec son ennemi naturel, l’agent de police, je n’ai pas besoin de me demander de quel côté je suis. ». George Orwell, Hommage à la Catalogne, éditions Gallimard, p. 148. Notons cependant que les prolétaires comptent parfois sur la police pour résoudre les conflits, venger leurs blessures et protéger leurs biens et leur dignité contre les menaces provenant de l’intérieur et de l’extérieur de leurs communautés.
[75] NdT : « Blue Lives Matter » – un slogan derrière lequel se rassemblent des policiers étasuniens, comme pour parodier celui de Black Lives Matter.
[76] « Le “droit” de la police désigne bien davantage, au fond, le point où l’État, soit par impuissance, soit à cause de la logique immanente à tout ordre juridique, ne peut plus garantir avec les moyens de cet ordre les fins empiriques qu’il veut atteindre à tout prix. Ainsi, pour “garantir la sécurité”, la police intervient dans d’innombrables cas où n’existe aucune situation juridique claire, quand elle n’accompagne pas le citoyen comme une contrainte brutale, sans aucune relation avec des fins légales, à travers une vie réglée par des ordonnances, ou simplement le surveille. », Walter Benjamin, Critique de la violence, Payot, p. 72.
[77] « Pourquoi donc nous insulter de ces mots de vil, de bassesse, de bâtardise? Vils ! vils ! Nous qui, dans le vigoureux larcin de la nature, puisons une constitution plus forte et des qualités plus énergiques qu’il n’en entre dans un lit ennuyé, fatigué et dégoûté, dans la génération d’une tribu entière d’imbéciles engendrés entre le sommeil et le réveil ! Ainsi donc, légitime Edgar, il faut que j’aie vos biens : l’amour de notre père appartient au bâtard Edmond comme au légitime Edgar. Légitime ! le beau mot ! À la bonne heure, mon cher légitime ; mais si cette lettre réussit et que mon invention prospère, le vil Edmond passera par-dessus la tête du légitime Edgar. —Je grandis, je prospère ! Maintenant, dieux ! rangez-vous du parti des bâtards. », William Shakespeare, Le Roi Lear, acte I, scène 2.
[78] « Lors de l’affrontement – car il est inévitable – avec les différents individus soutenant le MPC [Mode de Production Capitaliste], il s’agit de ne pas réduire l’adversaire à un stade « bestial » ou mécanique, mais de le poser dans son humanité, celle qui croit posséder et celle qu’il peut, potentiellement, retrouver. Le combat concerne alors aussi le domaine spirituel, conscientiel. Il faut prouver la mystification de la représentation qui justifie l’individu dans sa défense du capital, mettre ces êtres en contradiction, leur donner le doute. », Jacques Camatte, « Contre la domestication », Invariance, série II, n°3, 1973.
[79] Ibid.
[80] Ibid.
[81] Éric Hazan, « Sur la police, une opinion minoritaire », Lundi Matin, 18 avril 2016.
[82] En développant la distinction établie par Sorel entre la grève générale politique et la grève générale prolétarienne, Benjamin écrit : « Tandis que la première forme d’arrêt du travail est une violence, car elle ne provoque qu’une modification extérieure des conditions de travail, la seconde en tant que moyen pur est sans violence. Car elle ne se déclenche pas avec l’arrière-pensée de reprendre l’activité après des concessions superficielles et une modification quelconque des conditions de travail, mais avec la résolution de ne reprendre qu’un travail entièrement changé, non imposé par l’État ; bouleversement que cette sorte de grève provoque moins qu’elle ne le réalise. », Walter Benjamin, Critique de la violence, Payot, p. 82.
[83] Ruth Gilmore, Golden Gulag : Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California, University of California, 2007, p. 178.
[84] L’enjeu n’est pas seulement que les dépenses pour la police et les prisons ne représentent (et ne représenteront jamais) qu’une infime partie des dépenses sociales, mais aussi qu’aux États-Unis, cette forme d’austérité est inscrite dans le système fédéral de taxation et de dépenses, car les administrations municipales qui financent la police sont celles qui ont le moins de capacité à générer des revenus. Voir Eric Levitz, « Defunding the Police Is Not Nearly Enough », New York Magazine, 12 juin 2020.
[85] Voir Tristan Leoni, « Abolir la Police », DDT21, Septembre 2020. Voir aussi l’exemple de Camden discuté plus bas.
[86] Voir Marie Gottshaulk, The Prison and Gallows (Cambridge University Press, 2006) sur le rôle clef de la démocratie et du « droit des victimes » dans la construction de l’État carcéral étasunien.
[87] Voir Gilles Dauvé, « Pour un monde sans morale » (1983) et La Banquise, « Pour un monde sans innocents », (1986). Comme le dit « Pour un monde sans morale » : « Le communisme est une société sans monstre ».
[88] Les États-Unis se situent au 30e rang mondial pour le nombre d’homicides commis par la police par habitant, mais occupent la première place parmi les pays riches. Sur le vigilantisme, voir Christopher Waldrep, The Many Faces of Judge Lynch (Palgrave, 2002), qui met en avant la tradition américaine de souveraineté populaire, ainsi que le scepticisme de l’époque révolutionnaire envers l’autorité judiciaire, pour expliquer sa prédilection de longue date pour le lynchage.
[89] Voir, par exemple John Dollard, Caste and Class in a Southern Town (Double Day, 1937). Des travaux récents de Gabriel Lenz indiquent que le taux d’homicide des Noirs dans les villes du Sud à cette époque était plus élevé qu’à tout autre endroit et à toute autre époque de l’histoire américaine. Sur les réactions politiques des Noirs à la « sous-police », voir James Forman Jr, Locking Up Our Own (Farrar, Straus et Giroux, 2017).
[90] NdT : Le Capitol Hill Autonomous Zone est un territoire communautaire de Seattle revendiquant une autonomie politique, fondée après la mort de George Floyd. Il fut évacué au bout d’un mois.
[91] Christopher Rufo, « The End of Chaz », City Journal, 1er juillet 2020. Sur la base de deux homicides (et de quatre fusillades supplémentaires) au cours de ses vingt-quatre journées d’existence, Rufo a estimé le taux d’homicide du CHAZ à 1.216 pour 100 000 habitants. Ce chiffre est bien sûr gonflé par la petite taille du CHAZ, mais même si nous devions supposer que l’estimation de Rufo est fausse d’un facteur 10, le CHAZ aurait quand même eu le double du taux d’homicide le plus élevé au monde (un record actuellement détenu par le Salvador, avec 61 homicides pour 100 000 habitants en 2017).
[92] Camden, que certain·es considèrent comme l’exemple à suivre pour l’ensemble des États-Unis, a simplement remplacé le service de police de la « ville » par un service de police du « comté » (principalement pour démanteler les syndicats de police) et réembauché tous les policiers tout en en recrutant beaucoup d’autres (la ville a maintenant l’une des plus grandes forces de police par habitant du pays). Cf. Joseph Goldstein et Kevin Armstrong, « Could This City Hold the Key to the Future of Policing in America », New York Times, 12 juillet 2020. Minneapolis a récemment créé le « bureau de prévention de la violence » [office of violence prevention], ce qui indique au moins une stratégie de re-nomination plus créative.
[93] Une milice noire avait apparemment collaboré auparavant avec des membres des boogaloo boys pour protéger des propriétés privées – un exemple de ce que nous avons appelé plus haut « un front transversal digne de l’ère QAnon ». Nevada, « Imaginary Enemies : Myth and Abolition in the Minneapolis Rebellion », Ill Will, 17 novembre 2020.
[94] Gilles Dauvé et Karl Nesic, « Jailbreak » dans An A to Z of Communisation, Troploin, 2015.
[95] Nevada, « Imaginary Enemies ».
[96] Ce désordre divise la population selon les lignes fascisme/antifascisme et fait resurgir le spectre de la lutte armée. Comme l’ont récemment écrit certains camarades, « dans le moment actuel, les forces réactionnaires veulent nous entraîner dans une guerre culturelle et des affrontements armés – un type de lutte dans lequel la classe ouvrière ne peut que perdre. » Angry Workers of the World, « The necessity of a revolutionary working class program in times of coup and civil war scenarios », Let’s Get Rooted, octobre 2020.
[97] Giorgio Agamben, « Vers une théorie de la puissance destituante » (ce texte a été lu à Athènes en 2013). Agamben cite ici Pasolini qui paraphrasait lui-même Sade.
[98] Le discours de Piñera est disponible sur YouTube.
[99] Voir nos « LA Theses » (2016), notamment la cinquième thèse : « Dans le même temps, le déclin de l’identité ouvrière révéla une multiplicité d’autres identités, s’organisant par rapport à des luttes jusqu’alors plus ou moins réprimées. Les “nouveaux mouvements sociaux” qui en résultent ont montré clairement, en retour, dans quelle mesure la classe ouvrière homogène était en réalité de nature composite. Ils ont aussi établi que la révolution doit impliquer plus que la réorganisation de l’économie : elle exige l’abolition des distinctions de genre, de race et de nation, etc. Mais dans la confusion des identités émergentes, chacune avec ses propres intérêts sectoriels, on ne sait pas exactement ce que doit être cette révolution. Pour nous, la population excédentaire n’est pas un nouveau sujet révolutionnaire. Il s’agit plutôt d’une situation structurelle dans laquelle aucune fraction de la classe ne peut se présenter comme le sujet révolutionnaire ».
[100] Eric Hobsbawm, « Identity Politics and the Left », New Left Review, mai/juin 1996. La dépendance du mouvement ouvrier officiel à l’égard de la croissance économique nationale explique pourquoi son universalisme a rarement dépassé la figure du citoyen et les deux appareils qui l’ont façonné : l’usine et l’État. La politique identitaire représente la crise de ce monde.
[101] Voir les sections 122-124 de Apocalypse and Revolution et le commentaire des traducteurs dans Endnotes 5, p. 299. Il est intéressant de noter que Cesarano place les ouvriers et les employés aux côtés des autres « mouvements de libération contre-révolutionnaires ».
[102] NdT : « Basket of deplorables », une expression particulièrement méprisante employée par Hillary Clinton durant la campagne de 2016 pour désigner « la moitié de l’électorat de Trump » qui est « raciste, sexiste, homophobe, xénophobe, islamophobe ».
[103] Bart Bonikowski et Daniel Ziblatt, « Mainstream conservative parties paved the way for far-right nationalism », Monkey Cage Symposium, The Washington Post, 2 décembre 2019.
[104] Shemon et Arturo, « Theses on the George Floyd Rebellion », Ill Will, 24 juin 2020.
[105] Les blanc·hes n’étaient pas majoritaires dans les villes noires comme Atlanta et Détroit, mais iels étaient surreprésenté·es dans les rues proportionnellement à leur part dans la population de ces villes. Notez que la signification de la « blanchité » est elle-même changeante. De moins en moins d’immigrants et d’enfants issus de couples métis choisissent aujourd’hui de s’identifier comme « blancs ». Si, à l’instar d’Ignatiev, nous considérons l’essence de la blanchité comme le privilège supposé de « devenir blanc », il semble que de nombreux Américain·es le rejettent aujourd’hui. Voir Paul Gilroy, « Whiteness Just Ain’t Worth What it Used to Be », The Nation, 28 octobre 2020.
[106] Pour les enquêtes d’opinion publique sur la participation aux manifestations, voir Larry Buchanan et al. « Black Lives Matter May Be the Largest Movement in US History », ainsi que les rapports ultérieurs du Pew Research Center et de Civis Analytics. Dana Fischer et ses collègues ont mené des enquêtes de foule (crowd surveys) et en rendent compte ici et ici . Des résumés des premières données sur les arrestations sont rapportés par le Washington Post et le Marshall Project. Enfin, on peut consulter le rapport d’une société de technologie (retiré depuis en raison de pressions politiques) sur les données démographiques des utilisateur·ices de téléphones portables géolocalisé·e·s dans les zones géographiques et les périodes d’émeutes. Tous ces rapports suggèrent que les Blanc·hes étaient soit majoritaires, soit surreprésenté·es dans les manifestations par rapport à leur part de la population de la ville concernée. Cela a donné lieu à de nombreuses critiques de la part des politiciens noirs et démocrates locaux menacés par les manifestations.
[107] La conclusion de notre article Brown v Ferguson est ici pertinente : « Si la race peut se présenter comme la solution à une énigme compositionnelle [compositional riddle, NdT], en faisant apparaître une nouvelle unité par des modulations descendantes [descending modulations, NdT], cette unité elle-même débouche sur une autre impasse compositionnelle, car une nouvelle descente menace de la défaire. Maintenant que le ghetto a redécouvert sa capacité à se révolter, et à forcer le changement en le faisant, est-ce que d’autres composantes, plus grandes, des pauvres d’Amérique – blancs et latinos – demeureront passifs ? ».
[108] Voir We Still Outside Collective, « On the Black Leadership and Other White Myths », Ill Will, 4 juin 2020 et Idris Robinson, « How It Might Should be Done », Ill Will, 20 juillet 2020.
[109] Bien sûr, une grande partie de ces actions avaient également une dimension performative, mais il s’agissait de performances qui servaient un objectif collectif pratique (la lutte contre une police brutale et raciste) plutôt qu’une tentative des individus d’obtenir un rang, une reconnaissance ou une rédemption symbolique.
[110] NdT : Race Traitor est une revue antiraciste fondée par l’historien étasunien Noel Ignatiev appelant à l’abolition de la blanchité.
[111] Même si les causes de la confusion préexistaient certainement et survivront aux luttes elles-mêmes.
[112] Le sentiment d’isolement social semble s’accroître dans de nombreux pays développés et pourrait être un autre facteur expliquant la vague de révoltes de ces dernières années. Voir Bianca DiJulio et al, Loneliness and Social Isolation in the United States, the United Kingdom, and Japan : an international survey (Kaiser Family Foundation, 2018).
[113] Robinson, « How It Might Should be Done ».
[114] Angry Workers décrit le besoin d’« une organisation qui soit enracinée au sein des travailleur·ses de la technologie sans se plier à leur hauteur intellectuelle. Au sein des travailleur·ses productif·ves de masse sans finir par encourager leur corporatisme syndical. Au sein des pauvres sans attiser leurs illusions insurrectionnelles et leurs tendances populistes », « The necessity of a revolutionary working class program in times of coup and civil war scenarios ».
[115] Angry Workers décrit le besoin d’« une organisation qui soit enracinée au sein des travailleur·ses de la technologie sans se plier à leur hauteur intellectuelle. Au sein des travailleur·ses productif·ves de masse sans finir par encourager leur corporatisme syndical. Au sein des pauvres sans attiser leurs illusions insurrectionnelles et leurs tendances populistes », « The necessity of a revolutionary working class program in times of coup and civil war scenarios ».
[116] « Staline, comme plus tard Mao, Ho-Chi-Minh, etc., incarnait pour Bordiga la figure du « grand révolutionnaire romantique » au sens du XIXeme siècle, c’est-à-dire bourgeois : les régimes staliniens nés après 1945 ne faisaient qu’étendre la révolution bourgeoise, l’armée Rouge aidant à exproprier la classe prussienne des Junkers, et ouvraient ainsi la voie à une nouvelle politique agraire et à l’essor des forces productives. Contre Socialisme ou Barbarie, qui dénonçait ces régimes comme capitalistes d’État, Bordiga répliqua par « En Avant les barbares ! » (« Avanti barbari ! »), saluant l’aspect révolutionnaire bourgeois du stalinisme comme son seul contenu réel. », Loren Goldner, « Le communisme est la communauté humaine matérielle : Amadeo Bordiga et notre temps », Critique n° 23, 1991.

FD, mars 2023
Quand on parle de communisation, il faut toujours montrer que la fin de l’affirmation de la classe exploitée comme rivale de la classe capitaliste pour la gestion de la société n’a pas coïncidé avec un échappement du capital à la nécessité d’exploiter le travail productif pour se valoriser. En d’autres termes, il faut toujours montrer que le prolétariat n’a pas été dissous dans la société du capital ; ce qui a réellement été détruit, c’est l’ancien rapport du prolétariat au capital, sa capacité objective à se poser pour soi, face à la classe capitaliste, comme l’élément positif venant faire éclater la contradiction de l’exploitation en libérant la classe du travail de celle du capital, alors jugée parasite. Dans le même mouvement, l’ancienne théorie communiste, comme programme de cette affirmation prolétarienne, est devenue caduque. Et puisque l’autoprésupposition du rapport d’exploitation est inhérente à sa reproduction, toujours contradictoire, c’est donc l’identité ouvrière, un temps reconnue par la classe capitaliste dans l’autoprésupposition du mode de production, qui a été détruite.
Durant l’ancien cycle fordiste, de la Révolution russe de 1917 à la crise économique mondiale des années 1970, cette identité, matérialisée par les forteresses des grandes usines et régions ouvrières, était produite par les obstacles à l’autovalorisation du capital apparaissant aux trois niveaux du procès de travail, de la reproduction de la force de travail, et du rapport des capitaux entre eux. Par la restructuration du système d’exploitation, dans les décennies 1970 et 1980, ces obstacles ont été supprimés et le double mouvement du rejet constant de l’ouvrier salarié sur le marché comme vendeur de sa force de travail et de la transformation constante de son produit en moyen d’achat pour le capitaliste est devenu adéquat à la production de survaleur relative. Sous la direction du capital financier, ce résultat a été produit au niveau global, de sorte qu’on peut désigner le cycle d’accumulation et de luttes qui s’achève comme celui de la globalisation de l’exploitation, chaque fraction du capital total devant désormais pouvoir s’échanger contre la fraction adéquate du travail total, sur toute la planète. Ainsi, par l’effet conjoint de la compression des salaires réels et de l’augmentation des journées de travail simultanées, l’extraction de la survaleur sur le mode absolu a été liée à son extraction sur le mode relatif, qui reste dominant. Du coup, le travail productif nécessaire à la valorisation qui, essentiellement, était déjà toujours de trop, l’est devenu visiblement, comme travail toujours plus précarisé et donc toujours plus vite rejeté comme de trop.
Cette recomposition capitaliste du prolétariat s’est produite comme une recomposition de toute la société et donc, sur la base de la contestation généralisée des années 1970, comme une prolifération de nouveaux mouvements sociaux non classistes. Ces mouvements (féministes, écologistes, antiracistes, etc) ont participé de leur côté à la destruction capitaliste de l’identité ouvrière et donc à la décomposition de la théorie programmatique de l’affirmation de la classe. C’est ainsi que la révolte prolétarienne de 1977, en Italie, a pu être analysée par Bologna comme celle de la « tribu des taupes », concept absolument non classiste agglomérant de nombreux sujets collectifs (les taupes) en un super-sujet révolutionnaire (la tribu) et venant remplacer le concept antérieur encore classiste d’ouvrier social. Par la suite, la destruction mondiale de l’identité ouvrière étant accomplie avec la fin du régime de développement socialiste en Chine et l’effondrement du bloc socialiste eurasiatique formé autour de la Russie, la restructuration capitaliste a continué comme restructuration sans fin, car le développement du rapport d’exploitation peut toujours négliger voire créer des rigidités à supprimer. Et c’est sur la base de cette restructuration sans fin, dans le devenir société du mode de production capitaliste, que le concept du capital comme contradiction en procès entre classes, càd le concept du prolétariat comme classe révolutionnaire en tant que classe productrice du capital, a pu apparaître à certains groupes communistes comme une impasse.
Sur la base de la restructuration capitaliste accomplie, dans l’élan des anti-sommets de 1999-2001, à travers la critique du démocratisme radical, s’est développé ensuite un micro-milieu révolutionnaire international théorisant l’abolition sans transition du capital, càd la communisation, déjà posée comme but à la fin des années 1970. Ce milieu communisateur s’étant formé par la rencontre de groupes de divers pays liés au milieu activiste et d’un groupe français très critique de l’activisme, Théorie Communiste, un premier travail important fut accompli, dans le cadre du collectif Meeting, sur la déconnexion contre-productive entre la valorisation du capital, qui s’échappait par le haut, et la reproduction du prolétariat, qui s’échappait par le bas. Mais dans les années 2010, après la crise financière marquant l’entrée en crise du capitalisme restructuré, dans l’élan du soulèvement arabe, du mouvement Occupy Wall Street aux USA, et des mouvements interclassistes ultérieurs, la scission entre la conception classiste actualiste et la conception humaniste post-programmatique de la communisation était accomplie. Dans le milieu communisateur s’opposaient, d’un côté, le concept du prolétariat comme polarisation en procès de la contradiction capital (Théorie Communiste), de l’autre, le concept des mouvements sociaux actuels comme tendant à la communisation à titre humain (groupes liés à l’activisme, dont Endnotes). Mais si le terme de « non-sujet » était sans doute, dans le second collectif Sic, une concession formelle à la critique du sujet exposée par TC, celui, tout récent, de « non-mouvement », est tout bêtement construit en opposition non critique à l’ancienne conception programmatique de la lutte des classes. Dans cette perspective humaniste de la communisation, ces non-mouvements (au sens programmatique) sont des mouvements conçus comme déjà au-delà des classes, sous prétexte qu’ils ne s’intègrent pas théoriquement à la problématique de montée en puissance révolutionnaire du prolétariat exposée par les deux gauches communistes.
Ainsi, à travers la restructuration du capitalisme qui a détruit l’identité ouvrière et fait proliférer les identités non classistes, il est apparu que la contradiction en procès qu’est le capital ne se réduit pas à l’exploitation, au sens étroit càd programmatique du terme. En effet, d’une part, les contradictions prolétariat / capital et femmes / hommes se construisent l’une l’autre et construisent ainsi la contradiction totale en procès. D’autre part, il n’y a pas de nature révolutionnaire inhérente à la classe, qui subirait des éclipses historiques avant de se réaffirmer pour de bon dans la communisation. En réalité, le prolétariat n’est essentiellement révolutionnaire qu’en le devenant, à travers différents cycles de luttes correspondant plus ou moins à différents cycles d’accumulation du capital. Or dans celui qui maintenant s’achève, la contradiction entre surtravail et travail nécessaire est devenue contradiction du travail nécessaire lui-même, càd que le prolétariat, en chacun de ses segments particuliers, ne peut plus défendre son existence comme classe qu’en la mettant en cause, même si ce n’est en général pas sous la forme de déclarations fracassantes. En même temps, le mouvement de libération des femmes a donné pour contenu à la contradiction de genre la mise en cause de l’être femme, càd la mise en cause de l’assignation de la moitié de l’humanité à la reproduction du travail vivant. Enfin, les luttes des fractions racisées du prolétariat et la normalisation démocratique qu’elles ont suscitée (d’abord aux USA puis en Afrique du Sud) ont donné pour contenu aux luttes actuelles des racisé-e-s la mise en cause de la « race ».
D’une telle structure de la contradiction capital en procès, où le prolétariat recomposé apparaît, comme dans un kaléidoscope, infiniment divers et changeant, suivant les figures éphémères qu’il prend dans ses luttes, on peut déduire que la communisation est devenue dans le cours du cycle un processus très bordélique. Mais on ne peut pas soutenir qu’à partir de la simple prolifération des identités flottantes dans les mouvements qualifiés de non-mouvements va se produire un super-sujet communisateur à titre humain, comme le soutiennent les camarades du groupe Endnotes, notamment dans ce texte, « Barbares, en avant ! »
FD
mars 2023