Le blues de l’inflation
Traduction du dernier texte mis en ligne sur le blog de la revue « Endnotes ».. dndf
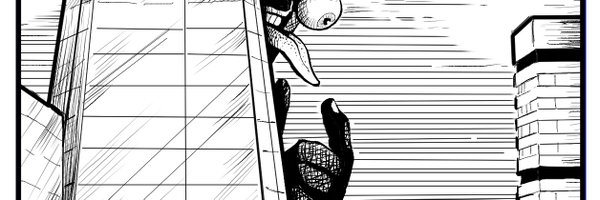
Le blues de l’inflation
par Pavlos Roufos
En 2022, le spectre de l’inflation a refait surface. De nombreux commentateurs de gauche, habitués à rejeter les inquiétudes liées à l’inflation en les qualifiant d’alarmisme de droite, ont semblé pris au dépourvu. Certains ont parlé d’un retour aux années 1970 et nous avons assisté à une recrudescence des luttes pour les augmentations de salaire et les factures de services publics. Dans le prolongement d’une interview accordée à Tous Dehors, nous avons demandé à Pavlos Roufos comment nous devrions comprendre l’inflation aujourd’hui.
EN : Qu’est-ce que l’inflation ?
Pavlos Roufos : Dans le langage courant, l’inflation est tout simplement une augmentation durable des prix. Mais cela n’a rien de simple. Quels sont exactement les prix qui augmentent ? Les mesures officielles de l’inflation (utilisées par les banques centrales, l’État et d’autres autorités financières) se fondent sur l’indice des prix à la consommation (IPC), c’est-à-dire un panier de produits spécifiques régulièrement consommés par les ménages. Cela signifie immédiatement que d’autres prix sont exclus : plus particulièrement, par exemple, alors que les coûts de location (logement) sont inclus dans l’IPC, les augmentations des prix de l’immobilier (considéré comme un « actif d’investissement ») ne le sont pas.1 Dans le monde dans lequel nous vivons, l’augmentation générale des prix sur le marché du logement est considérée comme une « croissance économique » (comme quelque chose de positif), tandis que l’augmentation des salaires est considérée comme quelque chose de menaçant qu’il faut écraser.
Une autre façon de décrire l’inflation est résumée par la phrase des économistes : « trop d’argent pour trop peu de biens ». Cela semble plus précis que la définition précédente, mais après avoir gratté la surface, toute une série de problèmes se révèlent : « Trop d’argent » par rapport à quoi ? Existe-t-il un montant d’argent fixe et objectif qui désigne une limite ? Comment est-elle calculée ? La deuxième partie de la phrase pose également des problèmes : « trop peu de biens » par rapport à quoi ? En général, bien sûr, la phrase est interprétée comme décrivant une relation entre les deux : il y a plus d’argent disponible que de biens/services existants. Mais cela n’est pas très utile non plus. Non seulement cela implique l’existence d’une relation supposée optimale entre « l’argent » et les biens/services tout en ignorant d’autres déterminants (la financiarisation en serait un évident), mais cela ne dit rien non plus sur les causes de l’inflation : comment en arrive-t-on à un tel déséquilibre entre « trop d’argent » et « trop peu de biens » ? Y a-t-il eu une poussée de la demande pour plus de biens ou une baisse de l’offre ?
Si l’on essaie de comprendre comment l’inflation se manifeste dans l’économie réelle, d’autres complications apparaissent. Comme l’a souligné la Banque des règlements internationaux dans un document récent, il existe une différence cruciale entre les variations des prix relatifs de produits spécifiques et l’inflation sous-jacente, une situation dans laquelle il y a une augmentation plus large et synchronisée des prix qui érode la valeur de la monnaie – ce qui signifie que ce que l’argent d’une personne peut acheter aujourd’hui n’est pas le cas pour demain. Au début de l’année 2021, nombreux étaient ceux qui affirmaient que l’inflation était un phénomène transitoire dû à des pénuries ou à des blocages temporaires de l’offre et de l’énergie qui pouvaient être résolus, c’est-à-dire que seuls des changements de prix relatifs se produisaient. Peu de temps après, cependant, on a craint qu’il ne s’agisse d’une inflation sous-jacente, affectant tous les prix et montrant des signes d’ancrage structurel, c’est-à-dire loin d’être transitoire. Maintenant que l’inflation semble s’être ralentie, la question de l’inflation transitoire est de nouveau à l’ordre du jour.
Si une chose est claire, c’est que l’inflation ne peut être comprise seule. Elle exprime un ensemble de relations et d’interactions entre monnaie, production, distribution, offre et demande, etc., catégories qui sont loin d’être simples en elles-mêmes, et encore moins les unes par rapport aux autres. Le regard que l’on porte sur ces relations peut difficilement être neutre, car il touche nécessairement à des questions profondément politiques. Les désaccords sur l’inflation (qu’il s’agisse de ses causes ou des mesures à prendre pour la combattre) reflètent des désaccords politiques sous-jacents. Le discours sur l’inflation peut donc éclairer ce que les gens pensent plus généralement de l’économie, de l’État, de la monnaie et du travail.
Par exemple, l’idée que des taux d’inflation supérieurs à 2 % sont une source d’instabilité s’est imposée dans certains cercles politiques. Cette idée est en fait assez récente : jusqu’aux années 1980, des taux d’inflation beaucoup plus élevés étaient normalisés et tolérés (voire soutenus dans certains cas). Il n’en reste pas moins vrai que l’inflation a toujours été considérée comme un phénomène destructeur dans une certaine perspective libérale ou néolibérale. La raison : l’inflation érode la valeur de la monnaie et, par conséquent, de la richesse. D’où l’obsession persistante de la « monnaie saine », un objectif politique consistant à maintenir l’inflation à des taux extrêmement bas (voire nuls). Ce n’est que dans ce contexte que l’on peut comprendre pourquoi la récente projection de la BCE d’une inflation de 4,2 % pour l’année prochaine est considérée comme suffisamment alarmante pour justifier un nouveau resserrement monétaire
E : D’accord, mais quelle est, selon vous, la cause de la récente poussée d’inflation ?
P : Il semble que trois facteurs soient à l’origine de l’inflation. Premièrement, les blocages de la chaîne d’approvisionnement, un résidu des restrictions et des fermetures de Covid, ont directement affecté l’approvisionnement mondial en marchandises. Ces restrictions ont eu tendance à être ressenties de manière plus aiguë dans certains produits de base, dont le rôle est assez central dans les différentes sphères de production.2 Beaucoup, par exemple, ont souligné la pénurie de semi-conducteurs qui a causé une série de contraintes sur la fabrication.3 Deuxièmement, la crise de l’énergie : les prix de l’énergie augmentaient déjà en 2021, mais cette hausse a été radicalement accélérée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les sanctions qui ont suivi et la décision de dissocier les économies (principalement, mais pas seulement, européennes) des sources d’énergie russes. Cela a notamment entraîné l’entrée soudaine de grands acteurs (tels que l’UE ou la Chine) sur le marché des alternatives énergétiques, ce qui a fait grimper les prix en flèche. Troisièmement, conséquence des deux précédentes, une nouvelle dynamique de la concurrence capitaliste, à savoir la capacité de certaines grandes entreprises à tirer parti des blocages de l’offre pour faire monter les prix, sachant que leurs concurrents étaient aussi limités qu’elles et ne pouvaient donc pas gagner des parts de marché en maintenant des prix bas, comme l’a récemment affirmé Isabella Weber.
En ce qui concerne la troisième raison, il est peut-être nécessaire d’apporter une précision supplémentaire. De nombreuses personnes, y compris à gauche, ont interprété l’inflation actuelle comme le résultat de la recherche de profits. Le problème de ce concept est qu’il implique un niveau de profit normal qui est acceptable et ne pose pas de problème, mais les entreprises profitent alors de conditions spécifiques pour engranger des profits excessifs. Cela occulte le fait que ce que l’on appelle la réalisation normale de profits, en tant que pierre angulaire de l’économie capitaliste, est en soi un processus totalement destructeur (la catastrophe climatique en étant l’exemple le plus évident). Le concept de profit suggère une sorte de corruption, une distorsion de la réalisation normale du profit, une forme d’excès inacceptable par rapport à une normalité capitaliste naturalisée.
En outre, certains ont lié la capacité des entreprises à tirer parti de situations historiques pour accroître leurs profits au concept de monopolisation. Du côté néolibéral, qui a une longue histoire d’opposition anti-monopole/anti-cartel, c’est logique : les monopoles faussent le marché et le mécanisme des prix et sont, en tant que tels, préjudiciables au fonctionnement de l’économie de marché. L’adoption par la gauche de la perspective anti-monopole reste cependant une énigme. Abstraction faite de la tendance persistante des staliniens à décrire les relations sociales capitalistes sous ce pseudonyme (c’est-à-dire le « capitalisme monopolistique »), s’opposer aux monopoles n’a de sens que dans la perspective d’un processus de concurrence plus efficace (c’est, bien sûr, la raison pour laquelle les néolibéraux sont si préoccupés par les monopoles). La critique de l’ordre capitaliste n’est cependant pas renforcée par la promotion d’un ordre plus compétitif.
En tout état de cause, nous ne vivons pas dans un monde de monopoles ou de cartels. Alors que certaines entreprises détiennent des parts de marché plus importantes et que la concentration du capital est un phénomène structurel de l’économie capitaliste, la concurrence reste le principal moyen par lequel les nœuds du capital sont reliés les uns aux autres – et les pressions inflationnistes d’aujourd’hui sont davantage liées à l’évolution de la dynamique de la concurrence qu’à son absence. Se lamenter sur l’absence de concurrence réelle entre les entreprises capitalistes n’est pas, et n’a jamais été, la tâche de ceux qui critiquent l’économie capitaliste.
E : Une autre théorie que l’on entend souvent est celle d’une spirale « salaires/prix ». La hausse des salaires a-t-elle contribué à l’inflation ?
P : La théorie de la spirale salaires/prix pourrait avoir un certain mérite s’il y avait effectivement une hausse des salaires. Le problème est que cela n’a pas été le cas. En fait, dans la plupart des pays développés, les salaires ont eu tendance à stagner, voire à baisser, ces dernières années. Même dans les secteurs où les travailleurs ont plus de poids (par exemple, les métallurgistes organisés en Allemagne), les négociations syndicales de l’année dernière n’ont abouti qu’à une augmentation salariale inférieure au taux d’inflation. À plus long terme, la croissance des salaires dans l’ensemble de l’économie a eu tendance à être inférieure à la croissance de la productivité, de sorte que la part des salaires a chuté de manière spectaculaire depuis les années 1970.
Il est vrai que dans certains secteurs et dans certains pays, nous avons observé des augmentations de salaires supérieures aux augmentations de productivité, comme dans le secteur des services aux États-Unis. Mais il est essentiel de garder deux choses à l’esprit : premièrement, la productivité du secteur des services a toujours tendance à être faible, ce qui n’a donc rien de surprenant. Deuxièmement, même si certains services américains ont connu de telles augmentations, il ne s’agit pas d’un phénomène général, que ce soit dans le secteur des services dans son ensemble ou dans d’autres économies en dehors des États-Unis, comme les économies européennes. Expliquer un changement de politique vers des taux d’intérêt plus élevés (ce qui signifie une récession) au niveau mondial en pointant du doigt un secteur spécifique aux États-Unis est tout simplement absurde.
Plusieurs raisons historiques expliquent cette tendance à la stagnation des salaires. Au niveau social, on peut souligner le déclin du mouvement syndical depuis les années 1970. Au niveau politique, on peut souligner la transformation de la social-démocratie et du réformisme en véhicules politiques de la néolibéralisation. Ces deux facteurs peuvent expliquer pourquoi les politiques économiques sont restées enfermées dans un paradigme néolibéral spécifique : l’absence d’antagonisme social effectif et la disparition des alternatives, même réformistes. Mais un cadre plus large est peut-être également nécessaire. À ce stade, le travail de Brenner offre une approche convaincante. Il met en évidence des facteurs déterminants tels que la surcapacité, la désindustrialisation, la libéralisation des flux de capitaux et la chute de la productivité qui en a résulté, la rentabilité à court terme ayant pris le pas sur une approche à plus long terme susceptible de combiner le capital et le travail de manière à améliorer la productivité. Enfin, nous pouvons souligner la prolifération de l’endettement des ménages (et la dynamique changeante du crédit et de la dette acquise sur les marchés mondiaux) comme un moyen de « masquer » la stagnation ou la baisse des salaires en offrant une augmentation fictive du pouvoir d’achat.
Revenons à la question de la spirale salaires/prix. Contrairement à la gauche de la « monnaie saine » qui considère également l’inflation comme une menace en soi parce qu’elle part du principe que les travailleurs ne seront pas en mesure de la combattre, les économistes traditionnels et les banques centrales craignent en fait que la hausse de l’inflation ne contraigne les travailleurs à exiger des salaires plus élevés pour compenser la baisse de leur pouvoir d’achat. Mais lorsque cela se produit, ils affirment que l’augmentation des coûts du travail « force » le capital à augmenter encore les prix afin de compenser la hausse des salaires.
Telle est leur vision de la spirale salaires/prix, où chaque partie pousse l’autre plus loin et où, en fin de compte, « tout le monde est perdant », comme le dit le récit officiel. Le fait que la seule solution « réaliste » à cette situation soit la baisse des salaires montre à quel point cette perspective est profondément politique et idéologique.
Quoi qu’il en soit, la réalité est que les autorités comme les banques centrales considèrent la modération salariale (c’est-à-dire la baisse des salaires) comme un moyen approprié de compenser l’inflation, quelles qu’en soient les causes. Que l’inflation actuelle soit due à la demande ou à l’offre, les banques centrales réagissent de la même manière : elles réduisent les salaires. En fait, elles disent aux gens : « Pour retrouver la stabilité monétaire, vous devez baisser les salaires : « pour retrouver la stabilité monétaire, il faut gagner moins ».
E : Qu’en est-il de l’assouplissement quantitatif (QE) ? Le fait que les banques centrales créent autant d’argent n’a-t-il pas contribué à l’inflation ?
P : Si l’on définit l’inflation comme « trop d’argent pour trop peu de biens », il est facile de ne considérer que la première clause et de se concentrer sur les variations de la masse monétaire. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont essayé de faire valoir que l’inflation actuelle est la conséquence tardive de l’injection massive d’argent dans l’économie par les banques centrales par le biais de programmes d’assouplissement quantitatif (achat d’obligations), mis en place après 2008 (pour la Fed) et 2014 (pour la BCE).
Le principal problème de ce discours est qu’il n’explique pas le décalage temporel : puisque l’assouplissement quantitatif a commencé il y a 15 ans, pourquoi n’a-t-il provoqué des pressions inflationnistes que maintenant ? Pourquoi pas avant ? L’augmentation sans précédent de la masse monétaire (nous parlons de milliers de milliards de dollars pour la seule Fed) aurait déjà dû se traduire par de l’inflation depuis longtemps. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé. En fait, si l’on suit les discussions des banques centrales jusqu’à l’année dernière, la menace réelle était l’inverse : la déflation.
Pour comprendre cela, il faut voir qu’une augmentation de la masse monétaire en soi ne nous dit pas grand-chose. Non seulement l’agrégat monétaire spécifique utilisé pour mesurer la « masse monétaire » est contesté, mais la vraie question est la suivante : « si les banques centrales ont imprimé autant d’argent, où cet argent est-il allé ? A-t-il été remis aux consommateurs pour stimuler la demande ? A-t-il été consacré aux dépenses publiques, à l’augmentation de la protection sociale, à l’augmentation des pensions ? A-t-il été consacré à des investissements productifs, à des réparations d’infrastructures, à la recherche ? En bref : l’assouplissement quantitatif a-t-il augmenté les dépenses globales et inversé des décennies de monétarisme en une nouvelle domination fiscale ? Il n’y a aucune preuve de cela. Mais nous savons que l’assouplissement quantitatif a été utilisé pour financer les rachats d’entreprises, qu’il a gonflé les marchés boursiers et les bulles immobilières, mais nous n’avons pas constaté d’augmentation durable des dépenses publiques ou des salaires.
Pour comprendre cela, je pense également qu’un cadre plus large est nécessaire, et je trouve le travail de Daniela Gabor indispensable : plutôt que de pointer vers un retour à la « domination fiscale » de l’État, Gabor montre que l’assouplissement quantitatif devrait être compris comme un mécanisme de soutien pour le régime macro-financier contemporain, où les marchés monétaires, les titres, les produits dérivés et autres instruments à haut risque reposent de plus en plus sur des garanties sûres. Pour Gabor, l’assouplissement quantitatif représente la transformation du marché des obligations d’État en une « usine à garanties » pour les marchés monétaires, plutôt qu’une machine à imprimer qui apporte de l’argent aux budgets des ménages ou des États. Si l’on relie cette idée au problème susmentionné de la baisse de la productivité (et, par conséquent, de la baisse du rendement des investissements en capital), on obtient une image différente où l’assouplissement quantitatif peut être considéré comme nécessaire à la stabilité du régime macrofinancier sans être capable de générer de la croissance ou de revenir à une domination fiscale de l’État.
De ce point de vue, il est clair que s’il y a eu une « inflation » causée par l’assouplissement quantitatif au cours des dernières décennies, il s’agissait d’une inflation des actifs. Ce qui est particulier dans certaines discussions récentes sur l’inflation à gauche, c’est que ce fait (la création d’une inflation des actifs et de bulles) est considéré comme une raison suffisante pour approuver la fin de l’assouplissement quantitatif et l’augmentation des taux d’intérêt, suggérant qu’un retour à une « monnaie saine » sera bénéfique pour les travailleurs qui voient leurs salaires érodés par l’inflation. Mais s’il serait absurde de soutenir qu’il existe une relation automatique entre l’inflation et les luttes des travailleurs, il est encore plus absurde de considérer qu’une récession induite par la politique, entraînant une forte contraction du pouvoir d’achat des travailleurs et une augmentation du chômage, est une solution préférable.
E : Pourquoi, alors, les banques centrales répondent-elles à la menace de l’inflation en réduisant l’assouplissement quantitatif et en augmentant les taux d’intérêt ?
P : Après l’effondrement de l’étalon-or, les banques centrales ont acquis un nouveau rôle. Au lieu de se concentrer sur la stabilité des taux de change par rapport aux réserves d’or existantes, elles se sont attachées à contrôler le niveau des prix intérieurs par le biais de la masse monétaire. Armées d’une série de modèles monétaristes (tels que la proposition de Friedman de maintenir une augmentation annuelle de 5 % de la masse monétaire ou l’affirmation selon laquelle une inflation de 2 % est optimale), elles se sont lancées dans la manipulation des taux d’intérêt afin de préserver ce qu’elles définissaient comme la stabilité des prix.
À cette époque, l’indépendance des banques centrales était de plus en plus grande, mais ces choix n’avaient rien de dépolitisé. Une perspective monétariste sur des questions telles que l’inflation ou la stabilité des prix a toujours signifié que les actions des banques centrales ont répondu à la menace de l’inflation en réduisant la part des salaires. Il ne s’agit pas simplement d’un parti pris idéologique : il est structurellement déterminé par les instruments dont disposent les banques centrales : des taux d’intérêt plus élevés réduisent la part des salaires tout en augmentant la richesse des créanciers et des épargnants.
C’est ce que nous constatons aujourd’hui. Même si les banquiers centraux conviennent que les tendances actuelles de l’inflation sont la conséquence des coûts de l’énergie et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, il est clair que l’augmentation des taux d’intérêt ne résout pas (et ne peut pas résoudre) ces problèmes. Aucun taux d’intérêt ne peut débloquer les chaînes d’approvisionnement ou réduire les coûts de l’énergie. En revanche, l’augmentation des taux d’intérêt agit sur la demande en rendant les emprunts plus coûteux, en réduisant les investissements et la création d’emplois, en provoquant une récession et une hausse du chômage. Dans ces circonstances, et les banquiers centraux ont été remarquablement francs à ce sujet, les travailleurs perdent leur capacité à négocier des salaires plus élevés et subissent une baisse de leur pouvoir d’achat, ce qui réduit la demande.
Nous avons donc l’argument particulier (si l’on y réfléchit) selon lequel la réponse à la baisse du pouvoir d’achat (qui est une conséquence de l’inflation et aussi une raison pour laquelle l’inflation est mauvaise pour tous) est de … diminuer encore plus le pouvoir d’achat des travailleurs. L’idée est que la diminution de la demande finira par faire baisser les prix, ce qui signifie essentiellement que l’appauvrissement des gens est le moyen préféré des banques centrales pour assurer la stabilité des prix. Si nous ne comprenons pas que les banques centrales ont une perspective de classe, leurs actions n’ont plus de sens. Le choix de résoudre un problème d’offre en écrasant la demande est on ne peut plus politique.
La logique sous-jacente est évidente : même si la capacité de la classe ouvrière à s’organiser collectivement et efficacement a été radicalement réduite au cours des 30 dernières années ou plus, les craintes que la classe ouvrière puisse accroître sa capacité à négocier de meilleures conditions deviennent plus menaçantes dans un contexte plus large de stagnation ou de déclin de la productivité. Dans un tel environnement, même une augmentation modérée de la part des salaires est considérée comme préjudiciable aux intérêts capitalistes, ce qui conduit l’État et le capital – une fois de plus – à préférer le risque d’une récession à tout renforcement potentiel du pouvoir de la classe ouvrière.4
E : En ce moment (mars 2023), les taux d’inflation aux États-Unis et en Europe sont en baisse depuis plusieurs mois. Serions-nous en train d’assister au soi-disant « atterrissage en douceur » promis par certains banquiers centraux ?
P : Il est essentiel de noter que si l’inflation diminue effectivement, ce n’est pas le résultat du resserrement des banques centrales. Comme je l’ai déjà mentionné, aucun taux d’intérêt ne peut résoudre la hausse des coûts de l’énergie ou les pénuries de la chaîne d’approvisionnement. Si ces problèmes ont été atténués, ce n’est pas le résultat d’une hausse des taux d’intérêt (dont l’augmentation a été historiquement modeste, si l’on compare avec le choc Volcker par exemple). Mais plus important encore, les banquiers centraux eux-mêmes admettent que les effets du resserrement monétaire sur les prix en général ne peuvent pas se produire si rapidement. Selon les recherches menées par la Fed elle-même, l’effet maximal des hausses de taux sur les prix se produit après un minimum de deux ans – les effets significatifs se traduisant dans l’activité réelle au cours de la quatrième année. Comme l’a fait remarquer Josh Mason, cela signifie que les banques centrales « définissent désormais leur politique pour l’année 2024 ou 2025 ». En outre, même si les tendances inflationnistes semblent se ralentir, la Fed et la BCE semblent enclines à continuer d’écouter leurs conseillers optimistes et à poursuivre le resserrement de leur politique.
Cela signifie que même si les pressions inflationnistes se sont déjà atténuées d’ici là, la récession n’en est pas moins imminente, et elle est purement politique. Comme l’a récemment admis le directeur du FMI, la récession est en fait à venir pour – au moins – un tiers du monde en 2023. Si l’on considère les banques centrales comme des institutions objectives dirigées par des modèles scientifiques et dépolitisés à la poursuite de la noble cause de la stabilité des prix pour tous, il s’agit là d’un choix totalement irrationnel. Mais si nous comprenons les banques centrales comme des instruments du pouvoir de classe, rien de tout cela n’est le moins du monde surprenant. Si la tendance à long terme est effectivement à la baisse de la productivité et de la rentabilité, avec des entreprises engagées dans une concurrence acharnée pour accroître leur part de marché dans un environnement de marché décroissant, alors que dans le même temps apparaît un potentiel d’autonomisation de la classe ouvrière, provoquer une récession est une manière très spécifique et politique d’intervenir dans ce conflit.

La hausse de l’inflation entraîne une chute brutale des salaires réels, selon un rapport de l’OIT
« Le rapport montre que, pour la première fois au XXIe siècle, la croissance des salaires réels est devenue négative alors que, dans le même temps, l’écart entre la croissance de la productivité réelle et la croissance des salaires réels continue de se creuser. »
« Le Rapport mondial sur les salaires 2022-2023 : The Impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power , estime que les salaires mensuels mondiaux ont chuté en termes réels à moins 0,9 pour cent au cours du premier semestre 2022 – c’est la première fois au cours de ce siècle que la croissance des salaires réels mondiaux est négative.
Dans les pays avancés du G20, on estime que les salaires réels ont baissé de moins 2,2 pour cent au premier semestre 2022, tandis que les salaires réels dans les pays émergents du G20 ont augmenté de 0,8 pour cent, soit 2,6 pour cent de moins qu’en 2019, l’année précédant la pandémie de COVID-19.
« Les multiples crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés ont entraîné une baisse des salaires réels. Cela a placé des dizaines de millions de travailleurs dans une situation désastreuse alors qu’ils sont confrontés à des incertitudes croissantes », a déclaré le Directeur général de l’OIT, Gilbert F. Houngbo. « L’inégalité des revenus et la pauvreté augmenteront si le pouvoir d’achat des plus bas salaires n’est pas maintenu. En outre, la reprise post-pandémique, si nécessaire, pourrait être compromise. Cela pourrait alimenter de nouveaux troubles sociaux à travers le monde et compromettre l’objectif de prospérité et de paix pour tous ».
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_862321/lang–en/index.htm