Rote Zora
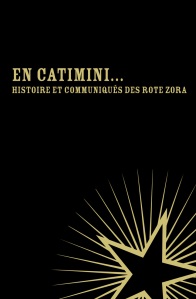
Présentation rapide de l’ouvrage « En catimini… », entièrement consultable en ligne ICI suvi d ‘une critique de Peter Vener
« En catimini… est le premier ouvrage en français consacré aux Rote Zora. Ce groupe de femmes en armes a été actif de 1977 à 1995. Peu connu en France jusqu’à présent, il a pourtant marqué l’histoire du féminisme en RFA tout autant qu’il a suscité un vif intérêt au sein de l’autonomie allemande alors en ébullition.
Leur pertinence, leur mode d’organisation et leur capacité à agir en pleine période de répression font de leur histoire une expérience qui n’a rien perdu de son actualité.
Dans une première partie de l’ouvrage, deux textes reviennent sur trois décennies de politique sécuritaire et mettent en perspectives le parcours des Rote Zora et des Cellules révolutionnaires (RZ) auxquelles elles sont liées. Dans un second temps, la parole est donnée aux Rote Zora elles-mêmes au travers d’un texte de présentation de leur groupe, d’une interview et d’une sélection de communiqués d’actions. Ainsi, un tour d’horizon des multiples thématiques abordées témoigne de l’indissociabilité des luttes dans une perspective révolutionnaire. »[print_link]
Quelques notes critiques sur « En catimini »
« L’expérience est la lanterne qui éclaire le chemin déjà parcouru. »
Proverbe chinois
Suite à mes réactions plutôt vives envers « En catimini », quelques amis m’ont demandé de coucher sur le papier mes remarques. J’ai hésité car, au fil des décennies, de bons textes, analysant les oppositions à l’Etat qui apparurent en République fédérale allemande (RFA) à partir de la fin des années 60, sont sortis en France. C’est pourquoi, initialement, j’ai commencé à en diffuser quelques-uns, tels que « L’antifascisme comme ersatz de révolution », paru en 1991 dans « Temps critiques ». Sans cracher dans la soupe à la façon des repentis, ils abordent les limites idéologiques communes à la majorité des tendances, des organisations, etc., classées sous l’étiquette d’opposition extraparlementaire (APO), limites reconduites par les groupes armés, Fraction armée rouge (RAF) en tête, et présentées par eux comme autant d’avancées. Pourtant, j’ai finalement décidé de mettre mon grain de sel, en rédigeant les notes qui suivent, dans l’espoir qu’elles aideront ceux qui veulent réfléchir par eux-mêmes et qui n’avalent pas sans broncher les brouets prédigérés. J’ai bien conscience de reprendre parfois, de façon lapidaire, l’essentiel de critiques déjà faites ailleurs et de ne pas être exhaustif. Pourtant, je ne vois pas pourquoi, alors que je ne suis pas tendre envers mon propre passé marxiste-léniniste (ML), qui date de la première moitié des années 70, j’accepterais que l’on défende aujourd’hui « en catimini » la même idéologie sous de nouveaux pavillons de complaisance, y compris en lui donnant quelque tournure néo-féministe. En laissant entendre, mine de rien, que les groupes de lutte armée en RFA étaient en quelque sorte des libertaires, comme les cercles affinitaires autonomes, dans l’Espagne des lendemains du franquisme. Bien sûr, cela ne signifie pas que tous les communiqués marqués du sigle « Rote Zora », par exemple, sont nuls et non avenus. Pour la bonne raison que des individus ne sont pas nécessairement réductibles à l’idéologie installée dans leurs têtes, et que, poussés par leur haine du monde de l’aliénation, ils l’outrepassent parfois, par leurs paroles et par leurs actes. Pour moi, il n’est pas question de jeter le bébé avec l’eau sale, comme le fit le père de l’Ecole de Francfort, Adorno, envers l’APO, alors même que des cercles radicaux reprenaient à leur compte les idées de l’un des meilleurs penseurs issus de l’Ecole, à savoir Marcuse. Au nom de la critique de la « démocratie totalitaire », Adorno devint incapable d’entrevoir l’apparition de tendances inédites en RFA, en train de rompre avec les côtés démocrates des idéologues de l’APO. Le summum fut atteint lorsqu’il appela la police du Land de Hesse pour faire cesser « l’occupation fasciste » de l’Institut de recherche sociale (IFS) par les « anarchistes », hostiles à la science universitaire. Ce n’est pas ma position. En revanche, c’est rendre de bien mauvais services aux révolutionnaires d’aujourd’hui que de valoriser en bloc, sans le moindre recul, les activités des groupes de l’époque, tels que les Cellules révolutionnaires, et donc de présenter leurs travers comme des modèles à suivre.
Peter Vener
Décembre 2009
**********
Parfois, on reproche aux textes qui traitent de la situation en RFA depuis les années 50 leur lourdeur philosophique et historique, proverbiale au pays de Hegel. Je ne peux guère faire de tels reproches à « En catimini », presque totalement muet sur le contexte historique dans lequel sont apparues les oppositions à l’Etat. Or, bien que l’histoire ne puisse être réduite à celle de la domination, il n’en reste pas moins vrai qu’elle pèse parfois bien lourd sur le cerveau des révoltés lorsqu’ils commencent, selon la célèbre formule, à faire leur propre histoire. Certes, ils partent d’eux-mêmes, mais leur être est aussi social et historique. Par suite, le poids du passé et des conditions spécifiques dans lesquelles ils évoluent, et qu’ils ont plus ou moins intégrés sans vraiment en prendre conscience, joue souvent le rôle de limite interne à leur action, aussi importante que l’intervention externe du pouvoir d’Etat lui-même. D’où la nécessité de tenir compte du contexte historique. Or, excepté quelques allusions au nazisme et l’exposé ad nauseam des lois coercitives prises par Bonn depuis les années 50 – type d’exposé factuel dont aucun texte à prétention radicale ne semble désormais pouvoir faire l’économie –, « En catimini » ne contient presque rien. Ce qui, à la fois, affaiblit l’intérêt que des activités des Rote Zora peuvent parfois présenter pour nous et facilite l’escamotage des tares des groupes armés en RFA.
L’histoire de la RFA est impensable si l’on évacue la question de la mise en place, puis de la consolidation des blocs issus de la dernière boucherie mondiale. C’est à la suite de la crise de Berlin de 1948 que fut décidée, sous l’impulsion des Etats-Unis, la création de la RFA. Elle entérinait le partage du monde ébauché à Yalta entre les futurs vainqueurs de la prétendue « guerre contre le fascisme » et, dans l’optique de Washington, elle indiquait à Moscou la limite à ne pas dépasser en Europe, sur fond de chantage à l’holocauste nucléaire. Elle sanctionnait le statut quo, la « drôle de paix » qui allait être connue sous le nom de « guerre froide ». Mais elle ne fut jamais l’Etat fantoche que faillit devenir la République de Weimar, les Etats-Unis ayant évité de reproduire les erreurs de la paix de Versailles, contre la volonté des chauvins français, le Parti communiste français (PCF) compris. L’ombre des tentatives d’insurrection en Allemagne, à la fin et au lendemain de la Première Guerre mondiale, hantait la Maison blanche. Washington ne voulut pas blesser outre mesure le nationalisme allemand et exaspérer la population. D’où l’injection massive de capitaux pour faciliter la reconstruction et la relance de l’économie. Le territoire de la RFA recoupait donc les zones d’occupation à l’Ouest, avec le secteur ouest de Berlin dans le rôle du bunker de l’OTAN installé au cœur de la République démocratique allemande (RDA), encerclé par le Pacte de Varsovie. La nature d’Etat de droit moderne de la RFA fut formalisée par l’adoption de la Constitution en 1949. Celle-ci incluait évidemment la batterie habituelle de libertés formelles accordées aux citoyens, suspendues par le pouvoir nazi. De plus, pour définir la citoyenneté allemande, elle reprenait la « loi sur l’appartenance au Reich » de 1913. Elle retenait comme critères de citoyenneté des catégories « ethno-culturelles », telles que l’adhésion aux « valeurs linguistiques et culturelles allemandes », héritage du nationalisme du XIXe siècle, lorsque l’Allemagne était encore morcelée en principautés et la population de langue allemande dispersée à travers l’Europe. Elle biffait les deux critères de « pureté » et de « fidélité » ajoutés par les nazis, qui avaient encore aggravé le côté « ethnique » de la définition originelle et justifié les opérations de « purification ethnique » du côté d’Auschwitz. En ce sens, la Constitution sanctionnait la « rupture avec le nazisme », pour reprendre les termes de « En catimini », mais aussi la « division actuelle de l’ancien Reich en deux Etats distincts », comme l’affirma la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. En d’autres termes, n’englobant pas « la totalité du peuple allemand », bien que « exprimant les espoirs de progrès de tous les Allemands », la RFA ne relevait pas stricto sensu de la catégorie d’Etat nation. Ce que la Cour confirma en soulignant que le nouvel Etat était « provisoire ». Aussi « provisoire » que la nouvelle Constitution que, en toute logique, Karlsruhe nomma « loi fondamentale ». En attendant l’hypothétique réunification de l’Allemagne. Laquelle fut réalisée lors de la chute du Mur, à l’époque où le modèle de l’Etat nation était déjà en crise en Europe.
En revanche, les juristes du nouvel Etat posèrent, au cœur de l’exposé de la loi fondamentale « provisoire », « la clause d’éternité ». L’introduction de telles catégories générales, tirées de l’univers métaphysique de Kant, au sein même de la multitude de lois particulières, qui rappelaient en partie la jurisprudence anglo-saxonne, a de quoi surprendre. En réalité, elle exprimait à merveille la situation particulière de la RFA, Etat républicain fondé sur la défaite, l’occupation et le dépeçage du Reich nazi entre les vainqueurs. Etrange pouvoir souverain, privé de la base essentielle qui aurait dû en sanctionner la légitimité : la souveraineté de la totalité du peuple allemand. La clause d’éternité impliquait que, désormais, la remise en cause de la « forme » de l’Etat, à savoir la république de type parlementaire et fédérative, serait assimilée à l’atteinte au « contenu » même de l’Etat. L’intention de nuire au nouvel Etat, préalable au passage à l’acte, était déjà susceptible d’être sanctionnée par Karlsruhe. L’article prévoyant la dissolution des partis « qui, d’après leurs objectifs, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique » n’a pas d’autre sens. Les législateurs de Bonn justifièrent le caractère préventif de la clause par la nécessité de briser dans l’œuf toute tentative de restauration du nazisme. En effet, la Constitution de Weimar n’interdisait pas de modifier la forme de l’Etat et autorisait la « suspension de l’empire des lois pour cause de sauvegarde de l’essence de l’Etat ». Sans plus de précision, même en termes de temps. De sorte que, dans le cadre constitutionnel créé au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Président, le maréchal Hindenburg par exemple, pouvait, du haut de la tribune du Reichstag, faire l’apologie du Kaiser déchu sans risquer d’être destitué. Hitler, lui, n’eut même pas besoin d’abolir la Constitution en vigueur, de faire quelque putsch à la mode bonapartiste, pour prendre le pouvoir et le garder sous la forme de la plus implacable des dictatures pendant plus de douze ans, au nom de la « sauvegarde du peuple et de l’Etat ». Ce que le juriste nazi Carl Schmitt nomma la « dictature souveraine légale ». C’est la situation particulière de l’Allemagne nazie qui amena Walter Benjamin à affirmer, à quelques mois de la « drôle de guerre » que, « pour les opprimés, l’état d’exception est désormais devenu la règle ». Il généralisait outre mesure, ce qui peut se comprendre vu les circonstances exceptionnelles de l’époque et l’approche de la guerre qui ne pouvait manquer d’aggraver de façon inouïe la situation des damnés de la Terre en Europe, à commencer par celle des apatrides. Tandis que, aujourd’hui, les prétendus radicaux qui, à la moindre mesure de coercition, reprennent hors contexte la formule à titre de slogan montrent combien ils sont prisonniers des illusions sur la démocratie.
L’esprit de « la clause d’éternité » fut applaudi comme la preuve de la volonté de la jeune RFA de rompre avec le nazisme. Les « forces antifascistes », terme aussi flou que polymorphe, recouvrant des idées, des tendances, des associations, etc. très diverses, manifestèrent leur satisfaction. Y compris les membres du parti qui, à l’Ouest, avait gardé le nom de Parti communiste allemand (KPD). Evidemment, l’Etat de droit étant constitué, il n’a pas fallu longtemps pour que, au nom de la défense de la Constitution, Adenauer demande à Karlsruhe d’entériner les mesures de coercition proposées par Bonn, allant jusqu’à l’interdiction de toute incitation à le remettre en cause. Le KPD fut le premier à être mis hors la loi avec l’ensemble de ses organisations satellites « antifascistes ». « En catimini » y voit la preuve de « l’effrayant cynisme » de l’Etat libéral, le premier exemple de la série de mesures d’exception qui devait culminer dans la traque aux terroristes, réels ou supposés tels, dans les années 70, voire l’expression du « caractère fasciste de la démocratie libérale ». Or, la dénonciation de l’absence de « dénazification effective des institutions de Bonn », pour reprendre les paroles de Jdanov, l’organisateur du Kominform, était l’angle d’attaque favori du KPD contre la Chancellerie. A l’aube de la Guerre froide, le successeur du Komintern, créé dès 1947 par Moscou, avait ressorti du chapeau l’attirail « antifasciste », qui avait bien servi à l’époque de la guerre chaude contre le Reich nazi. Il comptait le réutiliser comme cheval de Troie pour déstabiliser le « camp impérialiste », dominé par Washington, et regrouper le plus de forces possibles autour du « camp socialiste et démocratique ». Dans les années 70 et 80, écrasés par le souvenir culpabilisateur de la « solution finale du problème juif » et sensibles au sentiment d’humiliation nationale dû à la présence massive de la « superpuissance yankee » sur le territoire de la RFA, bon nombre d’associations de l’APO et, à leur suite, de groupes armés comme les Cellules révolutionnaires, reprirent le même genre de dénonciation de l’Etat libéral, particulièrement dans la foulée des votes de lois d’exception. Au nom de « l’antifascisme » et de « l’anti-impérialisme ». Ils révélaient ainsi leur double dépendance envers le léninisme, véhiculé par le KPD dès les années 20, et envers l’idéologie démocratique qui sanctifiait la victoire des Alliés sur le nazisme.
De toute façon, l’interdiction du KPD était conforme à la lettre même de la « clause d’éternité », dans la mesure où il ne reconnaissait pas, à l’époque, la validité de la Constitution, comme ne manqua pas de le signaler le gouvernement démocrate-chrétien d’Adenauer. La possibilité de prendre des mesures d’exception ne fut rétablie, elle, que bien plus tard, à la fin des années 60, par la coalition dominée par la social-démocratie, toujours en conformité avec la Constitution. Car, comme Karlsruhe l’affirma, celle-ci ne donnait que le cadre général dans lequel inscrire les lois et, de plus, le législateur ne pouvait pas tout prévoir à l’avance. Par exemple, les émeutes de masse à Berlin-Ouest en 1967 lors de la venue du Shah d’Iran. Principe qui est frappé au fronton de l’Etat moderne, sans cesse répété par ses idéologues, à commencer par celui qui est porté aux nues encore aujourd’hui, le Rousseau du « Contrat social », dans le chapitre nommé « La dictature ». L’exécutif devait donc avoir la possibilité de prendre des mesures adaptées à la situation exceptionnelle, quitte à ce que le législateur, et la vestale de la Constitution domiciliée à Karlsruhe en premier, les déclare conformes a posteriori. Il faut vraiment voir le monde à travers des lunettes démocratiques pour y déceler quelque viol de l’esprit des lois en RFA. L’histoire de la création et de la consolidation de la forme républicaine de l’Etat au pays modèle du genre, à savoir la France des lendemains du Second Empire, devrait pourtant ouvrir les yeux à ceux qui s’en étonnent. Lorsque les républicains purs eurent consolidé leur pouvoir à la Chambre des députés en 1883, ils complétèrent la Constitution de 1873 avec la « loi constitutionnelle de la République ». Toute tentative de « réviser » la forme républicaine de l’institution étatique, par des moyens constitutionnels ou autres, y était assimilée à la remise en cause de la souveraineté de l’Etat. Dans le discours desdits républicains, il ne s’agissait que de prendre des garanties contre les « conspirations bonapartistes, monarchistes et cléricales » qui, parfois, avaient pour centre l’Elysée, siège de l’exécutif. Ce qui facilita l’adoption d’autres lois coercitives. La troisième République venait à peine d’être stabilisée que les anarchistes, en tête de liste des irréductibles, en faisaient les frais et tombaient sous le coup du décret, connu aujourd’hui sous le nom de « loi sur l’association de malfaiteurs ». Dénoncée comme « loi scélérate », contraire à l’esprit de la République, elle n’était pourtant que la conséquence de la loi constitutionnelle de 1883 relative aux « conspirations ». En France, depuis lors, l’Etat refait le coup à intervalles plus ou moins réguliers : c’est ainsi que les lois de 1934 contre « les ligues factieuses » fascistes furent utilisées dès l’arrivée de Blum au pouvoir en 1936 pour interner les apatrides radicaux ainsi que les leaders d’organisations anticoloniales, comme l’Etoile nord-africaine. La même chose arriva en Mai 68 aux « gauchistes » les plus remuants au motif de « reconstitution de ligues hostiles à la République ». De telles lois restent utilisables, même en l’absence de mesures spéciales contre le « terrorisme », en cas de besoin.
Dans la France de la Belle Epoque, des groupes anarchistes furent réprimés comme ennemis de l’Etat pour leur activité subversive et, parfois, pour des raisons analogues, les cercles radicaux issus de l’APO bien plus tard, en RFA. Il n’en va pas de même pour le KPD des lendemains de la guerre. Tous les rescapés du nazisme, en particulier ceux revenus d’exil, n’avaient pas nécessairement leur carte du Parti en poche. Par contre, « En catimini » classe dans la catégorie « antifascisme », sans plus, la secte reconstituée en RFA, sous la direction de Moscou, à partir des lambeaux du KPD des années 30, qui fut le principal fourrier de la contre-révolution stalinienne au cœur de l’Europe et qui facilita la venue du nazisme en réprimant les tendances révolutionnaires en Allemagne. Même écrasé par la botte d’Hitler, il eut encore assez de force à la veille de la Seconde Guerre mondiale pour procurer en grande partie l’armature des Brigades internationales, « Légion étrangère de Staline », d’après Camillo Berneri, et pour participer à la répression de la révolution libertaire ibérique. Bonn, sous la houlette de Washington, déclara l’héritier du KPD hors la loi parce qu’il était l’un des pions de Moscou sur l’échiquier de la Guerre froide et ne reconnaissait pas la légitimité de la RFA. Alors même qu’il commençait à investir l’appareil d’Etat, était représenté dans les Länder et tentait de siéger à la Chambre fédérale sous l’étiquette « antifasciste ». Il risquait de remettre en cause le fragile statu quo en Europe. « En catimini » reste étrangement silencieux sur l’enjeu réel de l’interdiction du KPD. Ainsi d’ailleurs que sur le rôle du PCF, au cours de la Libération, en prétendant que « de Gaulle » aurait « triomphé des Allemands… et de la Résistance révolutionnaire » ! Laquelle ? Celle du PCF et de ses escadrons de FTP nationalistes, assassins des internationalistes, y compris des libertaires espagnols, au maquis ?
**********
Aujourd’hui, il est difficile de saisir à quel point le souvenir du Reich nazi hantait les jeunes têtes révoltées à la fin des années 60. La seule idée d’appartenir à la « nation maudite, mise au ban de l’humanité », comme l’affirma ignominieusement Staline, et la honte d’être les fils de pères qui avaient accepté les multiples horreurs hitlériennes, à commencer par la « solution finale du problème juif », étaient la source de leur profonde culpabilisation, à l’époque où le rôle de la morale luthérienne était encore important en Allemagne. Morale qui, en termes de responsabilité, implique que le poids de la faute de tel ou tel membre de la communauté retombe, s’il ne s’en délivre pas, sur la totalité de celle-ci. Ils éprouvaient donc sans cesse le besoin de s’en dédouaner. Par suite, la moindre mesure prise par le pouvoir d’Etat installé à Bonn, même la signature de conventions collectives sous l’égide du ministère du Travail, était analysée à la loupe pour y détecter quelque intention cachée relevant du fascisme : la bête immonde, blessée, mais non vaincue, attendait la première occasion pour relever la tête et reprendre les rênes du pouvoir sous l’apparence pateline de la démocratie, voire de la social-démocratie. Ce qui explique, en partie du moins, que les idéologues de l’APO aient interprété l’histoire de l’Allemagne d’après-guerre à travers le prisme déformant de l’antifascisme. A l’exception des cercles plus radicaux qui, cherchant à voir plus loin, reprirent et développèrent les critiques les plus intéressantes de l’Ecole de Francfort et même de l’Internationale situationniste sur la domination moderne. La victoire posthume du nazisme n’était pas tant à rechercher du côté de la présence de fonctionnaires du Reich dans l’entourage d’Adenauer, dans la survivance de groupuscules nazis, etc., que dans la capacité qu’il avait, sous forme spectrale, d’occuper les esprits au point de leur boucher l’horizon. Le souvenir de la terreur nazie était bien imprimé dans les mémoires, même caché derrière le voile de l’amnésie et du conformisme chrétien. Par suite, dans l’APO, de futurs leaders des partis d’opposition, comme celui des Grünen, allèrent parfois jusqu’à qualifier l’apparition de la « société de consommation » en RFA, à savoir l’extension de la consommation de masse liée à celle de la production des Trente Glorieuses, de « terreur de la consommation ». Empêtrés dans des interprétations néo-reichiennes du monde – « La psychologie de masse du fascisme » était alors mise à toutes les sauces –, ils étaient incapables de comprendre la nature de l’économie et le rôle de l’Etat moderne, réduit à l’appareil de coercition du même nom. Dans cette optique, la multiplication de lois coercitives dans les grandes démocraties européennes était vue comme la preuve de la « fascisation » du pouvoir. La principale sentence marxiste-léniniste de l’époque, selon laquelle, en régime capitaliste, démocratie et dictature sont équivalentes – laquelle n’incluait pas l’exotique dictature du Suprême Pilote –, n’avait pas d’autre sens. Le problème, avec la critique, c’est que lorsqu’elle ne progresse pas, elle recule. Dans les milieux de l’APO, vu la prégnance de l’idéologie colportée par le KPD, elle remonta même le temps jusqu’à la fin des années 20, lorsque le Komintern formula la doctrine stalinienne du « social-fascisme ». Doctrine démagogique qui, à la fois, faisait mine de tenir compte des inquiétudes face à la montée du fascisme et de prendre de la distance envers l’exaspération que suscitait la social-démocratie, qualifiée pour l’occasion d’aile gauche du fascisme. Réinterpréter ainsi l’évolution de l’Europe avait pour Moscou l’immense avantage de justifier sa tactique manipulatoire envers les organisations de masse et de poursuivre sa politique d’alliance avec les milieux conservateurs de la République de Weimar, les Etats tampons dictatoriaux d’Europe centrale, et même l’Etat mussolinien, contre les grandes puissances républicaines d’Europe. Avant de tourner sa veste lors de la déroute du KPD en 1933 – qui avait misé sur la carte parlementaire et la complaisance, pour ne pas dire la complicité avec les nazis –, pour prôner de nouveau l’alliance des « forces de la démocratie contre le fascisme », vu les prétentions territoriales de Hitler à l’Est.
En RFA, la social-démocratie (SPD) était souvent traitée de « social-fasciste ». Même par ceux qui, comme Dutschke, avaient rompu avec le marxisme-léninisme, au nom du « socialisme démocratique », après l’intervention du Pacte de Varsovie en Hongrie en 1956, puis en Tchécoslovaquie en 1968. Si l’antifascisme épidermique de l’époque, basé sur des réactions culpabilisatrices, était encore compréhensible, l’apologie des côtés démocrates de l’APO par « En catimini », presque cinq décennies plus tard, relève du citoyennisme, à peine voilé par quelques phrases radicales. « Il convient de souligner, comme l’opposition extraparlementaire l’avait alors fait, que le fascisme d’un Etat ne se caractérise pas par la puissance de sa répression ou par l’instauration de la terreur. Le fascisme d’Etat a pour objectif la destruction des organisations émancipatrices et peut l’atteindre par d’autres moyens que ceux ouvertement violents. Ainsi, dans la conception de la « société structurée » qui caractérise alors la RFA, toute organisation de lutte au sein du mouvement ouvrier a été intégrée, annihilant ainsi toute possibilité d’antagonisme réel au sein du système. Dans ce modèle de société où les intérêts de toutes les classes seraient conjoints, le pluralisme politique n’est que la façade d’un parti unique, celui de l’ordre libéral démocratique. » Plus loin, « En catimini » n’hésite pas à affirmer, à propos de l’arrivée au pouvoir du SPD en 1968 : « Certains, dans l’opposition extraparlementaire, ont alors pu douter : peut-être le capitalisme n’engendrait-il pas forcément le fascisme. Leurs doutes seront vite infirmés : l’ère nouvelle du SPD est celle de la vengeance de l’Etat contre la gauche révolutionnaire. L’ordre libéral démocratique est un ordre, et, à ce titre, il ne souffre pas les marges. » Ici, l’image déformée du pouvoir est assimilée à la réalité. Dans la représentation, l’ombre du totalitarisme envahissait le ciel plombé de la société ouest-allemande jusqu’à interdire la moindre bouffée d’air pur, paralysant la moindre manifestation d’antagonisme et condamnant la moindre déviance. La notion de « démocratie totalitaire », étendue ici jusqu’à l’absurde, n’était plus que l’autre nom de la prétendue essence fasciste de l’Etat que les groupes armés auraient révélée au monde. Ce qui revient à dire qu’ils partageaient avec les maîtres à penser démocrates de l’APO le même programme initial, pour l’essentiel l’idéologie antifasciste héritée du Komintern, recyclée au goût du jour, pimentée à l’occasion par quelques emprunts à la psychanalyse et au féminisme, et que leur seule spécificité consistait à la réaliser par la violence armée.
Reste à comprendre ce qui, dans l’histoire de l’Allemagne, a facilité l’assimilation de n’importe quelle mesure d’Etat à de la terreur en puissance, même lorsqu’elle relevait à l’évidence de l’Etat social, pour employer le terme en vigueur depuis le Reich bismarckien. Dès sa création, la RFA appartenait manifestement à la famille des Etats républicains modernes. Non seulement parce qu’elle intégrait dans la Constitution le panel des droits politiques et syndicaux habituels, mais aussi parce que, à travers la clause sur « l’Etat social », elle garantissait aux citoyens leurs droits sociaux, à commencer par le sempiternel droit au travail et ce qui en découle en matière de santé, de chômage, de retraite…, gérés par l’intermédiaire de comités quadripartis : pouvoir central, pouvoirs régionaux, managers et syndicalistes, y compris d’opposition. Rien à voir donc avec le mode de médiation propre au nazisme, basé sur le système du parti unique, la mise hors la loi et la persécution implacable de toutes les organisations qui ne lui étaient pas rattachées. Sinon que, en dernière analyse, c’est le pouvoir d’Etat qui tranche en cas de paralysie du système de représentation démocratique, y compris par l’instauration de l’état d’exception et la coercition sans phrase. De même, derrière l’affirmation officielle du libéralisme, il n’y avait donc pas grand-chose de libéral en RFA, au sens où les manchestériens l’entendaient à l’époque de la révolution industrielle en Angleterre. Les juristes de Bonn qui planchaient sur la « clause sociale » repoussèrent là aussi toute référence à la république de Weimar, indiquant que l’absence de dirigisme dans l’économie et de protection des salariés avait été l’une des causes de la victoire du nazisme. Par suite, les amis conservateurs de Carl Schmitt furent mis sur la touche, car ils assimilaient l’intervention de l’Etat dans le social à l’abandon du côté décisionnel de la politique. En hommes du passé, ils étaient incapables de comprendre que l’Etat moderne n’est pas que raison d’Etat, au sens traditionnel du terme, mais aussi administration des « hommes traités comme des choses », sur la base de la production et de la consommation marchande en phase d’accélération. Ce que l’Ecole de Francfort en général, et Marcuse en particulier, avaient bien saisi. Manifestement, « En catimini », chevauchant la Rossinante de l’antilibéralisme, continue à galoper vers les moulins à vent imaginaires des manchestériens d’antan. Or, la seule particularité et concession formelle au libéralisme en RFA, c’était que l’immense majorité des sociétés restait formellement du domaine privé, bien que la puissance publique y intervienne à divers niveaux, à commencer par le contrôle des prix et des opérateurs du capital fictif, via la Banque centrale. Le système était donc, par certains côtés, moins dirigiste que le néo-jacobinisme à la française mais, par d’autres, bien plus protecteur envers les salariés que les ordonnances gaullistes de 1945, incluses dans le programme du conseil national de la Résistance.
Formellement, le système d’assurances sociales de Bonn était la reprise du projet, préconisé à Berlin par le Front du travail nazi en 1943, jamais appliqué. Du côté de l’APO, on en tira parfois argument pour dénoncer le caractère fasciste de la démocratie libérale et même, à l’occasion, pour présenter l’Etat social comme institution de chantage, voire de terreur totalitaire. Mais il est dans la nature de l’Etat d’assurer la protection des citoyens, en leur demandant d’aliéner leur liberté individuelle au nom de leur sécurité collective. L’Etat social ne faisait rien d’autre, sinon qu’il complétait la notion traditionnelle de sécurité territoriale, sous l’ombrelle de l’OTAN, avec celle de sécurité sociale, censée protéger les citoyens contre les aléas de la vie, à titre de salariés. En la matière, l’histoire de l’Allemagne montre surtout que le contenu providentiel de l’Etat n’est pas nécessairement lié à telle ou telle forme de pouvoir. Le mythe de l’identité entre Etat providence et démocratie, d’origine hexagonale, est, dans l’Europe des années 2000, fortement ancré dans la tête de nos démocrates, y compris les plus « radicaux ». C’est pourquoi même ces derniers assimilent la réduction du rôle providentiel de l’Etat, du moins sous les formes spécifiques héritées des Trente Glorieuses, à quelque retour du « totalitarisme ». Pourtant, le pouvoir qui créa, pour la première fois en Europe, les prémices de l’Etat social n’était en rien démocrate. C’est en effet en Allemagne, au lendemain de la constitution de l’Empire centralisé autour de la Prusse, que le gouvernement de junkers de Bismarck instaura, contre les desideratas de la bourgeoisie libérale, le système d’assurances sociales garanties par l’Etat, sur les conseils des « socialistes de la Chaire ». Le socialisme de la Chaire, né dans le monde universitaire – d’où son nom – réclamait des réformes sociales impulsées par Berlin et l’intervention limitée de l’Etat dans l’économie. Il critiquait le socialisme d’Etat de la social-démocratie, mais aussi l’idéologie libérale de l’école de Manchester qui, en refusant, du moins en principe, toute action de l’Etat autre que politique, faisait le jeu des sociaux-démocrates, voire des anarchistes. C’est pourquoi la critique des socialistes de la Chaire était aussi dirigée contre l’individualisme libéral qui risquait de rendre instable la communauté nationale en formation. C’était l’époque où le chancelier du Reich, après la guerre de 1870, combinait la plus implacable chasse aux révolutionnaires et les concessions faites aux « classes laborieuses », en particulier sous la forme de l’ombrelle sanitaire contrôlée par Berlin. Car, comme il l’affirma avec cynisme, « il est impossible de constituer le Reich allemand contre elles ». En d’autres termes, pour reprendre des concepts à la mode tirés du vocabulaire de l’incroyable Wacquant, l’Etat social n’est nullement antagonique avec l’Etat pénal, le Reich bismarckien même, dans lequel l’exception était presque la règle et le Parlement réduit à l’état de chambre d’enregistrement des décisions prises par le gouvernement. En France, la troisième république était, à la même époque, montrée en exemple à l’Europe comme le modèle du parlementarisme et de la subordination de l’exécutif au législatif. C’était aussi l’Etat européen où il n’existait même pas l’équivalent de la loi anglaise sur la pauvreté et l’étatisation était limitée à celle de la banque de France, de la Poste… Les citoyens appartenant aux « classes laborieuses » pouvaient donc y crever démocratiquement de faim, de froid et de tuberculose.
De façon générale, ni les idéologues de l’APO, ni leurs successeurs armés n’ont jamais compris que, en matière de mesures d’Etat, « il importe plus au peuple leur contenu que leur forme et leurs procédures », pour citer le « Gouvernement civil » de Locke. Hurler au danger fasciste, comme régime susceptible de remettre en cause la démocratie, n’a jamais empêché dans le passé la venue de celui-ci, lorsque les citoyens eux-mêmes, dans leur masse, ne tiraient pas avantage de la forme républicaine ou, pire, qu’elle coïncidait avec l’aggravation de leur situation. L’histoire de la République de Weimar est, sous cet angle, édifiante. Weimar était haï, y compris par la masse des prolétaires allemands, dont les tentatives d’insurrection des années 20 avaient été écrasées dans le sang, alors même que la social-démocratie était au pouvoir. Laquelle SD avait même été incapable de réaliser les réformes sociales inscrites au programme du parti et des appareils syndicaux, laissant la bourgeoisie affairiste, en particulier financière, tondre les « classes laborieuses », à l’ombre du blocus instauré par la paix de Versailles et sur fond de faillite prolongée de l’économie. Weimar, c’était la liberté formelle accordée aux citoyens confrontée à la chute catastrophique et bien réelle de leurs conditions de vie, parfois à la famine pure et simple. Weimar, dans la représentation, c’était donc la vente de l’Allemagne déchue à la finance « cosmopolite », bientôt désignée comme la « juiverie cosmopolite ». Rosa Luxembourg, au fond de la prison où elle était enfermée, en 1916, pour activités antimilitaristes, rappelait déjà que « l’antisémitisme, c’est le socialisme des chauvins ». Définition qui colla parfaitement, par la suite, avec l’idéologie du parti national-socialiste. La majorité des prolétaires allemands finit par accepter le régime nazi, non seulement par crainte des mesures de terreur qui, dès 1933, avait décapité les partis et les organisations qui étaient censés les représenter, mais aussi parce le national-socialisme fut capable, dans les limites de la définition raciale de la communauté nationale et de façon dictatoriale, de réaliser le socialisme national de la SD, le côté démocrate en moins, mais la sécurité du travail en plus, à condition de se taire. L’absence de libertés formelles, la terreur même, n’étaient pas incompatibles avec le programme du Front du travail nazi qui, dès 1934, instaura, sur la base du redémarrage de l’économie en vue de la guerre, le système d’assurances sociales considéré à l’époque comme le meilleur du monde. Keynes le libéral – dont les œuvres étaient le livre de chevet du docteur Schacht, ministre de l’Economie du Reich –, affirmait que, s’il « n’était pas partisan de monsieur Hitler, il devait reconnaître la justesse de l’intervention étatique dans l’économie ».
Spéculer sur la peur de la croix gammée avait encore moins de sens en RFA qu’à l’époque de Weimar. Bonn pouvait d’autant plus facilement faire avaler à la masse de la population les dispositifs de coercition envers « les milieux dangereux », y compris les « individus dangereux », qu’elle les faisait apparaître comme des perturbateurs du cours paisible de la société étatisée, à savoir l’Etat social. De plus, malgré le caractère figé de la structure de classe et la prégnance de la morale chrétienne dans la RFA de l’après-guerre, il est absurde de prétendre que l’Etat ne tolérait « aucune marge », à l’image du nazisme. La cogestion à l’allemande reposait au contraire sur la capacité à laisser des marges de manœuvre assez importantes aux appareils syndicaux, en particulier à IG Metall, à faire des concessions salariales pour neutraliser les débordements incontrôlés. Les marges furent élargies à partir du moment où la social-démocratie succéda à la démocratie chrétienne. Car, dès la fin des années 60, l’accumulation marqua le pas et, face à l’apparition des grèves sauvages non prévues au programme de la cogestion, le pouvoir d’Etat central débloqua davantage de crédit et fit pression sur les industriels afin qu’ils lâchent du lest, d’où la signature de nouvelles conventions collectives plus favorables aux salariés syndiqués dans les secteurs clés de l’économie. Les Länder, eux, accordèrent plus de subventions au monde scolaire et universitaire. De même que l’économie, le social connut des modifications, traduisant le recul de la morale chrétienne, la relative dislocation de la famille patriarcale, la prise en compte et la récupération des aspirations dans des domaines aussi divers que la culture et l’écologie…, associées à la création de nouveaux partis issus de l’APO, tels que les Grünen. En réalité, le pouvoir d’Etat a facilité, comme ailleurs en Europe, la marchandisation de l’ensemble du social, de façon contradictoire comme toujours, l’introduction de l’éducation sexuelle dans les écoles, par exemple, plus facile que dans la France « fille de l’Eglise », cohabitant avec la décision de tel ou tel Land de réprimer l’avortement. C’est bien parce qu’il y avait de pareilles « marges » que les lois d’exception sont apparues comme des mesures dirigées contre des « exceptions » à la règle du jeu commune, qualifiés pour l’occasion de milieux et d’individus subversifs, voire terroristes.
**********
Rien ne montre mieux l’incapacité des groupes armés à rompre avec l’héritage du Komintern que leur reprise de la doctrine léniniste de l’impérialisme, retouchée en fonction des nécessités de l’heure. Dès 1975, les Cellules révolutionnaires « exposent les thématiques de leurs actions », parmi lesquelles « l’anti-impérialisme », « l’antisionisme » et le « soutien aux luttes des femmes », rappellent les auteurs de « En catimini ». En la matière, les Rote Zora ne firent qu’emballer la vieille camelote dans du féministe modernisé, issu de l’échec, puis de l’institutionnalisation des révoltes féminines en RFA, l’influence des cercles féministes universitaires les empêchant d’élargir le champ de leur critique. Plus loin, « En catimini » avance que de telles « thématiques » étaient justifiées à l’époque du partage de l’Allemagne entre l’Est et l’Ouest, mais qu’elles furent en grande partie abandonnées par la suite, la réunification les privant de leur sel. Beau sens de l’opportunité ! Les nécrophages du léninisme, lénino-féminisme compris, avaient donc raison, même lorsqu’ils avaient tort. Les questions de principe passent ainsi à la trappe.
Pour Lénine, « l’impérialisme, stade suprême du capitalisme » reposait sur le partage du monde entre les Etats constituant les pôles de l’accumulation du capital. Dans cette optique, le Komintern devait faciliter la constitution d’Etats nationaux dans les zones « périphériques » du système de domination capitaliste, afin d’en accélérer la chute au « centre ». Dans les métropoles, les partis communistes devaient combattre en priorité leur propre « Etat impérialiste ». Ce qui n’alla pas sans contradictions au fur et à mesure que le cours de la révolution mondiale était subordonné à la défense du « bastion du socialisme », ce qui commença avec Lénine lui-même lors de la signature de la paix séparée avec l’Allemagne, en 1918. Les corps francs créés à partir des restes de l’armée impériale, sous contrôle social-démocrate, puis la Reichswehr de Weimar, réarmée en partie par l’URSS, eurent toute latitude pour écraser les tentatives insurrectionnelles en Allemagne, en particulier dans la Ruhr. Dès les années 30, le Parti communiste chinois (PCC) et les conseillers russes, sur ordre du Kremlin, effectuèrent la première répétition générale de la stratégie léniniste en Orient. Le Komintern participa à l’organisation du parti national, le Kuomintang, et de l’armée nationale placée sous sa direction. Staline y voyait le principal allié de Moscou en Asie et la force motrice de la « révolution nationale et républicaine » en Chine. A la suite de quoi, le Kuomintang écrasa la révolution chinoise, en commençant par Shanghai. Ce fut le prélude de la tragédie rejouée à maintes reprises au cours du siècle dernier, aux quatre coins de la planète, avec la même chute de rideau désastreuse : l’immolation des tentatives de subversion sur l’autel de l’Etat national, au premier chef celui de la « patrie du socialisme ». Le jacobinisme relooké aux couleurs du marxisme-léninisme apparaissait pour ce qu’il était essentiellement : l’une des formes de la contre-révolution, partie intégrante du système capitaliste mondial issu de la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale.
Au cours des années 60, la décolonisation dans le « tiers-monde » confirma que le modèle de l’Etat nation créé par la Révolution française, même rafraîchi par le ripolinage bariolé de La Havane, était dépassé depuis longtemps. La notion de « tiers-monde » n’était d’ailleurs que le duplicata formel de celle de « tiers-état », datant de l’époque à jamais révolue de la prise du pouvoir par la bourgeoisie contre l’aristocratie et l’Etat absolutiste. Caméléonesque à souhait, comme le modèle originel, elle permettait de mettre dans la même besace « anti-impérialiste » les tendances, les partis et les Etats les plus divers, unis de façon conjoncturelle contre l’ennemi commun, en général les Etats-Unis. La domination moderne était ainsi assimilée à celle de la vieille oligarchie financière, censée entraver l’accession du reste de la planète au monde du capital émancipé d’antiques hiérarchies. Dans les métropoles, les supporters de la libération du « tiers-monde », rattachés aux diverses églises présentes sur les rayons du supermarché marxiste-léniniste mondial, étaient surtout fascinés par le mode d’organisation, en apparence non centralisé et non hiérarchique, des armées de libération nationale qui, à travers le monde, levaient le drapeau de la « lutte armée contre l’impérialisme ». Sartre lui-même affirma que de telles formations de guérilleros lui rappelaient Valmy, l’épopée des levées en masse de la Convention en quelque sorte. Et pourquoi pas les unités de partisans de l’Armée rouge derrière les lignes de la Wehrmacht, au cours de la « grande guerre patriotique » dirigée par le moustachu du Kremlin ? Ou les « détachements féminins rouges », intégrés dans l’Armée rouge de Mao à l’époque de la constitution des premières zones de guérillas, en Chine centrale, comme le rappela Beauvoir ? L’analogie était facile et le tandem existentialo-mao-tiers-mondiste proposa d’encercler ainsi « la bête », tapie au cœur des métropoles assoupies, voire définitivement pacifiées sous la houlette de l’Etat providence. Et de conseiller d’appliquer les préceptes maoïstes sur la « guerre populaire », laquelle avait pourtant porté au pouvoir le parti néostalinien du Grand Timonier, féministe bien connu, avec toutes les horreurs qui en ont résulté pour les ilotes des deux sexes de l’ex-empire du Milieu. Bref, la forme prise par les guerres nationales dans le « tiers-monde » ne changeait rien à leur contenu et à leur objectif : la création d’Etats, qui n’aspiraient qu’à être reconnus dans le cadre du système mondial et des institutions qui le légitimaient, telles que l’ONU. En ce sens, les leaders nationalistes du « tiers-monde », y compris à Cuba, ne déclaraient même pas la guerre au despotisme universel, à la façon des Enragés. Malgré les discours fleuves de Fidel Castro et les appels de Che Guevara à constituer de « nombreux Vietnam », l’heure n’était plus aux discours insurrectionnels à la Jacques Roux, mais aux marchandages dans les salons feutrés de l’immeuble des Nations unies à New York. Les territoires sur lesquels les nouveaux Etats exerçaient leur souveraineté, parfois acquise au prix du sang des peuples qui y habitaient, étaient le fruit de querelles locales et de tractations avec les puissances qui dominaient le conseil de Sécurité de l’ONU, parmi lesquelles les chefs des guérillas choisissaient leurs protecteurs, avant même de troquer la kalachnikov contre le maroquin présidentiel. Ainsi, les leaders algériens du Front de libération nationale (FLN) n’hésitèrent pas à faire appel aux Etats-Unis et à l’URSS contre la Belle France coloniale dès la fin des années 50. Dans nulle partie du monde, les organisations nationalistes, pas plus que les Etats nationaux qu’elles contribuaient à créer, ne pouvaient être « non alignés », sinon parfois à titre de zone tampon provisoire comme la Yougoslavie de Tito.
En dernière analyse, les damnés de la Terre, dans lesquels Frantz Fanon avait placé d’étranges espoirs de libération « nationale et sociale », à la sauce marxiste-léniniste, servaient de troupiers aux organisations et aux armées locales, noyaux des futurs appareils d’Etat locaux. Les irréductibles qui outrepassaient le rôle assigné étaient éliminés, comme le montra l’attitude du FLN envers les incontrôlés de la casbah d’Alger lors de la bataille du même nom. Des rebelles comme Ali la Pointe, qui commençait à refuser d’obéir aux ordres de Saâdi, cacique de la zone autonome du FLN dans l’Algérois, furent donnés aux parachutistes de Massu. En 1970, le Moyen-Orient, terrain de jeu favori des groupes armés en RFA, confirma encore le rôle contre-révolutionnaire des organisations nationalistes. A la veille de « Septembre noir », l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), fraîchement constituée, voulait être reconnue par l’ONU comme « la représentante légitime du peuple palestinien ». Elle commença donc par rechercher des appuis à travers le monde, en particulier du côté de Pékin. Mais les camps de réfugiés en Jordanie, alors principale zone de concentration des Palestiniens déracinés, échappaient en partie au contrôle de l’appareil d’Etat local en formation. L’OLP n’avait pas encore réussi à les militariser totalement et à soumettre les fortes têtes qui y résidaient. Elles n’obéissaient pas à ses diktats, en particulier en refusant l’intégration dans les troupes de fedayins et l’envoi dans les Etats arabes, à titre de main-d’œuvre corvéable à merci finançant la « cause ». C’est pourquoi, au prétexte de lutter contre « l’ennemi principal », Israël, l’OLP les abandonna aux prétoriens du roi Hussein. C’est sur leurs cadavres que le pouvoir de l’autorité palestinienne fut légitimité par la Ligue arabe. Les actes de terrorisme réalisés par les commandos de fedayins, loin de préparer quelque insurrection, comme l’imaginaient les souteneurs européens de l’OLP, avaient pour fonction exclusive de lui donner le coup de pouce nécessaire pour être reconnue par l’ONU. En ce sens, ils étaient irrémédiablement antagoniques avec la moindre tentative de subversion, individuelle et collective, dans la région. Rappelons-nous comment l’autorité palestinienne a traité les jeunes rebelles des ghettos lors de la première Intifada, faisant réprimer par les fedayins militarisés ceux qu’elle ne pouvait pas subordonner à ses fins.
Les groupes armés, du genre RAF, furent incapables de tirer la moindre leçon de la désastreuse expérience historique. Aussi, vers la fin de la guerre du Vietnam, en quête de cause de substitution, ils associèrent de plus en plus à la lutte contre « l’impérialisme » celle contre « le sionisme » et l’appui à « la lutte de libération du peuple palestinien ». La RFA, membre privilégié du bloc de l’Ouest, était l’une des composantes de l’alliance entre les Etats-Unis et Israël. Bonn, sous prétexte de liquider la dette contractée par le régime nazi envers les Juifs, finançait Tel-Aviv, qui utilisait ces réparations pour acheter des armes aux Etats-Unis, lesquelles servaient à massacrer les Palestiniens. De plus, lesdits groupes étaient impressionnés par l’audace et la capacité des fedayins à effectuer des actions de commando, ainsi que par l’esprit de sacrifice qu’elles impliquaient. Rien de tel que la martyrologie pour faire culpabiliser et pour anéantir les doutes de supporters à la recherche de causes auxquelles vendre leur âme et donner leur corps. Aussi apportèrent-ils de plus belle leur concours aux organisations nationalistes dans le « tiers-monde », en commençant par le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), groupe nationaliste membre de l’OLP, au vernis marxiste-léniniste, ce qui le rendait particulièrement attractif à leurs yeux. Dans leur âme modeste, quelques recrues déguisées en fedayins pensèrent même imposer leurs propres règles sur l’échiquier mondial ou, au moins, déplacer telle ou telle pièce maîtresse à leur gré, à condition de jouer fin, en Syrie par exemple. Mais, jobardise oblige, ils n’y tinrent que le rôle que les maîtres du jeu leur attribuèrent : celui de pions. Contrairement à ce qu’affirme « En catimini », accepter d’endosser la tenue de mercenaires de la « révolution palestinienne », sous la direction du free-lance de la barbouzerie planétaire, Carlos, formé par le KGB, ne relevait pas seulement de choix individuels, voire de dérives individuelles. Cela découlait aussi des prises de positions collectives anti-impérialistes et anti-sionistes de groupes armés comme la RAF qui avaient, pour modèle de leur composition, la figure sinistre du révolutionnaire professionnel du Komintern. C’est ce qui a amené tels ou tels de leurs membres dans des impasses malodorantes. Très malodorantes même, puisque le caniveau antisémite fut parfois le stade terminal de la poubelle tiers-mondiste.
A force d’affirmer que « démocratie » et « dictature » sont les deux faces de la même médaille, ils finirent par négliger, parfois par gommer, les spécificités du nazisme, en particulier en matière de « solution finale du problème juif ». Additionnée au goût de la provocation envers Bonn et au refus du chantage à l’Holocauste, leur idéologie réductionniste a généré des actes inqualifiables. En 1969 déjà, de prétendus anarchistes berlinois avaient tenté de faire sauter la dernière synagogue de Berlin, à la date de l’anniversaire de la Nuit de cristal de 1938, qui connut la pire vague de pogroms depuis 1933. En fait d’anarchisme, leurs communiqués, mélange de pathos maoïste et de jargon beatnik, n’étaient pas sans rappeler la prose des Weathermen d’outre-Atlantique. La thèse facile de la provocation policière fut vite abandonnée : c’était bien des « camarades » qui avaient été tentés par quelque remake des opérations noires chères aux nazis. Cette tentative avortée fut le prélude à la multiplication de projets, réalisés ou non, sur lesquels planait l’ombre de Carlos, qui devait culminer à Entebbe, en 1976. D’après « En catimini », « deux présumés » membres des Cellules révolutionnaires « ont été abattus par les forces spéciales israéliennes lors de l’attaque d’Entebbe. Ce détournement a été particulièrement critiqué, et ce jusqu’au sein même du mouvement radical ouest-allemand, notamment parce qu’il mettait en danger des civils » et représentait quelque « corps à corps direct avec l’Etat ». Thèse qui présente avec beaucoup de « pudeur » la teneur des polémiques de l’époque, relatives aux dérives possibles vers l’antisémitisme dans les milieux « révolutionnaires » européens, au nom de la lutte contre Israël, dont Entebbe confirma le bien-fondé. Les premières prises d’otages en avion furent organisées par l’OLP. Des révolutionnaires, à commencer par des anarchistes, condamnèrent de tels actes comme du « terrorisme d’Etat », par exemple dans la revue « La Lanterne noire ». Car, dans la mesure où les organisations palestiniennes avaient pour objectif de prendre le pouvoir dans la région, il était inévitable qu’elles utilisent la terreur comme moyen d’action, en particulier envers la population juive d’Israël. Pour la raison d’Etat, la fin justifie les moyens. « Nous pensons que tuer un Juif loin du champ de bataille est plus efficace que de tuer cent Juifs sur le champ de bataille, parce que cela attire plus l’attention », affirma en 1970, dans son interview à la « Storia », Georges Habbache, leader du FPLP. Les commandos appartenant à diverses branches de l’OLP, le FPLP au premier chef, entreprirent donc de trier les Juifs, parmi les passagers des avions détournés, pour les retenir en otages. A Entebbe, le pas supplémentaire consista à demander aux « présumés RZ » de participer au tri. Ce qu’ils firent…
Evidemment, les sionistes ont toujours agité le spectre de la Shoah aux couleurs du nationalisme arabe pour couvrir la colonisation de la région par Israël. Du côté de Tel-Aviv, la raison d’Etat règne aussi et justifie les opérations de terreur, sous prétexte d’assurer la sécurité des Israéliens et même des Juifs dispersés à travers le monde. D’où l’étiquette infamante d’antisémitisme accolée par Israël aux révoltes qui secouent les lieux de parcage des Palestiniens. Cela dit, il existe, depuis la Seconde Guerre mondiale, des relations effectives entre le fascisme et le nationalisme arabe. A commencer par celles ayant existé entre Himmler et Husseini, le grand mufti de Jérusalem qui, face à l’arrivée accélérée de Juifs dès la fin des années 30, était favorable à quelque « solution finale » en Europe, histoire de tarir les sources de l’immigration juive en Palestine. « Solution » à laquelle participèrent les sections musulmanes de la Waffen SS qu’il finança dans les Balkans. Par la suite, les groupes fascistes européens restèrent en relation avec des milieux du panarabisme laïque au Moyen-Orient, avec des Etats membres de la Ligue arabe, avec des organisations nationalistes arabes, confessionnelles ou non, y compris l’OLP, au nom de la lutte contre l’ennemi commun. En 1970, il n’était pas rare de croiser dans les camps jordaniens de drôles d’invités du FPLP, des nazis membres de divers groupes européens, Ordre nouveau par exemple. En acceptant d’être envoyés au Moyen-Orient par des réseaux pour le moins troubles, aux côtés « d’antisionistes » de toutes les couleurs, la brune y compris, puis de se placer sous la direction du Commandement des opérations spéciales à l’étranger (COSE) du FPLP, les adeptes de la guérilla façon RAF firent des besognes peu reluisantes, y compris celle qui consistait à trier des otages sur quelque tarmac en Afrique. Inutile de cacher, derrière des phrases évasives comme le fait « En catimini », ce qui éclata au grand jour, il y a presque quarante ans : les « amis de la cause palestinienne », en RFA et ailleurs, n’étaient pas toujours des antisémites ; par contre, certains, derrière des étiquettes révolutionnaires, l’étaient déjà.
De plus, leur dénonciation presque exclusive de l’Ouest n’était pas sans ambiguïté envers l’Est et fut à l’origine de bon nombre de rumeurs sur les relations, réelles ou supposées, entre des cercles armés berlinois, par exemple, et le KGB, par STASI interposée. Je ne jouerai pas au journaliste d’investigation policière, toujours prêt à réduire le cours du monde et l’action des Etats à des conspirations de services spéciaux. Bien qu’elles existent et doivent être stigmatisées comme telles. En revanche, en basant leurs choix sur la reprise du « défaitisme révolutionnaire » léniniste en RFA, donc en concentrant leurs coups sur « le camp impérialiste », les groupes armés faisaient la part belle au « camp socialiste », à commencer par la RDA. Ce qui n’a pas l’air de gêner « En catimini ». On y cherche en vain la moindre allusion à l’Est. A croire que la Pologne, par exemple, secouée par des vagues d’émeutes et de grèves de masse dès la fin des années 60, n’existait pas. Pourtant, les Cellules révolutionnaires affirmèrent encore, en 1983, quelques mois après leurs actions contre le sommet de l’OTAN, que « pour nous, le problème de l’impérialisme de l’Ouest est plus important que celui de l’Est » (« Beethoven contre Mac Donald »). La dictature maoïste, qui spéculait sur les « non-alignés » depuis longtemps, en particulier au Moyen-Orient, n’est pas mentionnée. Comme à l’ordinaire, « l’internationalisme » affiché par les héritiers du léninisme des années 80 était à géométrie variable, autant que l’absence « d’alignement » des titistes des années 60. Bien prompts à briser des lances pour les guérillas nationalistes aux quatre coins du « tiers-monde », ils devinrent muets dès qu’il fut question de faire preuve de solidarité active avec les révoltes qui ébranlaient le « camp socialiste ». Ce qui faisait le jeu de leur propre Etat. Car la RFA n’était plus la société exsangue de l’immédiat après-guerre. Elle était redevenue la grande puissance régionale en Europe, sinon politiquement, du moins économiquement, et elle jouait des coudes pour faire sa place au soleil du système mondial en cours d’unification. Par suite, elle ne voulait pas faire de vagues avec les putschistes installés à Varsovie et, de façon générale, face aux lézardes qui commençaient à craqueler la glace de la Guerre froide, elle ne songeait qu’aux affaires et attendait son heure. A la veille de la réunification, elle ne demandait rien d’autre que le silence sur ce qui advenait de l’autre côté du Mur.
A la fin des années 60, Adorno signala avec raison qu’il y avait aussi du nationalisme allemand blessé dans l’opposition au système des blocs, en particulier dans l’opposition à celui de l’Ouest, lorsqu’elle dénonçait le danger de guerre et la militarisation du territoire ouest-allemand par l’OTAN. A force de poser en victime privilégiée de la nucléarisation en Europe, même des antinucléaires caressèrent parfois le nationalisme allemand dans le sens du poil. En témoigne l’évolution et la prise de position « enthousiaste » du parti écologiste lors de la chute du Mur. Bon nombre d’anti-impérialistes de la veille applaudirent « l’unité retrouvée du peuple allemand », montrant par là qu’ils n’avaient jamais été que des adversaires de la glaciation qui paralysait la puissance de leur nation. La question du nationalisme en Allemagne, à l’époque de la Guerre froide, est donc à la fois antérieure et plus vaste que la version rabougrie présentée par « En catimini », qui la date de l’époque de la réunification et la limite à la xénophobie de type fasciste, contre les Turcs par exemple. Or, il est possible d’être nationaliste sans être xénophobe, par exemple de reconnaître l’importance de la multiplication des cultures, à titre de parties constitutives du patrimoine culturel universel de l’humanité, façon UNESCO, et même d’accepter sur le sol national la présence des « communautés » les plus diverses sans remettre en cause la structure nationale de l’Etat, évidemment dans les limites dictées par la raison d’Etat et les besoins de l’économie. C’est le cas dans les Etats de vieille immigration, comme le Royaume-Uni, et qui n’ont pas été touchés par le fanatisme de la centralisation et de l’intégration à la française. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle bon nombre de clandestins venus des quatre coins du monde veulent passer le channel. La structure fédérale de l’Allemagne rend d’ailleurs en partie possible le même phénomène – ce que ne manquent pas de signaler les Grünen –, nullement incompatible avec la construction de centres de rétention.
Certes, des Cellules révolutionnaires critiquèrent les côtés les plus immondes du nationalisme allemand propagés par les néonazis, en particulier leur xénophobie envers les soldats afro-américains stationnés en RFA. Elles tentèrent aussi de prendre leurs distances envers la démagogie des pacifistes, qui présentaient l’installation de missiles nucléaires tactiques Pershing comme contraire à la souveraineté nationale. L’attitude de tels pacifistes rappelait celle de la tendance « nationale bolcheviste » du KPD qui, lors de la signature de la paix de Versailles, assimila l’Allemagne de Weimar à quelque nation du « tiers-monde » et appela à mener la « guerre nationale et sociale » contre les Etats vainqueurs. Mais, en la matière, elles n’allèrent pas plus loin que l’exécutif du Komintern en 1920. Ce dernier fit exclure du Parti ladite tendance comme chauvine, au nom de la doctrine léniniste de l’impérialisme, et appela les troupiers originaires des colonies françaises à retourner leurs armes contre « leur propre impérialisme », entre autres dans la Sarre occupée par la France. De même, « Beethoven contre Mac Donald » affirme que les actions des RZ contre les installations militaires américaines « furent toutes sans exception à caractère anti-impérialiste et contenaient en elles la possibilité d’approfondir les failles et les contradictions existant au sein de l’armée américaine et de soutenir la résistance des minorités nationales et raciales ». C’était le fond de commerce des marxistes-léninistes en Europe confrontés, dans les villes où étaient installées des garnisons de l’OTAN, à la présence d’Afro-Américains. A l’époque de la guerre du Vietnam, ils leur rappelaient sans cesse leur appartenance, à titre de minorité nationale, au camp des nations opprimées par l’impérialisme et les appelaient même parfois à rejoindre les Black Panthers ! De plus, dans leur optique héritée du Komintern, ils considérèrent l’immigration massive vers les métropoles au cours des Trente Glorieuses comme la chance inespérée de porter la « lutte contre l’impérialisme » au cœur même de la « bête ». Les travailleurs immigrés étaient censés être potentiellement plus révolutionnaires que les nationaux, encadrés par les appareils chauvins du syndicalisme institutionnel, etc. En 1986, « Colère révolutionnaire » l’affirmait encore : « Nous voulons contribuer à la redécouverte de l’anti-impérialisme concret en RFA […] L’anti-impérialisme ne signifie pas seulement attaquer le complexe militaro-industriel et n’en reste pas à la solidarité avec les mouvements de libération dans le monde. » En d’autres termes, la stratégie de la « révolution nationale et sociale » pouvait aussi élire domicile du côté de Kreuzberg, associée au soutien aux luttes des salariés dans le « tiers-monde », présentés comme « surexploités » par rapport à ceux du « premier monde », dans la pure veine misérabiliste des maoïstes d’Europe et d’outre-Atlantique. Ce qui revenait à préconiser, au nom de l’égalité dans l’esclavage, la généralisation planétaire du modèle de salarisation propre au capital et aux Etats les plus avancés, dans tous les sens du terme. Donnant la priorité aux femmes salariées ou non du « tiers-monde », les Rote Zora ne firent que transcrire en jargon néo-féministe le pathos marxiste-léniniste sur la « surexploitation », en particulier dans l’impayable « Chaque cœur… ». Leurs communiqués, à l’occasion des sabotages contre la firme Adler, du genre : « Nous ne nous battons pas pour les femmes du tiers-monde, nous nous battons à leurs côtés » n’avaient pas d’autre sens.
**********
« En catimini » insiste sur la violence « structurelle de la société ouest-allemande », « masquée » par la « fiction » de la pacification sociale qu’aurait révélée l’action des groupes armés. Ce qui n’épuise pas la question de la violence en société, sauf pour les moralistes, qui vivent dans l’attente de la venue du paradis terrestre, du royaume millénaire de la réconciliation universelle, etc. Monde idéalisé du christianisme, en vérité, sans passions et où la possibilité d’aliénation serait, par miracle, à jamais exclue. Or, l’activité des êtres humains, aussi loin que nous puissions remonter dans le passé, inclut la violence, y compris parfois au sein de leur propre espèce. Violence qu’il n’est pas toujours possible d’assimiler à la guerre, dans son contenu comme dans ses formes, même à la « guerre des sexes », construite, dans la représentation néo-féministe façon Rote Zora, à l’image de la « guerre des classes » marxiste-léniniste. La rupture avec le vieux monde, c’est la libération des passions humaines qu’il comprimait, mais c’est aussi l’aventure, la confrontation avec des situations inconnues et, donc, avec de nouvelles peurs, en y incluant celle de la liberté. Les êtres humains ne sont pas des dieux. Même libérés des modes connus d’exploitation et de domination, ils peuvent être confrontés à des contradictions, pire à des antagonismes qu’ils ne maîtrisent pas a priori, source de possibles gestes de violence, voire de meurtres. Par suite, face à l’accumulation explosive de « problèmes » qui les paralysent, ils peuvent être tentés d’en remettre la « solution » à quelque instance médiatrice, placée au-dessus d’eux, disposant de l’autorité nécessaire et reconnue par tous, qui tranche en leur nom les différends afin de rétablir le cours habituel de la société. C’est ainsi que l’appareil d’Etat, parfois démoli au cours des insurrections, est reconstitué par ceux-là mêmes qui le condamnaient, et que la coercition est à nouveau légitimée au prétexte de ne pas vivre avec des épées de Damoclès suspendues en permanence au-dessus de la tête. L’histoire des révolutions avortées, à commencer par la révolution russe, en apporte la preuve évidente. Le reproche essentiel à adresser ici au pouvoir d’Etat, c’est donc de détenir le monopole de la « violence légitime », au sens de Max Weber. Violence qui participe pleinement à la pacification de la société, aujourd’hui celle du capital, et qui constitue, en quelque sorte, le concentré de la violence diffuse qui imprègne la totalité de la structure sociale. Ce qui ne signifie pas que l’exercice de la coercition est réservé à l’institution étatique. En démocratie, tous les bons citoyens disposent potentiellement de pouvoirs de police, en particulier au Royaume-Uni, à des degrés divers en fonction des situations et des habitudes de leur nation respective. Ils ont même parfois la possibilité de porter des armes. La tradition française, de type jacobine, héritière de l’appareil centralisé de l’absolutisme, y est hostile. Mais, aux Etats-Unis, « être armé, c’est être libre », bien entendu pour défendre la propriété et l’Etat. De plus, l’Etat n’est pas que violence. La coercition exercée sur les individus apparaît certes en filigrane dans les actes et les dispositifs du pouvoir, désormais intimement liés à la science et à la technologie. Mais la sollicitude dont il est capable de faire preuve est aussi insupportable parfois que la violence qu’il exerce, car elle se paye toujours en acceptation des règles du jeu qu’il dicte pour sa propre perpétuation. La main qui assassine est souvent celle qui soigne, et il ne manque pas de malades qui aient envie de tuer leurs médecins, même lorsque ceux-ci les remettent sur pied. La médecine à visage humain n’est pas moins critiquable que celle qui nie aux femmes la possibilité d’avorter et, de façon générale, qui violente les corps et les esprits des humains pour les rendre conformes au système de domination. En d’autres termes, justifier les actes de violence envers l’Etat et les technologies, les biotechnologies par exemple, par la « violence structurelle » du capitalisme, c’est, mine de rien, en nier la valeur lorsque le pouvoir n’apparaît pas avec la figure patibulaire qu’on lui attribue, mais avec celle, plutôt débonnaire, du protecteur de la vie en société. Pour reprendre l’exemple des « antifascistes espagnols », utilisé à contresens par « En catimini », la conversion de bon nombre de marxistes-léninistes, adeptes de la guérilla façon Tupamaros, au parlementarisme et au capitalisme modernisé après le pacte de la Moncloa n’avait rien d’étrange. Ils n’avaient rien trahi puisque, reprochant essentiellement à l’Etat son arriération franquiste, ils n’avaient jamais été, en dernière analyse, que des réformistes en armes.
Bien entendu, en elle-même, la violence minoritaire n’est pas condamnable. Pas plus que les actions minoritaires en général. L’objection la plus répandue à son encontre, c’est que les intentions, les aspirations, les passions, etc., subversives des individus, seuls ou associés, qui les réalisent ne sont pas encore partagées par la majorité des damnés de la Terre ou, pire, qu’ils y sont hostiles. Il ne resterait donc plus qu’à attendre qu’ils soient en état de les comprendre. Pourtant, poussés par le désir de s’affirmer face au monde, des irréductibles ne renoncent pas à agir contre lui, par et pour eux-mêmes, même en nombre limité, tout en sachant bien que la liberté de chacun dépend aussi de celle de tous et que la destruction de la domination exige bien d’autres choses que la volonté de poignées d’individus. Il leur arrive donc d’assumer des choix dans l’indifférence, voire dans l’hostilité générale, qui ne permettent pas de briser ces dernières, même lorsqu’ils en souffrent et espèrent les dépasser. Ce qui advient parfois, de façon plus ou moins éphémère, à leur propre stupéfaction. Ils ont alors la satisfaction de voir apparaître quelques lézardes dans le mur en apparence solide de la camisole de force sociale et étatique, et quelques forces, jusqu’alors insoupçonnées.
Mais, entre la capacité à être actif, sur le mode affinitaire, et l’activisme propre au parti de la révolution néo-jacobine, il y a l’abîme de l’idéologie léniniste que « En catimini » traverse sans sourciller. Le terme de parti n’est plus utilisé, car il est désormais usé jusqu’à la corde. Mais l’esprit demeure, comme le montre le passage sur les groupes armés en RFA, qui « se sont attaqués à l’image de l’Etat et ont visé sa destruction symbolique plus encore que la destruction physique de ses structures. Ils ont largement dénoncé le caractère totalitaire de l’ordre démocratique, et, par là, sapé la légitimité du pouvoir des vainqueurs. » Prétendre de pareilles choses, c’est ressortir des tiroirs poussiéreux des manuels aussi antédiluviens que le « Que faire ? » de Lénine, la bible du Komintern, les tables de la loi de la doctrine de l’église léniniste universelle, qui sanctifie le rôle, la fonction et le mode d’organisation du Parti. Lénine, dans la pure tradition des Lumières et de leur critique de la religion, affirmait que la « conscience de classe » était extérieure à la « classe », incapable, par elle-même, de subvertir le monde, car aveuglée par l’idéologie dominante, propagée par les institutions de la classe dominante. Pour lui, l’idéologie n’était rien d’autre que le « mensonge » que l’Etat utilise pour cacher la « vérité » de l’exploitation et de la domination à ceux et à celles qui les subissent. Il n’a jamais compris que, en produisant et en reproduisant le monde du capital, les esclaves salariés en produisaient et reproduisaient aussi l’idéologie. Et qu’ils étaient susceptibles de le critiquer sans attendre des éducateurs qui, eux-mêmes, avaient bien besoin d’être éduqués. Pour Lénine, la tâche du Parti consistait donc à lever le voile, à rendre visible l’essence invisible de l’appareil de coercition du capitalisme. Il présumait que mettre à nu le visage de la domination produirait dans les masses l’intelligence nécessaire pour les conduire à la révolution. Les textes de la RAF montrent qu’elle partageait la même conception du pouvoir, y ajoutant, comme les leaders de l’APO, les médias comme instrument essentiel de formatage des esprits dans le monde modernisé du capital. La violence armée qu’elle préconisait n’avait pas d’autre objectif que d’en révéler la nature, « l’image » pour parler comme « En catimini ». Les autres groupes armés, malgré quelques dénégations et quelques prises de distance envers les côtés les plus ouvertement staliniens de la RAF, furent incapables de faire éclater le cadre léniniste, même lorsque, parfois, il les gênait aux entournures et qu’ils étaient soumis au feu de la critique, dans les colonnes de « Radikal », par exemple, au cours des années 80. En témoignent les appels des Cellules révolutionnaires à « Gagner les cœurs et les esprits », rédigés dans le style fleuri du dictateur poète de Pékin, Mao lui-même. A partir de là, la question des formes d’activité de tels groupes est secondaire, de même que le refus de telle ou telle Cellule révolutionnaire de les hiérarchiser. Elle ne peut passionner que la police, partie à la chasse aux poseurs de bombes, la presse, en quête de sensationnel, et les activistes, à la recherche de trucs et astuces. Vu les intentions et les objectifs affichés, l’activité restait prisonnière, pour l’essentiel, du schéma néo-léniniste. Avec ce qu’elle impliquait comme jeux de rôle et de poses dirigistes, même si les Rote Zora n’ont pas poussé le bouchon aussi loin que la RAF, véritable caricature en la matière. Mais la manie des sigles et des signes de reconnaissance, « RZ » par exemple, était déjà symptomatique…
Dans l’optique néo-léniniste, c’est l’avant-garde qui fait l’histoire, du moins tant que le reste de la troupe ne bouge pas et est considéré comme le vivier dans lequel le Parti potentiel peut racoler des forces d’appoint et les subordonner à ses propres fins. « La base sociale », en somme, comme n’hésite pas à l’appeler « En catimini ». Sauf que la « base » n’a de sens que par rapport au « sommet »… Position qui fut totalement assumée par la RAF et justifiée par la notion de « démocratie totalitaire », étendue à l’infini, jusqu’à prétendre que la situation dans « la métropole impérialiste » était verrouillée. En ce sens, la RAF était beaucoup plus « conséquente » avec les prémisses de ses actions que les autres groupes armés puisqu’elle voyait en elle-même le seul et véridique « sujet révolutionnaire » en RFA. En termes de conséquences, cela n’impliquait rien d’autre que la lutte pour la survie clandestine et pour révéler au monde la terrible découverte, kalachnikov au poing. D’autres groupes, tels que les Cellules révolutionnaires, ne furent pas atteints par cette manifestation aiguë d’autisme politique. Dès leur création, ils lui rappelèrent l’existence de sérieuses zones de tempête, en particulier autour de sites nucléaires en construction. Mais de là à rompre avec leur esprit de parti à moitié assumé, il y avait des marges qu’ils ne franchirent jamais, du moins au titre de groupe.
En RFA, les groupes armés eurent tendance, RAF en tête, à surestimer leur propres forces et à sous-estimer celles de l’adversaire, en l’occurrence celles de l’Etat. Et aussi à imaginer qu’ils étaient à la pointe du combat, théorique et pratique. Dès les années 70, on a eu la preuve du contraire. En particulier lors de l’apparition, hors de leur zone d’influence, de l’opposition massive au nucléaire. Elle incluait des composantes révolutionnaires, au niveau du contenu des actions comme des formes, réalisées par des cercles affinitaires qui, eux, n’avaient rien à foutre de la permanence des sigles. Non pas tant pour des raisons de sécurité que pour briser avec les habitudes organisationnelles héritées du léninisme. Bref, les groupes armés genre RAF ne comprenaient pas que leur force très relative dépendait aussi de celles des dizaines de milliers de personnes qui, dans les diverses sphères de la vie sociale, combattaient le capital et l’Etat. Mais le succès initial de telle ou telle de leur action et le plaisir de voir le pouvoir d’Etat surpris, voire ridiculisé, finit par agir comme quelque narcotique et, à ce titre, comme aiguillon pour reproduire des actions violentes du même type. D’autant que, comme le montra finement Jacques Camatte, à propos de la désagrégation des communautés de référence prolétariennes, de l’atomisation croissante des individus, de l’intégration des prétendues alternatives à titre d’huile dans les rouages du système et de la fuite dans la violence séparée : « Il y a surtout des phénomènes de déviance et de marginalisation que les médias absorbent progressivement en enlevant toute la charge explosive à la déviance et en rendant celle-ci compatible avec la norme, en proclamant que tout est possible et le divers nécessaire. Alors, pour tous ceux qui vomissent de façon immédiate la société, il ne reste qu’une issue afin de s’affirmer et être reconnus autres, révolutionnaires : la violence. » En tous cas, dans les années 70, malgré les arrestations et la chasse aux sorcières, l’illusion d’avoir des ailes augmenta au point que des groupes comme la RAF crurent faire vaciller le pouvoir par leurs seules forces. Lorsque Ulrike Meinhof, paraphrasant la célèbre sentence de Mao, affirma : « Il était déjà matériellement visible que le monopole de l’Etat sur la violence est limité, que ses forces peuvent s’épuiser, que si l’impérialisme est sur le plan tactique un monstre dévoreur d’hommes, il est sur le plan stratégique un tigre de papier », elle révélait, malgré elle, l’étendue du désastre généré dans les têtes de la RAF par l’avant-gardisme marxiste-léniniste et la perte totale du sens des réalités auquel il les avait conduites, bien avant d’être enfermées dans des cellules capitonnées en prison spéciale. Dès 1977, « l’importante offensive » de la RAF n’entraîna aucune « crise de légitimité », mais la défaite cuisante confirma, pour la énième fois, que le néo-jacobinisme n’avait plus aucun sens depuis longtemps, en termes de lutte révolutionnaire contre le pouvoir. Incapable de le comprendre, « En catimini » en arrive à asséner des énormités du genre : « Depuis plusieurs années déjà, ce sont particulièrement les luttes pour les prisonniers qui entament l’image de l’Etat lorsque celui-ci doit faire de stratégiques calculs dans l’urgence. » En d’autres termes, l’incarcération, voire la torture blanche, infligée à la militance armée serait le moyen idéal, ou presque, pour faire prendre conscience à ceux qui ne la subissent pas de la « nature totalitaire » du pouvoir et de la justesse de la position des groupes armés. « En catimini » pourrait aussi bien prétendre que la mise en croix du clouté de Nazareth a révélé aux habitants de la Judée la nature de l’Empire romain et prouvé l’existence de Dieu. Les conséquences de telles broderies sur le canevas du sacrifice à la « cause de la révolution » ne sont que trop connues. En RFA comme ailleurs, elles ont essentiellement favorisé les manifestations éphémères d’indignation morale, même du côté des pasteurs, face au pouvoir qui, au nom de la raison d’Etat, fit tuer en cellule des membres de la RAF. Pour le reste, les réfractaires qui combattaient, à Berlin et ailleurs, n’avaient nul besoin de la « démonstration » fournie par l’institution pénitentiaire pour être débarrassés des illusions sur la « démocratie libérale ». Ils savaient déjà à quoi s’en tenir au cas où ils n’accepteraient pas de rentrer dans le rang.
**********
Il est des actes et des rencontres éphémères qui sont dynamiques et qui perturbent le cours pesant des choses, entrouvrant des portes vers des ailleurs prometteurs. Surtout par temps lourd, de telles bouffées d’air pur ne sont pas à négliger. Cela dit, avoir le sens de la continuité n’est pas à rejeter, bien qu’il puisse, lorsque l’on n’y prend pas garde, devenir source de valorisation et, donc, d’aliénation pour les individus, seuls ou associés. En particulier dans les périodes où, par suite de l’intégration d’aspirations partielles au système de domination et de persécutions policières, l’association de leurs forces en vue de réaliser des objectifs communs devient leur pôle de référence obligé. Ce qui arrive toujours lorsque l’activité est répétitive et adopte les traits plombés du travail. La survie de l’entité créée prend le dessus sur la vie même des membres et verrouille leur horizon alors que, à l’origine, celle-ci exprimait leur dynamisme et leur volonté d’en découdre avec le monde. Le terme de membre, repris sans problème par « En catimini » à propos des Cellules révolutionnaires, n’est pas neutre. Il exprime à merveille la subordination des individus à l’association désormais figée, transformée en groupe. Or, les groupes disposent non seulement de jambes, mais aussi de têtes, de normes, de règles identitaires et même parfois de sigles. Autant de cartes de visite qui donnent l’illusion de la continuité, donc de la force alors que, comme forme, elles peuvent cacher de graves faiblesses, en termes de contenu. L’absence systématique de revendications des actes peut d’ailleurs créer des illusions analogues, procédé utilisé par les nihilistes comme Netchaïev et, à la fin des années 60, par des groupes activistes de Berlin, de type Weathermen. Bref, lorsque le groupe n’est pas capable de dépasser les limites qui l’entravent, la morale revient en force avec ce qu’elle implique de froideur et de contrainte pour les individus. L’association devrait inclure la possibilité de la séparation, ce qui n’est pas synonyme de guerre. Mais, dans la mesure où l’hypothèse de mettre fin à l’aventure commune est saisie comme défaite, réintégration dans le monde que l’on refuse, l’organisation devient le bastion à conserver coûte que coûte. C’est cet esprit de conservation qui explique la schizophrénie spécifique aux milieux de la militance, même libertaire. C’est lui qui favorise la double pensée, le double langage, la double attitude, le double niveau d’activité et d’association, etc., dont les symptômes habituels sont la logomachie, l’affaiblissement, voire l’extinction, de la faculté critique, l’apparition de mécanismes de défense et de tolérance au sein du groupe, associés à la méfiance, voire à l’intolérance hautaine, envers le milieu dont il est issu et dans lequel il évolue encore en partie.
Pour la RAF, le processus de transformation de l’association fugitive en groupe armé fermé et replié sur lui-même fut foudroyant. D’abord, parce que la police réagit très vite, après les premiers sabotages, pour persécuter Baader et les autres, dans la foulée des mesures prises contre les leaders de l’APO. Ensuite et surtout parce qu’ils étaient mûrs pour jouer la carte biseautée de la guérilla urbaine, sous le signe de la kalachnikov et de l’étoile rouge. Les articles de Meinhof dans « Konkret », porte-voix des étudiants radicaux en 1968, sont déjà bien imprégnés de l’esprit des évangiles marxistes-léninistes. Faisant de nécessité vertu, la RAF affirma même que la clandestinité totale était le préalable à l’activité subversive et qu’elle était antagonique avec la hiérarchie. Or, l’histoire du Komintern démontre l’inverse. Dans « Le totalitarisme », Annah Arendt souligne que « les partis communistes dirigés par Moscou montrent la curieuse tendance à préférer les conditions de clandestinité, même là où elle n’est pas nécessaire ». Bien avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir, le centralisme fut renforcé par le côté conspiratif du KPD puisque, au nom de la sécurité, le comité central imposa la censure et favorisa l’autocensure, à commencer dans les cellules de base. En effet, les poses et les méthodes conspiratives en imposaient aux naïfs et aux compagnons de route, permettaient d’installer la plus stricte discipline au sein du Parti, de tuer dans l’œuf les tentatives d’avoir des relations et des discutions hors du cadre fixé par la hiérarchie. Lénine, dans « Que faire ? » détermina ainsi le type d’organisation bolchevique qui devait devenir le modèle pour le Komintern : « Le seul principe sérieux pour les militants de notre Parti doit être : pas de démocratisme, discipline rigoureuse, secret rigoureux, choix rigoureux des membres, capacité rigoureuse à surveiller et à combattre la police politique, punition sévère des entorses aux devoirs de camaraderie, préparation rigoureuse de révolutionnaires professionnels dévoués à la cause. » Et d’ajouter : « L’organisation du Parti exige que les comités ne sachent rien de plus que ce qui est nécessaire pour réaliser leurs tâches. » L’idéologie utilitariste des besoins appliquée à la question du militantisme, en somme, pour laquelle les individus situés à « la base », encartés ou membres d’associations périphériques, sont les instruments des fins du « sommet » de la pyramide qui leur échappent. Des années de domestication dans ce sens finirent par transformer des individus quelque peu réfléchis en automates qui, au nom de la cohésion, de l’efficacité, de l’urgence et, en priorité, de la sécurité collective, refoulaient les doutes qui les assaillaient et acceptaient d’obéir aux ordres, même à contrecœur. Dans l’Europe des années 70, les organisations d’obédience ML tentèrent de rejouer la partition clandestine du Komintern, et, parfois, la farce tourna au drame, en RFA par exemple. En France, la moindre allusion au danger de « fascisation » suffisait, bien souvent, à actionner les réflexes lénino-pavloviens et à faire régner le silence dans les cellules des ruches maoïstes, menacées par la loi de 1934 et les verges de la cour de sûreté de l’Etat pour des menées subversives, en bonne partie imaginaires d’ailleurs. Même des groupes post-situationnistes, voire anarchistes, fidèles à l’esprit conspiratif de Bakounine, hérité des conjurations babouvistes, reprirent des idées analogues. Sans compter les quelques cercles sans lendemain qui firent l’apologie de Netchaïev. D’ailleurs, en matière d’objectif et d’organisation, le léninisme est très proche du netchaïevisme, ce qui explique qu’il soit encore difficile aujourd’hui de distinguer des nihilistes battant pavillon anarchiste de marxistes-léninistes. En particulier dans des Etats comme la Grèce, où d’importantes guérillas sous contrôle stalinien existèrent à l’époque de la prétendue guerre de libération nationale contre le fascisme et, de façon plus réduite, sous la dictature des colonels.
Bien entendu, même pour des cercles affinitaires, il est parfois nécessaire de couvrir du voile de la plus grande discrétion telles ou telles de leurs activités, de leurs relations, etc. Il est des choses qui ne concernent que les individus impliqués, a fortiori lorsqu’elles tombent sous le coup de la loi. La capacité à les réaliser de façon clandestine n’est donc pas à négliger. Clandestines, elles le sont, non seulement pour l’institution étatique, la police en premier lieu, mais aussi pour les citoyens, policiers dans l’âme, « toujours prêts à protéger la police », d’après Stirner. A moins de croire à la représentation débonnaire que la démocratie donne d’elle-même et d’accepter la problématique définie par le pouvoir d’Etat, la séparation entre le légal et l’illégal, il est difficile de faire autrement. Séparation assez élastique pour lui permettre d’exercer le monopole de la violence légitime avec rigueur en cas de nécessité, sous prétexte de « lutter contre le terrorisme ». Bien entendu, il est déjà arrivé que des individus, seuls ou associés, revendiquent en leur nom leurs actes, ce qui risquait de leur coûter cher, pour des raisons qui leur sont propres. Par exemple, lors des premiers sabotages effectués, il y a presque douze ans en France, contre les biotechnologies. Dans de tels cas, la décision leur appartient et il n’est pas question d’en exclure la possibilité, au nom de la sécurité, à condition de rejeter les opérations publicitaires des citoyennistes, Bové en tête.
Les Cellules révolutionnaires, et plus encore les Rote Zora vers la fin de leur existence, prirent du champ envers la RAF, accusée à l’occasion de vouloir constituer le « parti de la guérilla ». Elles n’ont donc pas défendu le mode de clandestinité intégrale qu’elle prônait. Par suite, la présentation de leur forme d’organisation par « En catimini » a de quoi séduire les lecteurs peu attentifs, mais perméables à la mythologie générée par la Toile, qui développe l’idée que la notion de réseau exclut celle de hiérarchie. Les Cellules auraient tissés des liens en réseau, facilitant au maximum les complicités actives, mais aussi les séparations en cas de désaccords, ou même la participation à d’autres cercles et à d’autres milieux plus fluides, etc. Ce qui, de plus, les aurait rendues peu détectables par la police. Dans cette optique, l’appel à « créer de nombreuses cellules révolutionnaires » n’apparaît plus que comme le détournement ironique de celui de Guevara : « Créer de nombreux Vietnam ». En réalité, au-delà de la représentation avantageuse donnée par « En catimini », la suite de la lecture nous révèle bien d’autres choses, beaucoup moins sympathiques. Elle montre que, loin d’être des cercles affinitaires, les Rote Zora, pas plus que les RZ, n’avaient pas vraiment rompu avec le modèle léniniste. La décentralisation n’implique pas l’absence de centre, l’Etat moderne est là pour le confirmer, lui qui intègre aussi comme mode de communication et d’organisation les réseaux du monde de l’information. Dans les groupes armés, le centralisme est revenu en force, justement au nom de la clandestinité, comme le montrent les citations suivantes : « Le mode opératoire que s’imposent les RZ permet une grande visibilité de leurs actions, sans les obliger à entrer en totale clandestinité : organisation horizontale, noms de code, absence d’informations entre cellules sur leur constitution. Une dizaine de cellules sont coordonnées, mais toutes les personnes faisant partie des RZ ne se connaissent pas et les contacts entre cellules sont limités au maximum. » En d’autres termes, les liaisons sont centralisées entre quelques mains, à titre de corollaire de la compartimentation et de la séparation des cellules. Ce qui réintroduit la hiérarchie propre au Parti, condamnée en paroles. La non-mixité façon Rote Zora n’y change rien. « Tout est mis en œuvre pour que la discrétion de l’organisation soit protégée, et avec elle les personnes qui la composent. La sécurité implique une prise de renseignements sur ceux et celles qui veulent entrer dans les Cellules (sur la famille, les relations amoureuses, le passé, les amitiés, etc.) pour éviter les indics et infiltrés. » Le problème est réel, mais bien plus vaste. D’abord, à l’époque de la création des groupes armés en RFA, il incluait déjà celui de la drogue puisque les milieux d’où ils surgirent, les communautés alternatives de Berlin par exemple, faisaient souvent l’apologie de l’héroïne au nom du refus de la morale chrétienne et de la jouissance sans entraves. Or, avec des camés, il est impossible d’avoir la moindre activité, même tolérée par l’Etat, parce que les relations de confiance sont anéanties d’avance. Mieux vaut savoir si tel ou tel individu, même révolté, est adepte de la seringue. Ensuite, personne n’échappe totalement à la séparation entre domaine privé et domaine public, sur laquelle repose encore en partie l’institution étatique. Hostile aux postures inquisitrices, qui tyrannisent l’intimité des individus, je reconnais pourtant qu’il est impossible de faire abstraction des relations d’amitié et d’amour personnelles dès que la question de l’activité, en particulier clandestine, entre en jeu. Lorsqu’elles sont antagoniques avec ce qui est proclamé, la dichotomie est inacceptable et elle peut même mettre en danger les individus associés. Enfin, l’aliénation des passions, difficilement détectable au jour le jour, génère parfois des névroses, des paranoïas soudaines contre lesquelles les groupes ne sont pas vaccinés : d’où des crises de rage incontrôlables, des dénonciations vengeresses, etc. Sans compter les aventuriers qui aiment jouer avec le feu et prendre des risques extrêmes. Malinovski, l’un des principaux chefs du parti bolchevik, qui effectua des années de prison et de déportation en Sibérie pour participation à l’insurrection de 1905, qui organisa des expropriations et donna ses camarades à l’Okrana, ne fut démasqué que très tard. Il rentra d’ailleurs volontairement en Russie après Octobre pour y être fusillé. Lénine rejeta la possibilité d’une telle duplicité jusqu’à l’ouverture des archives de la police tsariste. En la matière, la vision restrictive des sources de danger, limitée à la provocation policière, est inopérante et il n’y a pas comme les révolutionnaires professionnels, les léninistes en particulier, pour être désarmés face aux abysses de l’esprit humain. Mais ils pratiquent le déni de réalité, sous peine de remettre en cause l’image de dureté et de pureté qu’ils ont d’eux-mêmes. Lorsqu’ils sont obligés d’en tenir compte, c’est pour les ranger dans des tiroirs numérotés, reprenant les catégories en vigueur dans les facultés de médecine. C’est pourquoi, derrière leurs poses sévères, transparaissent les casquettes des policiers, les toges des juges et, parfois, lorsqu’elles sont déclinées au féminin, les blouses blanches des psy.
A tous ces problèmes complexes, « En catimini » propose la solution simple et bien connue des groupes léninistes : le flicage de la périphérie par l’organisation centrale déjà constituée. Car la conception classique du Parti présuppose que le ver ne peut pas déjà être dans la pomme, qu’elle est a priori « imputrescible » et que les opérations policières sont essentiellement dues à quelques bacilles extérieurs ou internes, les indicateurs et les repentis. Là comme ailleurs, le problème du contenu de l’activité est évacué au bénéfice exclusif des formes et des cours de morale. Poser la question de savoir si, à cause de quelque vice de constitution, la structure a priori clandestine n’est pas déjà connue, voire vérolée, en partie au moins, par la police, donc manipulable, est en général rejeté comme relevant de l’idéologie complotiste, comme concession intolérable à la conception policière de l’histoire, etc. Bien sûr, le mode de domination du capital n’est pas assimilable à la vision selon laquelle Big Brother, représentation de la caste des prétendus « maîtres du monde », tapie dans l’ombre, dirigerait la planète à l’image des marionnettistes. Dans les périodes de remise en cause des « certitudes », précise Arendt dans « Le totalitarisme », « ce que les masses refusent de reconnaître, c’est le caractère non déterministe dans lequel baigne la réalité. Elles sont prédisposées à toutes les idéologies parce que celles-ci expliquent les faits comme étant de simples exemples de lois et éliminent les coïncidences en inventant quelque pouvoir suprême et universel qui est censé être à l’origine de tous les accidents. » L’Etat mondial, disposant de la puissance lui permettant d’avoir la maîtrise de l’histoire, relève de la fiction, même depuis la fin des blocs et l’accélération de la globalisation du capital. Le transfert des souverainetés nationales à des instances supranationales comme l’ONU reste très relatif. Par exemple, les décisions de l’assemblée générale des Nations Unies concernant Israël restent lettre morte sans l’accord unanime du club des cinq principaux Etats nucléaires de la planète, installés au Conseil de sécurité. « Qui possède la force dispose de la véritable légitimité », affirmait Grotius, idéologue de la république hollandaise naissante. Dans la réalité, il existe des Etats constitués, des institutions et des puissances paraétatiques organisées en réseaux locaux ou plus globaux qui parfois agissent pour leur propre compte, parfois à titre de supplétifs desdits Etats, ce qui était le cas du COSE en Palestine. En ce sens, le Moyen-Orient est le modèle du genre depuis plus de cinquante ans. De façon générale, il est absurde de prétendre que les Etats européens ont inventé les groupes armés néo-léninistes, genre RAF, et qu’ils les manipulaient à leur gré comme des pantins.
Par contre, le roman de la repentance et de la dissociation, lui, a toutes les faveurs des apologistes de tels groupes. Or, la théorie du traître a ceci de commun avec celle du complot qu’elle permet de refouler la question de la nature de leur activité et de leur mode d’organisation. Ainsi, en Allemagne, il est de bon ton de stigmatiser la nébuleuse qui tournait autour de la RAF et qui a constitué le vivier dans lequel la police a puisé indicateurs et balances. Mais, si la RAF elle-même n’avait pas établi de relations instrumentales avec le milieu qui l’entourait, la casse aurait été bien moindre. Elle voulait disposer d’instruments qui joueraient le rôle de grooms sans se poser de questions. Elle en a eu, mais il ne faut pas s’étonner qu’ils aient été retournés comme des crêpes en moins de deux. De plus, ce n’est pas seulement la police qui tenta d’entrer en relation avec les groupes armés, mais aussi eux qui tentèrent de jouer avec elle, en particulier au Moyen-Orient. En choisissant comme date butoir l’année 1977, celle de l’arrestation d’Albartus, avant laquelle le pouvoir d’Etat n’aurait rien su de la structure des Cellules révolutionnaires, « En catimini » passe sous silence les aventures palestiniennes de tels groupes armés depuis 1970. Il est facile de stigmatiser Klein, l’un de leurs membres ayant participé à la prise d’otages des ministres de l’OPEP en 1975 à Vienne, pour son interview au « Spiegel ». Manifestement, il avait déjà été « interviewé » par les services du FLN, après l’atterrissage à Alger. Mais pourquoi avait-il participé à l’affaire de Vienne ? Opération organisée par Carlos avec la bénédiction du KGB. Question dérangeante que « En catimini » évacue car elle pose d’emblée le problème de l’activité anti-impérialiste des Cellules révolutionnaires autour de la Palestine. En allant jouer à la guérilla sous la direction du FPLP, elles mettaient le pied dans de sacrés nids de vipères. Mais elles les assimilaient à des « amis de la cause palestinienne » avec lesquels il était possible de papoter et d’effectuer des opérations communes. Les bons barbouzes savent se faire aimer.
**********
Voilà, j’ai abordé les problèmes que j’avais envie de soulever, en espérant avoir effectué le débroussaillage de pistes oubliées, difficilement praticables, surtout lorsque l’on a appris leur existence par ouï-dire. La jungle de l’idéologie « révolutionnaire » est aujourd’hui suffisamment dense pour que l’on accepte, sans trop se poser de questions, les premières cartes tombées du ciel. Or, bien souvent, elles ont besoin d’être sérieusement mises à jour et, parfois, elles ne méritent que le broyeur. On ne manquera pas de me faire remarquer les limites de ce qui précède. Elles sont réelles car je suis plutôt allusif sur l’histoire de l’ensemble des oppositions à l’Etat, qui ébranlèrent la RFA pendant deux décennies. Mais mon objectif, plus modeste, n’était pas d’en tirer le bilan global. De même, je me contente de faire allusion au néo-féminisme sous l’angle de ses relations avec le léninisme, tel qu’il m’est apparu à la lecture de « En catimini ». Ce qui m’a amené à forger le néologisme de lénino-féminisme pour caractériser les Rote Zora. Pour le reste, je renvoie aux critiques pertinentes et plus globales, effectuées dès 1977 par Annie Le Brun. Dans des textes comme « Jdanov change de sexe », elle y analyse la nature des monstrueuses épousailles entre Lénine, Staline, Mao et Beauvoir, effectuées sous le patronage des « boîtes à idées » et des chaires universitaires, féminisées pour l’occasion et devenues des centrales de ventilation des idéologies de la domination modernisée. Ce qui sanctionna, au prétexte de stigmatiser d’antiques hiérarchies masculines encore vivaces, même sous nos latitudes, le rejet des perspectives subversives, formulées et portées par de belles et fortes individualités féminines, telles que Flora Tristan, Voltarine de Cleyre, Louise Michel et Emma Goldman, pour ne nommer que certaines des plus connues. Sans compter toutes les inconnues qui, de la Commune de Paris à Barcelone, lors de la révolution libertaire, montèrent à l’assaut du ciel. ?
Pour toute correspondance
petervener@free.fr
